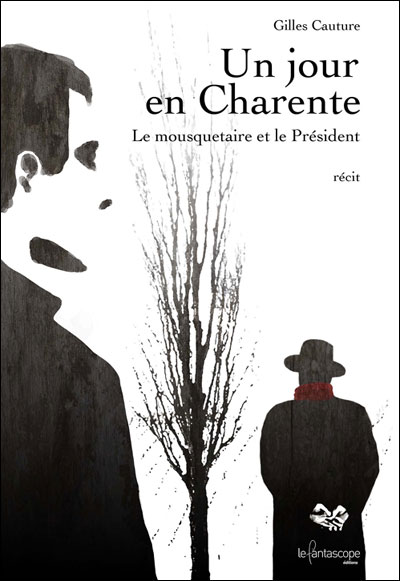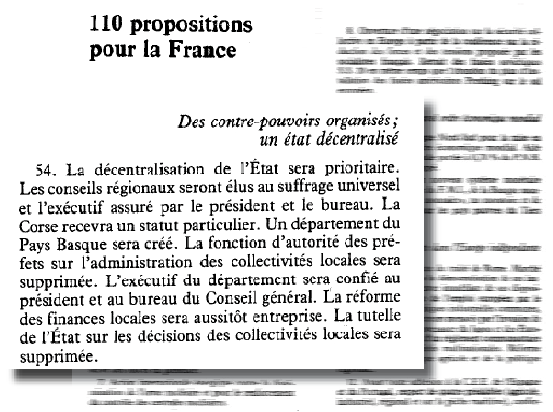La crise financière de l’été 2008 et ses répercussions dans tous les domaines ont entraîné l’inquiétude à l’égard de la monnaie européenne, voire le scepticisme quant à la solidité de l’économie des États membres. Un nombre non négligeable de commentateurs évoque même une possible de sortie de l’Euro. D’autres se tournent au contraire vers Bruxelles dans l’espoir de décisions et de réformes à la mesure des enjeux, mais restent sur leur faim. L’Institut a souhaité aborder ces questions avec l’une des actrices de la création de la monnaie unique, Madame Élisabeth Guigou 1. Avec elle nous sommes revenus sur les projets et les attentes au moment de la création de l’Euro et sur la situation actuelle.
Conseillère à l’Élysée, vous avez connu, aux côtés de François Mitterrand, plusieurs crises monétaires, et notamment les attaques sur le franc en 1983. La crise actuelle est-elle plus grave ? L’Euro, par rapport à la situation des années quatre-vingt, nous protège-t-il ?
Élisabeth GUIGOU.- Vous avez raison de poser la question. En 1983, François Mitterrand, après avoir beaucoup hésité, a fait le bon choix. C’est-à-dire le choix de l’Europe et du Système monétaire européen (SME) qui est, en quelque sorte, l’ancêtre de notre monnaie unique. S’il n’avait pas fait le choix de maintenir le franc dans le cadre de ce système européen, s’il n’avait pas joué la carte européenne, alors la valeur de notre monnaie serait tombée comme une pierre sur les marchés des changes. Bien entendu, il aurait fallu la défendre par une action de la Banque de France, mais dans l’état où étaient nos réserves de change nous n’aurions pu réussir sans faire appel au Fond monétaire international. Nous aurions été, d’une certaine façon, dans la même situation que la Grèce aujourd’hui, avec la solidarité européenne en moins. Nous serions alors entrés dans une spirale, non seulement de déclin économique, mais surtout de déclin politique considérable. Heureusement, François Mitterrand a préféré rester dans le SME et donc faire les efforts d’ajustement macro-économique pour cela. Mais, choisissant de rester dans l’Europe, il a pu dans le même temps faire appel à la solidarité européenne. Je rappelle – c’est un peu technique mais il faut le dire – qu’en mars 1983, le Franc est de nouveau dévalué, certes, mais tout en restant dans les limites prévues par la CEE et surtout en bénéficiant parallèlement d’une forte réévaluation du deutschemark. Ce qui fait que l’Allemagne a fait une partie du chemin qui nous permettait de rattraper les écarts de changes. D’ailleurs, c’est bien ce choix et ce geste de solidarité européenne qui permet ensuite à François Mitterrand d’affermir son influence et son autorité au sein de la CEE – avec Helmut Kohl et Jacques Delors principalement, mais pas seulement. C’est ce choix de la France qui a permis ensuite que l’on chemine avec les initiatives successives vers la monnaie unique.
Cette monnaie unique : elle nous protège. Et c’est d’autant plus vrai si l’on se souvient de ce qui se passait dans les années quatre-vingt : par comparaison, on peut facilement imaginer ce qui se serait passé lors de la crise monétaire de 2010 si nous n’avions pas eu l’Euro mais un franc isolé. Nous aurions été infiniment plus secoués et nous devrions le dire davantage. Donc, la monnaie unique nous protège et c’est bien pour cela que François Mitterrand a soutenu sa réalisation. Il ne faut cependant pas être aveugle : l’Euro nous a protégés relativement. Car le problème est que cette monnaie unique – comme le dit très justement Jacques Delors – protège mais ne dynamise pas. La monnaie ne permet pas à elle seule de créer de l’activité économique et donc des emplois.
Il y aurait donc, avant tout, un problème politique ?
Élisabeth GUIGOU.- Oui. Et cela tient à une raison très simple.
Nous avons fait l’union monétaire. C’est une politique audacieuse dont on peut dire qu’elle est quasiment de nature fédérale puisque nous avons une banque centrale indépendante, supranationale. Mais il faut rappeler que dans le Traité de Maastricht, nous avions aussi l’ambition de créer une union économique. Ce que nous voulions, c’était une union économique et monétaire. En d’autres termes, à côté de l’union monétaire nous voulions tirer tout le parti d’une union économique dynamique. Or, il faut bien constater que cette partie économique a été complètement oubliée. Nous n’avons tout simplement pas appliqué le traité de Maastricht.
Dans le traité de Maastricht, cette ambition était écrite noir sur blanc. J’ajoute que cela a été une négociation que nous avons remportée de haute lutte, Pierre Bérégovoy et moi, dans le cadre de la conférence intergouvernementale sur l’union monétaire. Pierre Bérégovoy était ministre des Finances et j’étais ministre des Affaires européennes. En face de nous, bien entendu, nous trouvions les Britanniques mais surtout les Allemands. Eux voulaient une banque centrale et rien d’autre. Or qu’avons-nous réussi à faire écrire dans le traité ? Que le Conseil européen – c’est-à-dire les chefs d’Etat et de gouvernements des États membres de l’Union européenne – devaient être responsables du cadrage des grandes orientations économiques à l’intérieur desquelles la banque centrale devait – en toute indépendance par rapport à la fixation des taux d’intérêt – inscrire sa politique monétaire. D’une certaine façon, nous disions : le politique prime sur la décision économique. Et nous avons gagné sur ce point face aux négociateurs allemands en faisant valoir que c’était exactement ainsi que fonctionnait le modèle allemand. Nous avons pu d’ailleurs le vérifier très simplement : au moment de la réunification allemande se posait la question de la fusion entre le deutschemark – la monnaie de la RFA – et de l’ostmark – la monnaie de la RDA. Or, les deux monnaies n’avaient absolument pas la même valeur. Eh bien, contre l’avis de la Bundesbank, Helmut Kohl a pris la décision, de son propre chef, d’échanger les Ostmarks et les Deutschemarks à parité et non à deux contre un. Les autorités allemandes démontraient la supériorité du gouvernement sur la Bundesbank. Ce qui nous donnait un argument pour réclamer la même chose pour la future Banque centrale européenne. La rédaction du traité de Maastricht va dans ce sens : il y a un mécanisme politique qui va du Conseil européen vers le Conseil Éco-fin 2 afin de déterminer un cadrage économique. Si ce mécanisme fonctionnait correctement, on aurait de fait une coordination des budgets nationaux en amont, à Bruxelles. Bien entendu, les parlements nationaux garderaient leurs pouvoirs souverains, mais au moins aucun budget d’un État membre ne serait adopté sans qu’il ait fait l’objet d’une concertation avec les autres partenaires. J’observe que les propositions de Monsieur Van Rompuy sur le « semestre européen » vont dans ce sens. Il veut instituer une concertation institutionnelle sur les budgets nationaux à partir du mois de mars donc très en amont de leur adoption. Mais il a fallu attendre 18 ans et une crise majeure pour que le Conseil européen se saisisse enfin de la coordination des politiques budgétaires.
J’espère aussi que nous pourrons avancer dans la voie d’une harmonisation fiscale. Or, elle reste aujourd’hui très imparfaite : on l’a faite sur la TVA mais pas sur la fiscalité de l’épargne ou sur l’impôt sur les sociétés. Ce qui a permis à l’Irlande de bénéficier des fonds structurels européens tout en faisant du dumping fiscal pour attirer chez elle les sièges sociaux des entreprises !
Surtout, une telle coordination, en temps de crise, aurait permis de mettre en œuvre très rapidement des politiques d’investissements à l’échelle de l’Union européenne. On aurait alors pu les financer sur le budget européen et grâce à des capacités d’emprunt de l’Union. Tout cela nous permettrait aujourd’hui, par exemple, de financer des investissements à long terme, de grands réseaux européens de tous ordres – trains, réseaux optiques, etc. C’est exactement ce qu’avait proposé Jacques Delors dans son Livre blanc publié en 1993 et traitant de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi 3. Ce Livre blanc, le Conseil européen l’avait même approuvé ! Et puis… Un nombre incalculable de Conseils européens successifs se sont enchaînés et les chefs d’état et de gouvernements ne se sont jamais emparés des compétences que leur donnait le traité. Ils ont sous-traité aux ministres des finances, qui se sont cantonnés à ce qu’ils aiment faire, c’est-à-dire préparer des G7 et regarder en direction du FMI. L’ambition des années quatre-vingt dix s’est perdue et l’esprit européen aussi ! Les institutions politiques européennes et le Conseil européen n’ont pas assumé leurs responsabilités.
Cela pourrait-il changer dans les nouvelles institutions ?
Élisabeth GUIGOU.- Le Président Von Rompuy [M. Herman Van Rompuy est un homme politique belge, chrétien démocrate. Il est le premier président permanent élu par le Conseil européen.]] a l’air de s’intéresser à ces sujets là, regroupés aujourd’hui autour de ce qu’on appelle la stratégie Europe 2020 4. Il a l’air d’être conscient des enjeux et je pense qu’il faut lui faire crédit. J’espère que le semestre européen qu’il propose sera adopté. Mais, ses marges de manœuvre sont faibles : il a été nommé dans les conditions que l’on sait et l’essentiel de la responsabilité demeure entre les mains des chefs d’Etat et de gouvernements des États membres. Ce sont eux qui siègent au Conseil européen et décident in fine. Comment savoir ce qu’ils veulent vraiment ? On a vu dans la crise grecque : 6 mois de tergiversations. À force de ne pas respecter les règles que nous nous donnons à nous-mêmes, c’est la crédibilité de la zone euro que l’on atteint. Et cela ne date pas d’hier. Regardez ce qui s’est passé depuis 2003 : les 3 % de déficit ou les 60 % de dette par rapport aux PIB n’étaient plus respectés par les deux principaux pays, c’est-à-dire la France et l’Allemagne. En 2004, ces deux pays – leurs gouvernements ! – ont refusé qu’Eurostat, qui est chargé de vérifier les budgets, fasse les vérifications sur pièces et sur place des statistiques officielles. S’ils l’ont refusé c’est parce qu’ils ne voulaient pas être soumis à ces règles. S’ils avaient accepté, on se serait aperçu plus tôt des fraudes statistiques de la Grèce.
Je souligne au passage que le gouvernement Jospin a toujours scrupuleusement respecté les critères européens et même au-delà de ce qui nous était demandé puisque nous avons diminué jusqu’à 58 % – donc en dessous de 60 % – l’endettement et qu’on est revenu à un peu moins de 2 % d’endettement en 2001, même si cela a remonté un peu après. Ensuite : vous connaissez la situation. Donc, il y a eu une démission des gouvernements français et allemands qui ont refusé de s’appliquer à eux-mêmes les disciplines votées. Du coup, ils ont perdu toute autorité et toute légitimité pour les réclamer aux autres. Seule l’Irlande, je crois, a été sanctionnée…du moins admonestée 5… À partir de là, comment s’étonner de la fraude du précédent gouvernement grec ?
Les États membres sont-ils les seuls responsables ?
Élisabeth GUIGOU.- Ils détiennent, finalement, la décision. Mais il faut aussi dénoncer l’attitude de la Commission. Celle-ci est malheureusement complètement acquise à l’idéologie libérale. Elle a théorisé sa propre impuissance ! Aucune directive sérieuse n’est venue, depuis des années maintenant, sur l’harmonisation des fiscalités. Elle n’a pris aucune initiative notable pour coordonner la politique économique des États membres. Rien non plus pour des investissements européens. Regardez la situation actuelle. Après deux ans de crise et trois G20, la directive sur les Hedge fund n’est toujours pas adoptée. Seul le Parlement européen entretient l’esprit européen. Certes, il y a eu l’accord du 10 mai 2010 qui a créé le Fonds de stabilisation de 750 milliards d’euros et évité le pire. Les propositions de Monsieur Barnier sur les organes de contrôle sont un premier pas, mais bien tardif. Nous nous sommes arrêtés au bord du gouffre. Mais vous voyez bien que même si on a réussi à sauver la Grèce – en tout cas de la faillite financière, car le peuple grec doit faire face à de très graves difficultés – il faudrait, pour déjouer définitivement la spéculation, retrouver le chemin de la croissance. Mais aujourd’hui, que fait-on ? On continue d’additionner les plans d’austérité. Ce qui va nourrir un peu plus les déficits et la dette. C’est la cacophonie sur le montant du Fonds européen de stabilisation et sur le dosage entre réduction des déficits et soutien à l’activité. Les marchés sont attentifs à tous ces éléments. Il nous manque un vrai leadership.
Je considère donc que, maintenant, il y a une obligation absolue de faire vivre l’union économique à côté de l’union monétaire. Voilà ce qui est en jeu dans la crise actuelle. Si l’on voulait relier le passé et le présent, je dirais qu’aujourd’hui nous payons la facture de l’absence d’initiatives européennes et de résultats concrets depuis dix ans.
En se faisant l’avocat du diable, on pourrait vous faire la remarque suivante : les autorités allemandes – qui ont toujours été prudentes, c’est le moins que l’on puisse dire, sur la question de l’intégration monétaire – réclamaient dans les années quatre-vingt que l’on procède d’abord à une forte convergence économique et qu’ensuite on réalise la monnaie unique. Compte tenu de vos précédentes remarques, la monnaie unique n’est-elle pas venue trop tôt, précipitée par l’unification allemande ?
Élisabeth GUIGOU.- Je ne crois pas.
La monnaie unique – l’union monétaire – était le point d’aboutissement du système monétaire européen, lequel devait être renforcé. Mais, comme je viens de vous l’indiquer, il aurait fallu l’accompagner de son autre versant, économique.
Dans une certaine mesure, il n’est pas faux de dire que nous avons loupé le coche, nous Français. Y compris le gouvernement auquel j’ai appartenu, en 1992-1993. Après l’unification allemande, devant cet événement historique considérable, nous aurions dû dire aux Allemands : « on ne se contente pas de la monnaie car vous, Allemands, vous allez supporter le poids immense de l’unification, pour des années et des années, et nous allons vous manifester notre solidarité ». La Communauté a fait quelques actions, mais finalement assez peu. Or les Allemands étaient demandeurs. Nous aurions dû saisir cette opportunité et nous appuyer dessus pour faire un véritable gouvernement économique de l’Europe.
Un gouvernement économique de l’Europe ?
Élisabeth GUIGOU.- Oui. Mais attention : pas dans le sens d’une autorité supranationale qui imposerait, depuis Bruxelles, ses choix à différents pays. Non. Plutôt une étroite concertation sur les politiques économiques des Etats membres et des initiatives assorties de moyens propres dévolus aux institutions européennes pour financer des investissements d’intérêt commun autorité capable de manifester la solidarité des États membres lors de crise et de définir ensemble comment réagir. Et à partir de là, une habitude de coordination aurait été prise.
Mais nous ne l’avons pas fait…
Cela peut d’ailleurs s’expliquer. En premier lieu, immédiatement après avoir signé le Traité de Maastricht, au tournant de 1991-1992 – ce qui représentait déjà un effort de négociation considérable –, nous sommes entrés dans une tempête économique et monétaire importante, une crise de change suivie d’une vraie dépression économique. Ceci explique au passage que nous ayons perdu les élections en 1993. Bref, nous avons manqué le coche. Je dois dire que Pierre Bérégovoy – qui était d’abord ministre des Finances puis Premier ministre – voulait en priorité une politique du franc fort et préférait, pour des raisons de prestige, courir après le modèle allemand plutôt que de se lancer dans une stratégie économique concertée. A ce moment là, nous aurions pu élaborer une forme de relance concertée. Mais nous ne l’avons pas fait et finalement nous avons contribué à peser sur l’activité.
Je me rappelle parfaitement avoir eu des conversations très approfondies avec Pierre Bérégovoy sur ce sujet, notamment lorsque je suis entrée au gouvernement, comme ministre délégué aux affaires européennes, en octobre 1990. Pierre Bérégovoy était ministre des finances. Il m’a demandé de venir le voir. Ce que j’ai fait. Nous avons passé deux heures dans son bureau. François Mitterrand venait de lui imposer la directive sur la liberté des mouvements de capitaux qui était une des conditions pour réaliser la monnaie unique. Et il me dit : « vous savez, je n’ai jamais été favorable à cette Europe franco-allemande que nous construisons. D’ailleurs, lorsque j’étais avec François Mitterrand, au sein du Parti socialiste, je préconisais plutôt que l’on fasse alliance avec l’Angleterre. Il faut que vous sachiez cela. » Il savait que ce n’était pas mon opinion et je le lui ai dit. Je dois préciser que j’aime les Britanniques. Il est tout à fait agréable de travailler avec eux. Mais il se trouve que sur l’Europe, ils ne partagent pas du tout nos intérêts et cherchent toujours à freiner. Ce frein britannique, on peut le surmonter. À chaque fois que François Mitterrand et Helmut Kohl – avec Jacques Delors – se sont montrés fermes – comme par exemple à Fontainebleau en 1984 –, les Britanniques ont rejoint le train européen moyennant quelques concessions. Mais il faut qu’une volonté politique s’exerce. Si vous n’avez plus d’initiative – comme c’est le cas maintenant – alors les Britanniques font prévaloir leur vision.
En tout cas, en 1992-1993, nous avons manqué de volonté. Nous sortions de la négociation de Maastricht, nous traversions une crise et finalement, nous n’avons pas eu les débats qu’il fallait au sein du gouvernement. Avec les Allemands, nous aurions dû avoir un débat très approfondi sur nos intérêts respectifs, sur ce que chacun attendait, etc. Nous aurions pu dégager des perspectives politiques nouvelles qui auraient pu aboutir à une relance de l’activité économique européenne. Tout cela aurait exigé, évidement, que l’on ait eu recours à un emprunt européen pour financer des investissements à long terme. Ce que personne n’a jamais voulu faire. Et ce qui serait bien utile aujourd’hui. Si je suis critique à l’égard de notre propre action, je n’oublie pas non plus la lourde responsabilité des gouvernements suivants.
La droite a fait de la surenchère dans l’austérité !
Cette difficulté que vous indiquez d’aller de l’avant avec l’Allemagne donne-t-elle raison à Pierre Lellouche lorsqu’il critique la façon dont François Mitterrand a géré l’unification allemande, Pierre Lellouche y voyant une rupture dans le couple franco-allemand ?
Élisabeth GUIGOU.- Pierre Lellouche commet une erreur grossière. Ou plus exactement, il exploite l’histoire de façon politicienne. Il m’avait invitée pour un colloque au ministère des Affaires étrangères, je crois lui avoir dit poliment ma façon de penser et j’ai eu l’impression que les Allemands et les Français qui étaient là étaient d’accord avec moi.
En plus de nos témoignages – le mien, et ceux qui ont vécu cette époque aux côtés de François Mitterrand –, il y a maintenant des travaux précis sur ces sujets qui permettent de se faire une idée. François Mitterrand n’a jamais freiné l’unification. Mais il ne pensait pas que cela irait si vite. Il a surestimé – il l’a dit lui-même – la capacité d’opposition des Soviétiques – Il a voulu encadrer l’unification allemande dans deux règles très claires qu’il a données dès le début et qu’il a toujours dites à Kohl :
– l’aspect démocratique. C’est-à-dire le fait que les Allemands de l’Est le veuillent et le votent, ce qui a été acquis assez rapidement ;
– et le respect des frontières issues de la 2ème guerre mondiale. Et sur ce second sujet, c’est vrai, il y a eu des tensions fortes avec Kohl.
Je me souviens d’une discussion « au coin du feu » au Conseil européen de Strasbourg, en décembre 1989, où Mitterrand a dû insister sur ce point. Et il devra se répéter tout au long du premier semestre 1990. Du reste, à Strasbourg, François Mitterrand n’était pas le plus exigeant car il présidait. C’est Margaret Thatcher et Giulio Andreotti qui se sont chargés de dire à Kohl : vous devez garantir l’intangibilité de la frontière Oder-Neisse. Non seulement l’inviolabilité, mais l’intangibilité. C’est la condition pour que nous acception l’unification. Sur ce sujet, il y a eu un bras de fer franco-allemand et donc une tension
De la même manière, sur la question de la monnaie unique – dont nous parlions à l’instant –, Kohl était hésitant. Il hésitait pour des raisons intérieures : il était harcelé par la CSU – un membre important de sa coalition –, par une grande partie de l’opinion publique allemande, par les patrons allemands, par la Bundesbank, etc. À plusieurs occasions, il a failli revenir sur les engagements qu’il avait pris auprès de François Mitterrand à Évian, en juin 1988. Et cela s’est produit au moment où nous traitions de l’unification. J’ai assisté à plusieurs des rencontres Mitterrand-Kohl de l’époque, notamment avant le sommet de Strasbourg de décembre 1989. François Mitterrand a été très ferme. Il a dit à Kohl – je me souviens en particulier d’un petit déjeuner – : « de toute façon, je vais proposer une date pour que débute une conférence intergouvernementale sur l’Euro. Si vous n’êtes pas d’accord, il faudra que l’on assume tous les deux notre désaccord en public ».
C’est vrai que cela plaçait le Chancelier allemand dans une situation délicate. Je me souviens d’un autre moment, un dîner à l’Élysée, deux mois avant le sommet de Strasbourg. Il y a là le Président français, le Chancelier, Bitterlich, Teltschik, Attali et moi. Comme toujours, François Mitterrand commence par interroger Kohl sur ce qui se passe à l’Est car le Chancelier a toujours des analyses de première main. Mais il ajoute immédiatement : « ensuite, il faudra que l’on parle Europe sociale et conférence monétaire ». Le Chancelier fait le bilan de ce qui se passe à l’Est mais, chaque fois que François Mitterrand voulait changer de sujet, Kohl cherchait à botter en touche. À la fin du dîner, François Mitterrand est devenu tout rouge et il lui dit : « Écoutez Helmut, il faut qu’on arrive à parler de ces sujets, parce que je vous avertis, à Strasbourg, ils seront sur la table. Et il faudra décider. Je ne cèderai pas. » À la suite de quoi le Chancelier nous a envoyé des émissaires de toutes sortes – des patrons allemands notamment – qui nous disaient « c’est formidable votre projet de monnaie unique, mais c’est tellement important qu’il faut prendre le temps ». Le Président les recevait poliment mais à tous il leur disait : « il n’y aura plus d’études, on a tout ce qu’il faut dans le rapport Delors ». Puis Helmut Kohl nous a envoyé Genscher, quelques jours après avoir annoncé son plan en Dix points sur l’unification allemande. François Mitterrand n’y est pas allé par quatre chemins. Sur l’unification, il a martelé sa position : l’unification allemande est un droit, mais vous connaissez notre position sur la question des frontières. Sur l’union monétaire, vous allez redire au Chancelier de ma part que je demanderai la fixation d’une date.
Donc, à aucun moment Mitterrand n’a transigé sur les exigences qu’il avait depuis le début – c’est-à-dire les conditions dans lesquelles devait se faire l’unification allemande. Et c’est là que Pierre Lellouche fait une erreur : bien entendu, l’attitude de François Mitterrand a entraîné des tensions avec les Allemands car ils avaient leurs propres préoccupations, mais à aucun moment il n’a été question pour nous, et pour François Mitterrand, d’empêcher que les deux États se réunissent. Il jugeait au contraire que c’était leur droit de le faire et même que c’était inévitable et qu’il fallait donc que cela se fasse au mieux pour les intérêts de la France et de l’Europe.
J’ajoute qu’une fois que les Allemands ont compris cela – et cela n’était pas facile pour eux d’accepter certaines demandes ! –, nous avons eu l’une des périodes les plus productives de l’histoire du couple franco-allemand autour de la négociation de Maastricht.
Vous dites que ce n’était pas facile pour les Allemands…
Élisabeth GUIGOU.- … Oui. Prenez l’union économique et monétaire. Il fallait la faire, avec ou sans l’unification allemande. Helmut Kohl le savait. Il a toujours dit, comme Adenauer du reste, que c’était le passage obligé pour plus d’Europe politique. Mais pour le faire accepter aux Allemands, c’était très compliqué. Du côté allemand, il y avait de très fortes résistances. Il ne faut pas sous-estimer la portée du sacrifice qu’ils ont fait en acceptant l’Euro. La monnaie – le deutschemark – c’était leur drapeau. Après guerre, il ne restait plus que cela. C’était un grand sujet de fierté nationale.
Donc, lorsque François Mitterrand demandait des concessions au Chancelier sur cette question, ce n’était pas facile. Même chose pour la frontière Oder-Neisse . Mais… d’une certaine façon… en réclamant ces concessions aux Allemands, François Mitterrand a peut être facilité la tâche du Chancelier. En effet, cela a permis à Helmut Kohl de mieux présenter les choses. Il pouvait dire à son opinion publique : il faut faire l’Europe en même temps que la réunification allemande.
Vous-même, à l’époque, avez joué un rôle certain dans cette négociation en prenant la tête de ce que l’on a appelé le Groupe Guigou. Tout n’était donc pas facile.
Élisabeth GUIGOU.- Il s’agissait essentiellement de surmonter la résistance britannique et un peu allemande. Nous étions sous Présidence française – la seconde de François Mitterrand au 2ème semestre 1989. Nous avions six mois entrecoupés par les vacances d’été pour rendre irréversible la marche vers la monnaie unique, c’est-à-dire pour fixer la date de la conférence intergouvernementale qui allait négocier le futur trait. Comment faire ? Nous avions le rapport Delors qui avait été approuvé – contre une forte opposition britannique au Conseil européen de Madrid en juin 1989. Mais l’Allemagne disait : il faut poursuivre les travaux préparatoires, entrer davantage dans les détails. Pierre Bérégovoy et Roland Dumas ont proposé au Président que l’on mette en place un groupe de travail avec les principaux responsables des ministères des Finances et des Affaires étrangères des pays européens, et dont j’exerçais la présidence. D’où le « groupe Guigou ». Il faut dire que ce groupe était un peu particulier. Y siégeaient ensemble les directeurs du Trésor – ministère de l’Économie et des finances – et les directeurs politiques du quai d’Orsay. On n’avait jamais réuni ces hauts fonctionnaires ensemble pour travailler et cela ne s’est jamais reproduit depuis.
Dans ce groupe nous avons d’abord eu des discussions avec les Allemands. Nous, Français, nous avions alors le soutien des Espagnols et des pays du sud de l’Europe. Il s’agissait de définir le dosage des objectifs de l’union économique et monétaire. Nous trouvions certes nécessaire la lutte contre l’inflation et pour la stabilité des prix, mais nous voulions aussi la promotion de la croissance et du plein emploi. Et comme je vous l’ai dit, nous avons trouvé la bonne rédaction. Je ne dirai pas que nous avons eu des difficultés réelles avec les Allemands, mais enfin on a discuté fermement. Si bien que nous avons trouvé un accord.
Mais le principal problème, c’était de surmonter l’opposition britannique, ce que nous avons réussi à faire dans ce groupe. Les Britanniques, en effet, ont commencé par menacer de ne pas siéger. Mais nous avons dit que nous, nous souhaitions de toute façon nous réunir. Ils sont finalement venus. Ensuite, nous leur avons fait admettre qu’il y avait des conclusions du rapport Delors qui étaient de simples constats de fait et qu’ils ne pouvaient pas les récuser. Et nous ajoutions pour les Britanniques : « que vous vouliez faire la monnaie unique ou non, c’est un choix politique. Mais vous ne pouvez pas nier que si l’on veut faire cette Union, il faut le faire comme cela. » Et par étapes, nous avons amené les Britanniques à définir avec nous la future union monétaire. Ensuite, leur pragmatisme habituel a joué. Ils ont compris que les autres voulaient avancer. Il était donc plus utile pour eux d’être dans la négociation qu’au dehors, quitte à ne pas adopter la monnaie unique.
Mais une fois la négociation bien avancée, Bérégovoy – qui a été excellent – leur a dit avec Delors : « vous ne voulez pas la monnaie unique, nous n’allons pas vous obliger, mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de la faire. » Le groupe Guigou a simplement apporté cela : faire admettre les étapes techniques du rapport Delors. Ensuite, nous pouvions dire que nous avions réalisé les travaux préparatoires nécessaires.
Lors de cette négociation sur la monnaie unique, trois dossiers étaient liés entre eux : la libéralisation du mouvement des capitaux, la création d’une monnaie unique, l’harmonisation fiscale. Or, l’harmonisation fiscale est restée lettre morte.
Élisabeth GUIGOU.- Je dois dire que les Allemands, initialement, n’étaient pas hostiles à ce projet. Ce n’est pas Kohl qui a refusé. Au contraire, il a même demandé à Jacques Delors, qui présidait la Commission européenne, de présenter aux États membres un projet de directive. Malheureusement, elle a été refusée par le Luxembourg, pour les raisons que vous savez. C’est dommage car le projet était très ambitieux. Jacques Delors avait même proposé une retenue à la source avec un seuil minimal d’imposition dans tous les États membres.
Ensuite, vous le savez, nous avons perdu les élections en 1993 et il n’y a plus eu aucune impulsion politique dans ce sens là de la part des gouvernements français de droite. Lesquels ont d’ailleurs surenchéri sur le pacte de stabilité. Nous, avec Bérégovoy, nous avions résisté à cette tendance, voulue par les Allemands, de durcir les disciplines du Traité. Nous savions qu’il fallait inventer un mécanisme de sanction qui n’existait pas, mais de là à en rajouter par rapport aux disciplines déjà incluses dans le traité, nous le refusions. La droite libérale arrive : elle le fait.
Et c’est la même histoire que l’on est en train de revivre : on a des difficultés économiques, on a moins de croissance, eh bien on en rajoute dans l’austérité. Et cela au risque de casser la croissance et de nourrir davantage les déficits. C’est d’ailleurs comme cela qu’on arrive à la dissolution de 1997 : la France avait mené exactement la même politique que celle qui est menée actuellement. Allègement d’impôt pour les plus riches, étouffement des administrations, etc. Ce qui nous ramène au début de notre discussion : il nous faut un vrai plan de relance des investissements au niveau européen en même temps que l’on restreint les déficits et la dette et, réaliser davantage d’harmonisation fiscale entre les États membres.
Comment pourrait-on y parvenir aujourd’hui ? En utilisant le levier franco-allemand comme à l’époque Mitterrand- Kohl ? Nos partenaires allemands le veulent-ils ? Est-ce toujours une priorité dans une Europe à 27 ?
Élisabeth GUIGOU.- Le couple franco-allemand va très mal. Il est vrai que l’union européenne a beaucoup changé en passant de 12 à 27 États membres. La cohésion est plus difficile. C’est un fait les négociations sont plus compliquées et les compromis plus difficiles. Par ailleurs, depuis l’effondrement du bloc communiste, l’Allemagne s’est tournée vers l’Est. Réunifiée, son influence est plus importante que celle de l’ancienne RFA. Et puis, lorsqu’Helmut Kohl est parti, son remplaçant, Gerhard Schröder, voulait clairement en finir avec la vieille culpabilité allemande. On peut comprendre cela. Les autorités allemandes ont commencé à être plus sensibles qu’auparavant à l’idée qu’il ne fallait pas toujours que l’Allemagne paie pour tous les autres. Là aussi on peut comprendre : il arrive un moment où il faut savoir mettre fin aux dettes de guerre. Tout cela est parfaitement exact. Aujourd’hui, dans la crise, l’Allemagne estime avoir fait, seule, les réformes et efforts nécessaires et ne veut pas payer pour les « pays du Club Med » comme les désignait méchamment un ancien Ministre des Finances allemand.
Mais ce constat n’empêche rien ! Il faut réinventer les bases de l’accord franco-allemand. Ce que personne n’a jamais fait. Nous devons trouver une nouvelle forme d’accord entre nos deux pays et d’entente entre leurs dirigeants. Un nouveau deal dans lesquels chacun trouverait son intérêt. Or, personne ne semble vraiment s’atteler à cette tâche. D’abord parce que cela a tout de suite été très mal entre Chirac et Schroeder. Le Président français s’est tout de suite opposé à lui – sur la Politique agricole commune, une fois de plus, et Schröder lui en a beaucoup voulu. Il aurait fallu trouver un accord intelligent avec les Allemands avant d’aller à l’affrontement. Après ce mauvais départ, il a fallu recoller les morceaux, et on a perdu un temps précieux. Si bien que la relation franco-allemande a avancé cahin-caha, ce qui n’est déjà pas si mal mais empêche toute impulsion politique d’envergure. Car dans ce cas, il faut de la confiance de part et d’autre.
Sous le gouvernement de Lionel Jospin, nous avions des ambitions, mais nous étions en pleine cohabitation. Nous ne voulions pas, nous, donner l’image d’une France divisée au niveau international. Il fallait donc composer avec Chirac, toujours très impulsif, souvent désordonné. Et là encore, cela anesthésiait toute initiative d’envergure. On l’a vu au moment du Traité de Nice où le Président continuait d’attaquer les Allemands mais aussi les Polonais. Notre pays brouillé avec la Pologne ! Alors que nous avions avec ce pays un acquis historique renforcé par la position très ferme de François Mitterrand sur la frontière Oder-Neisse. Tout cela a été dilapidé en l’espace de quelques années.
Toutefois, il y a eu l’initiative de Fischer ?
Élisabeth GUIGOU.- C’est exact. J’avais suggéré à Lionel Jospin de prendre une initiative forte avec Schröder. Le Premier ministre est particulièrement en pointe sur les questions économiques lorsqu’on est en cohabitation. Déjà, les difficultés se profilaient et nous aurions pu proposer d’avancer, justement sur l’Union économique. Mais cela n’a pas abouti. Lionel Jospin jugeait impossible une telle initiative qui serait compromise par Jacques Chirac. Vous savez, les périodes de cohabitation ne permettent pas de grandes initiatives.
Quant à Joschka Fischer, nous avions avec lui de bons contacts. C’était un bon ministre. Et son discours était très intéressant. Il nous disait, en se plaçant en quelque sorte sur le plan historique, que nous avions eu l’Europe du traité de Vienne, des alliances qui se faisaient et se défaisaient au gré des guerres fratricides ou chaque pays d’Europe a, à tour de rôle fait la guerre à tous les autres, etc., et qu’il ne fallait pas recommencer [Voir : « Discours de Joschka Fischer sur la finalité de l’intégration européenne (Berlin, 12 mai 2000) ». « De la Confédération à la Fédération – réflexion sur la finalité de l’intégration européenne »,[ Discours prononcé par Monsieur Joschka Fischer à l’Université Humboldt de Berlin, le 12 mai 2000. Avec un discours prononcé le 12 mai 2000 à l’Université Humboldt de Berlin, Joschka Fischer, ministre allemand des Affaires étrangères, participe à titre personnel au débat sur l’avenir de l’Union européenne en proposant la conclusion d’un traité constitutionnel portant création d’une Fédération européenne basée sur le principe de subsidiarité.]].
Partant de ce constat, il en appelait ni plus ni moins à la création d’une Europe fédérale, aux Etats-Unis d’Europe avec traité constitutionnel, etc. Vous le savez, je suis une Européenne fervente. Mais cela ne m’empêche pas de faire attention aux mots que l’on emploie. Je pense ainsi que Fischer – comme Chirac d’ailleurs – a parlé trop tôt. Une Europe fédérale ? Les Européens ne sont pas encore mûrs pour cela. L’Europe doit d’abord être une fédération d’états-nations. Je rappelle que le traité constitutionnel qui a été présenté en 2005 n’était pas une constitution. C’était un traité, ratifié par chaque parlement national et non par le Parlement européen. Bref, nous allons vers une fédération d’états-nations. Lorsque l’on cherche à avancer trop vite, les peuples ne suivent pas. C’est une des raisons, pas la seule, qui explique l’échec du référendum de 2005. Il fallait dire : nous ne sommes pas les Etats-Unis d’Europe et nous ne le serons jamais car nos vieilles nations ont une histoire, des langues, une culture. Mais nous pouvons être une fédération d’Etats Nations soudée et cohérente. Nous aurions dû nous limiter à l’essentiel, c’est-à-dire ce qui donnait sa force symbolique au texte : le préambule, le fonctionnement, la charte des droits fondamentaux, etc. C’est ce qui a été sagement fait par le traité de Lisbonne qui distingue le traité d’Union européenne avec le préambule, la Charte, les institutions et le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
Avec Joschka Fischer nous avons très bien travaillé – il s’entendait bien, d’ailleurs, avec Hubert Védrine – sur l’Europe. Mais nous ne devions pas le suivre sur cette voie, c’est-à-dire encourager cette fuite en avant fédéraliste. Je pense que cela reste un objectif. Mais nous ne serons jamais les États-Unis d’Europe. Il y aura des éléments de fédéralisme forts comme avec la monnaie unique. Je souhaite d’ailleurs qu’il y en ait d’autres, sur la Défense par exemple. Mais nos nations resteront des entités fortes pour une raison très simple : la nation est le lieu principal de l’expression de la citoyenneté. Ce qui n’empêche pas d’avoir des politiques extrêmement ambitieuses, des coopérations structurées et même des éléments fédéraux.
François Mitterrand partageait cette vision ?
Élisabeth GUIGOU.- Il était extrêmement enthousiaste vis-à-vis de l’Europe. Il l’a raconté dans ses livres – le Congrès de La Haye, etc. –, cela correspondait à des engagements anciens chez lui. Chaque fois qu’il voyait Helmut Kohl, ils parlaient de la guerre. Il y avait un accord profond entre eux sur ce sujet. La seule façon de dépasser ces drames, c’était l’Europe. Peut être est-ce ce rapport à l’histoire qui a manqué par la suite… mais après tout, moi je n’ai pas connu la guerre et je suis sur la même longueur d’onde. En tout cas, cela les rendait, l’un et l’autre, très ambitieux et en même temps très pragmatiques sur la mise en œuvre politique, sur le chemin à emprunter. Ainsi, deux ou trois fois, le Président m’a dit : « faites attention, si on va trop vite… » J’étais ministre des Affaires européennes et je voulais faire ratifier Schengen. Une disposition qu’il avait voulue et soutenue. Et pourtant, il m’a recommandé la prudence car il voulait éviter un fiasco politique… Et, prudemment, j’ai finalement réussi à convaincre Charles Pasqua au Sénat… Voilà un exemple. Mais il y en a d’autres. Prenez le projet Spinelli. Il l’a approuvé. Mais pour lui, il s’agissait d’une perspective. Ce qu’il a d’ailleurs dit à Spinelli lui-même. À ses yeux, le projet venait trop tôt. À d’autres moments, il pensait au contraire que l’on pouvait avancer. Ministre des Affaires européennes, je l’ai souvent vu arbitrer en faveur de la Commission européenne. Prenez l’exemple des positions de Bercy sur l’Union économique et monétaire. On le sait, Pierre Bérégovoy était pour le moins timide sur le sujet, comme son administration du reste qui avait concocté dans son coin un projet de traité où l’on faisait non plus une monnaie unique mais une monnaie commune – une sorte de SME renforcé en quelque sorte. À un moment donné, il a bien fallu élaborer une position française unique. Pour ma part, je plaidais pour la monnaie unique mais aussi pour que la Commission conserve – comme dans toutes les autres affaires économiques – son pouvoir de proposition, de contrôle et de sanctions. Bercy était sur un autre schéma, plus intergouvernemental. Eh bien, François Mitterrand, après nous avoir convoqués dans son bureau et après que nous nous soyons expliqués, a tranché en ma faveur. Il n’a pas hésité. Mais en même temps, il n’a jamais considéré que la Commission devait décider à la place des États membres. Il a voulu conserver un Conseil européen fort pour les grandes orientations.
Bref, il était à la fois audacieux et prudent, si je puis dire. Il cherchait à avancer constamment – il prenait sans cesse des initiatives – mais n’oubliait pas que la souveraineté des peuples continuait de s’exprimer dans les États européens. D’une certaine façon, il parvenait ainsi à dépasser la querelle entre fédéralistes et les inter- gouvernementalistes.
D’ailleurs, c’est cela qu’il faut faire. À l’évidence, si l’on veut faire l’Europe et éviter qu’elle soit marginalisée dans le monde d’aujourd’hui, il faut de toute façon renforcer ses institutions, son fonctionnement, mais les gouvernements nationaux doivent continuer de s’exprimer. Au Conseil européen, ils le font. Dans les Conseils aussi. Et il faut renforcer évidemment la Commission. Ou plutôt que celle-ci prenne ses responsabilités. Quand la Commission est dirigée par quelqu’un qui théorise l’impuissance de la Commission…
C’est la volonté politique qui manque aujourd’hui ?
Élisabeth GUIGOU.- Je le constate. Vous avez, d’une part, les traités. Ils peuvent beaucoup car ils sont un socle indispensable. Mais il y a surtout ce que l’on fait des Traités. Ce que veulent les acteurs eux-mêmes. Regardez ce que pouvait le couple franco-allemand. Regardez ce que nous avions fait, y compris avec les Britanniques, en matière de Défense. À l’initiative d’Alain Richard, nous nous étions quand même mis d’accord aux Conseils européens de Hanovre et d’Helsinki sur une force d’action rapide de 60 000 hommes. Depuis ? Personne n’a concrétisé cela. Pourquoi ? La réponse, c’est le manque de volonté politique.
Que faudrait-il faire ? Dans votre récent discours à l’Assemblée nationale, vous faites des propositions très concrètes sur le plan européen.
Élisabeth GUIGOU.- Oui. Très concrètes, comme je vous l’ai dis, par exemple en matière de politique économique. Mais sur ce point, les Socialistes doivent encore travailler. Pour ma part, je contribue à tout cela. Nous avons eu une Commission des résolutions qui a duré jusqu’à deux heures du matin au sein du Parti. J’y ai fait valoir un certain nombre de points. D’abord, sur la question du protectionnisme, j’ai dit que ce serait une erreur profonde que l’Europe se comporte comme un ghetto de pays riches. Et donc que ce serait une erreur de le dire aux Français. Cela ne se fera pas, parce qu’on n’aura pas d’entente entre Européens et ensuite parce que nous serons bloqués par l’OMC. En revanche, nous devons évidement débattre avec nos partenaires de la définition de normes sociales et écologiques pour qu’on arrête de les niveler par le bas. C’est ce que l’on appelle le juste échange pour éviter les formes de concurrence déloyales. Sur ce sujet, il ne faut pas se résigner, pas plus qu’il ne faut se résigner à la désindustrialisation et aux délocalisations industrielles. Mais cela ne se décrète pas !
Il y a d’abord énormément à faire entre Européens. D’autres regardent vers la Chine. Je constate que beaucoup en reviennent parce le coût de la main d’œuvre est bas, certes, mais c’est le seul avantage. Il n’y a pas de qualité, c’est loin, etc. Moi, je considère qu’il faut nous tourner aussi vers les pays d’Afrique. Il suffit pour s’en convaincre de regarder une carte du monde. Aujourd’hui, pour peser sur le plan politique et économique, il faut atteindre le milliard d’hommes. L’Union européenne ? 450 millions, plus ou moins coordonnés. Avec les pays du sud de la Méditerranée ? On arrive à 700-800. Mais ajoutez les Africains, alors, vers 2030-2050, cela constituera un ensemble de 2,5 milliards d’hommes sur 9 milliards. Le quart de la population mondiale. Il faut commencer à réfléchir à tout cela.
C’est ce que l’on devrait faire dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée : aboutir à une première zone de développement économique partagé. Je ne vois pas ce qui nous empêche, par exemple, de négocier à cette échelle des quotas de pêches, en impliquant les pays du Maghreb et la Mauritanie. Il faut dépasser les aspects commerciaux et investir massivement au sud de la Méditerranée. Cela créera des emplois là-bas et aussi chez nous. Sinon, ce sera trop inégal en faveur de l’Union européenne. Il faudra d’ailleurs rééquilibrer les choses. Mais nous y trouverons notre compte, nous Européens, si dans le même temps nous réalisons des investissements là-bas. Quand je dis développement partagé, je dis qu’il faut qu’il y ait des entreprises françaises grosses, petites et moyennes, agricoles et industrielles, qui se disent : notre intérêt c’est d’investir là bas, pour pouvoir rapatrier de la valeur ajoutée et des profits en France, et recréer des emplois que ces pays du sud ne peuvent pas créer chez eux parce qu’ils n’ont pas encore – pas encore – les technologies, les savoir-faire, etc.
Qu’ont fait les Allemands dans les pays de l’Est ? Exactement cela. Ils ne conçoivent pas leur développement à l’échelle de l’Allemagne ou à l’échelle de l’Union, mais au-delà vers la Pologne, l’Ukraine, la République Tchèque, une aire de production de plus de 150 millions d’habitants. L’économie allemande touche aujourd’hui les dividendes de cette politique. Ils ont gardé chez eux les segments à forte valeur ajoutée. Ils ont investi, y compris en délocalisant quelque fois. Mais du coup, ils ont recréé des emplois en Allemagne.
Je ne dis pas que tout cela est simple. Mais il faut aller dans cette voie. J’ajoute que, grâce à ces développements partagés, nous pourrions faire levier sur la gouvernance des pays du sud, car on étouffe dans ces pays ! Les populations n’en peuvent plus : régimes corrompus, système de santé et d’éducation défaillants, etc. En d’autres termes, nous pourrions efficacement contribuer au renforcement de la démocratie dans toute cette zone. D’ailleurs, si nous ne le faisons pas, ce sont les Chinois qui prendront notre place avec des intentions très différentes.
Commençons d’abord par de petits pas. Puis nous verrons ces pays élever leurs normes sociales et écologiques. Ils seront obligés de le faire : pour la sécurité alimentaire, pour la lutte contre la désertification. Nous les aiderons dans ce sens.
Une fois qu’on en sera là, l’Europe et l’Afrique pourront se présenter ensemble devant l’OMC et dire : la concurrence déloyale de pays qui ne respectent aucune de ces normes n’est plus possible. Je pense notamment aux pays asiatiques.
Moi je considère que c’est la seule façon de parvenir à un « juste échange ». C’est le terme employé dans le texte de la Convention internationale qui s’est tenue au sein du Parti socialiste. Je suis persuadé que c’est vers cela qu’il faut aller. Si nous voulons résister à des pays comme la Chine où il n’y a aucune protection et des salaires misérables, il faut parvenir à créer un rapport de force. Car l’autre voie, celle du protectionnisme, nous conduirait à une autarcie que notre économie ne supporterait pas. Et puis quel sens cela a-t-il de refuser des visas aux étudiants du Maghreb et d’Afrique ? Ils sont hélas de plus en plus nombreux à aller chercher en Inde, aux Etats-Unis, en Chine ! On marche sur la tête.
Votre projet est à long terme. Que faire dans l’immédiat ?
Élisabeth GUIGOU.- Cela ne se fera pas en un jour : raison de plus pour commencer. Le rôle du politique, c’est aussi de voir à long terme. Sinon, on court d’élections en élections. Encore une fois : si nous ne faisons pas cela, nous serons perdants sur toute la ligne. Nous disparaîtrons de l’histoire car nous ne parviendrons à maîtriser ni les changements économiques qui s’annoncent ni les mouvements de population. Quant à l’Afrique, elle tombera sous la domination d’autres pays qui pratiquent un nouveau colonialisme. Regardez, dès à présent, les révoltes d’ouvriers algériens contre les ouvriers chinois qui viennent construire les ports et les autoroutes là bas !
Et quand je dis que l’Europe disparaîtra de l’histoire, on en voit déjà les prémices. À Copenhague, lors de la dernière négociation sur le climat, nous n’étions plus à la table des négociations.
Je pense donc que nous n’avons pas le choix et qu’en réalité nous disposons d’une fenêtre d’opportunité qui ne durera pas éternellement.
Bref, il va nous falloir regarder de l’autre côté de la Méditerranée avec d’autres yeux.
Il va falloir un militantisme acharné pour faire passer ces idées dans la population française.
Élisabeth GUIGOU.- Je ne le crois pas. Quand je parle de cela en Seine-Saint-Denis, et même dans le Cantal, on me comprend. Si vous êtes capable de sortir d’une vision à court terme, d’expliquer aux Français ce qu’est votre vision de l’avenir, que les choses vont se faire progressivement et sur la durée, alors cela marchera. C’est cela avoir un projet politique. Ce n’est pas autre chose. Et François Mitterrand savait faire cela !

- Madame Guigou est aujourd’hui députée dans la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis et membre de la Commission des affaires étrangères. Lorsque nous l’avons rencontrée, elle venait de faire une déclaration de politique extérieure importante devant l’hémicycle.
- Le Conseil Éco-fin est le Conseil des ministres de l’économie et des finances des États membres de l’Union européenne. Il examine et vote les grandes décisions européennes.
- Croissance, compétitivité, emploi. Les défis et les pistes pour entrer dans le 21ème siècle, COM (93) 700 final, Bruxelles, Commission européenne, 1993. Les conclusions de ce Livre blanc sont approuvées par le Conseil européen du 11 décembre 1993.
- Le 17 juin 2010, le Conseil européen adopte un document de travail intitulé « Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive » dont l’objectif est de répondre à la crise économique que traverse l’Union européenne. Voir : [Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive
- En février 2001, en effet, le Conseil Eco-fin de l’Union européenne adressait une recommandation au gouvernement irlandais afin qu’il réduise son taux d’inflation.