Ci-après vous trouverez la préface de Jean-Michel GUIEU et Georges SAUNIER 1 publiée à l’occasion de la réédition du Coup d’État permanent de François Mitterrand, aux éditions Les belles lettres.

En s’attaquant rudement au régime gaulliste par le biais du pamphlet, François Mitterrand utilise à dessein un genre littéraire où ont excellé avant lui d’illustres littérateurs auxquels il songe forcément. Peut-être se rêve-t-il en un nouveau Pascal, dont il est un lecteur admiratif des Provinciales, ou plus sûrement en héritier de Victor Hugo, qui utilisa jadis tout son immense talent à dénoncer « Napoléon le petit » : lui-même n’hésite pas à comparer explicitement de Gaulle « à un Louis Napoléon Bonaparte qu’habiteraient les vertus bourgeoises d’un Louis-Philippe 1er » (p. 85)…
Car si François Mitterrand est un opposant de la première heure au nouveau régime gaulliste, il semble vouloir, dans Le Coup d’État permanent, paru en mai 1964, faire franchir à son combat une nouvelle étape : en choisissant l’arme littéraire pour affronter le Général, il veut à son tour prendre date avec l’Histoire, ayant l’intuition que son propre destin doit passer par une opposition encore plus irréductible au gaullisme, quitte à en caricaturer la présentation de façon à susciter la polémique.
Toutefois, François Mitterrand président de la Ve République ne désavouera jamais le François Mitterrand pamphlétaire. Bien qu’il jugeât inutile de « continuer de promener, vingt ans plus tard, une polémique qui appartient à l’histoire », il n’en considérait pas moins Le Coup comme son meilleur ouvrage.
Et pourtant quand le livre sort en librairie, le duel de Gaulle-Mitterrand semble fort déséquilibré : de Gaulle est tout-puissant et François Mitterrand n’est qu’un adversaire parmi d’autres, une personnalité de l’opposition certes, mais loin d’être centrale, au sein d’une gauche divisée et affaiblie. Six ans plus tôt, le changement de régime a même provoqué un sérieux revers dans le parcours politique de François Mitterrand alors qu’il était l’une des figures importantes de la IVe République, nommé onze fois ministre, en raison du rôle d’appoint que jouait dans toute majorité parlementaire l’Union démocratique et socialiste de la résistance (UDSR), qu’il présidait depuis 1953. Mais le retour au pouvoir de de Gaulle a provoqué le naufrage de son parti et François Mitterrand, après avoir vainement tenté d’entrer au Parti socialiste autonome, a pris la tête en 1964 d’une nouvelle petite formation politique, la Convention des Institutions Républicaines, réunion de plusieurs clubs politiques issus de la gauche républicaine et socialiste. Au moment où sort le livre, il a retrouvé depuis deux ans son siège de député de la Nièvre qu’il avait perdu en novembre 1958 lors du raz-de-marée gaulliste. La seule défaite de sa carrière parlementaire…
De Gaulle est, lui, selon la formule du président René Coty, « le plus illustre des Français », le libérateur de la patrie, l’homme du recours qui a écarté le spectre de la guerre civile en 1958, le monarque à l’autorité quasi absolue d’une république refondée, le leader de la première formation politique du pays, forte d’une majorité écrasante à l’Assemblée Nationale ! En se voulant le meilleur et inlassable procureur du pouvoir gaulliste, François Mitterrand n’a pas fait le choix de la facilité, mais le contentieux entre les deux hommes est suffisamment ancien et profond pour en expliquer la virulence.
Cette rivalité a pris, en effet, naissance durant la Seconde Guerre mondiale, période dont il est souvent question dans les pages du Coup d’État permanent, notamment lorsque François Mitterrand évoque le régime de Vichy en osant la comparaison avec la nouvelle république gaullienne : « Pétain,de Gaulle, Vichy, la Ve République. Tout oppose et tout rapproche ces hommes, ces régimes ». Si la trajectoire de François Mitterrand durant le conflit mondial est bien connue à l’époque où paraît le livre, y compris la « fameuse » affaire de la francisque, les observateurs retiennent surtout son action à la tête d’un mouvement de résistance regroupant les prisonniers de guerre (PG) qui se donne pour tâche de les soustraire à la propagande collaborationniste et de lutter contre l’occupant. C’est à l’intérieur de ce mouvement que Mitterrand devient Morland, lequel s’envole pour Londres à l’automne 1943 afin d’établir un contact direct entre son mouvement et la « France libre ». De la capitale anglaise, il part pour Alger où il retrouve Henri Frenay, figure importante de la résistance qui le conduit auprès du général de Gaulle. La rencontre, souvent commentée, a lieu début décembre 1943, villa des Glycines. L’entretien reste « aimable » et aboutit à un accord pour que fusionnent les différents mouvements de résistance de prisonniers. Mais elle est aussi lourde de malentendus : le jeune Charentais reste attaché à la spécificité de la communauté « PG », une communauté qui lui a donné une « nouvelle éducation » et où il a connu sa « première rencontre véritable avec d’autres hommes » ; à l’inverse, l’homme du 18 juin ne vise que l’efficacité de réseaux structurés sur le même mode. Au final, un mouvement « PG » unifié sera effectivement créé, de Gaulle reconnaissant les mérites dans la résistance de ce Mitterrand-Morland en le nommant brièvement, à l’été 1944, « commissaire général aux prisonniers de guerre » et en citant son nom dans ses Mémoires de guerre. De son côté, François Mitterrand n’hésitait pas à saluer l’action et l’importance historique du général pendant la guerre. Cependant, leur affrontement, qui n’est finalement qu’un épisode parmi d’autres des divergences entre résistances extérieure et intérieure, aboutit à une dualité des sentiments de François Mitterrand à l’égard du Général : une reconnaissance, certes, mais teintée de réserve. Il nous semble que ce point est essentiel pour comprendre la relation Mitterrand-de Gaulle et en particulier les formules sans concession que le lecteur découvrira dans le Coup d’État. Par ce biais, François Mitterrand s’attaquait à l’essence même du régime gaulliste : le Général tirait de son rôle historique pendant la guerre toute la légitimité de son action politique durant les années cinquante et soixante. C’est en son nom qu’il déclarait incarner naturellement la nation. Or, François Mitterrand n’adhérait tout simplement pas à cette thèse.
Du reste, la divergence entre François Mitterrand et les gaullistes s’exprima dès l’après-guerre et de différentes manières : dès 1949, il s’inquiétait de la création du RPF, un parti qu’il jugeait trop attaché à la défense du grand homme ; dans la Nièvre, sa terre d’élection, les gaullistes s’opposaient à lui ; de même sur les questions européennes, François Mitterrand et les gaullistes ne partageaient pas la même analyse. Mais c’est certainement au sujet de la question coloniale que l’opposition fut la plus frappante, celle-ci fait d’ailleurs l’objet de nombreux développements dans Le Coup. Sensible à l’aspiration des peuples à plus de liberté, François Mitterrand fait partie de ceux qui imaginent des formes nouvelles d’association entre la métropole et l’empire. Lui-même ne parle pas d’indépendance mais souhaite l’instauration d’une communauté fédérale entre la France et ses possessions. Cette marche vers une sorte de Commonwealth à la française, il commence à en parler à la suite de quelques voyages en Afrique, à la fin des années 1940, puis comme ministre – de la France d’outre-mer, de l’Intérieur, de la Justice, etc. Il écrit même deux livres sur le sujet (Aux frontières de l’Union française en 1953, Présence française et abandon en 1957), prononce une multitude de discours, à l’Assemblée Nationale et ailleurs, et tente de mettre en œuvre, lorsqu’il le peut, des politiques de développement et d’égalité entre colons et colonisés, n’hésitant pas à ouvrir le dialogue avec des formations politiques d’outre-mer tel que le RDA africain. Or, à chaque fois, il trouve en face de lui, pour s’opposer à ses idées et à ses réformes, les gaullistes, ce qui les place à ses yeux dans la situation de pyromanes qui, par leur opposition à toutes les réformes en Asie et en Afrique, ont fait échouer l’évolution pacifique des relations entre la métropole et ses colonies et qui, revenus au pouvoir, voudront se faire les braves pompiers de l’incendie qui s’est déclaré outre-mer, tout en ne trouvant pas de mots assez durs contre la politique de leurs prédécesseurs.
Sur la question algérienne particulièrement, François Mitterrand s’est montré de plus en plus critique sur l’évolution des « événements » d’Algérie, dont il est largement question dans ce livre. Bien qu’ayant déclaré en 1954, alors qu’il est ministre de l’Intérieur de Mendès, que « l’Algérie, c’est la France », il envisage de réformer les départements. Ministre de la Justice du gouvernement Guy Mollet, il en soutient la politique de force – mais pas la torture – et imagine progressivement de faire évoluer les départements d’Algérie vers une sorte de fédéralisme franco-africain. Mais ni Guy Mollet – dont François Mitterrand dénonce, dans le secret du conseil des ministres, l’évolution politique – ni les gouvernements suivants, auxquels il refuse de participer, ne s’inscriront dans cette démarche, pris au piège qu’ils sont des « ultras » de l’Algérie française, ceux-là même qui dénoncent toute évolution du statut algérien comme une trahison.
C’est précisément le coup de force militaire à Alger le 13 mai 1958 et la constitution d’un comité de salut public dirigé par le général Massu qui vont provoquer le retour au pouvoir de de Gaulle et précipiter François Mitterrand dans l’opposition irréductible au Général et à ses partisans. Il ne manque pas d’ailleurs de dénoncer dans ce livre, comme il l’a fait depuis 1958, le « coup d’état » du 13 mai et les origines factieuses du pouvoir gaulliste : « entre de Gaulle et les républicains il y a d’abord, il y aura toujours le coup d’état » (p. 75). Il faut noter que le refus mitterrandien vise moins le retour au pouvoir de de Gaulle en tant que tel – car cette hypothèse circulait dans les milieux politiques depuis quelques mois déjà et François Mitterrand, notamment dans un article du Monde de mars 1958 ne la repoussait pas – que les conditions dans lesquelles il s’est réalisé. François Mitterrand reproche au Général de ne pas avoir désavoué publiquement les putschistes d’Alger et refuse, comme nombre de républicains de l’époque (Pierre Mendès France, Alain Savary, Gaston Defferre et quelques autres), de céder au chantage : « De Gaulle ou les parachutistes ».
La rupture avec de Gaulle est consommée, et lorsque le 1er juin 1958 l’Assemblée l’investit dernier président du conseil de la IVe République, François Mitterrand exprime publiquement son opposition. Et son analyse anticipe déjà largement toute la thèse au cœur du Coup d’État permanent : « en droit, [de Gaulle] tiendra son pouvoir de la représentation nationale ; en fait, il le détient déjà du coup de force. »
Il s’agit là de la conviction profonde de François Mitterrand et d’un certain nombre de républicains d’alors. Aujourd’hui, le terme de coup d’état est écarté par les historiens – dans la mesure où de Gaulle lui-même n’était pas en contact direct avec les séditieux d’Alger et qu’il a manifesté le souci de respecter la légalité lors de son retour au pouvoir. Il n’en reste pas moins qu’il s’appuya sur le coup de force du 13 mai dans lequel certains de ses partisans furent impliqués.
Aussi, lorsque les 2 et 3 juin l’Assemblée confie au gouvernement de de Gaulle le soin de rédiger une nouvelle constitution, François Mitterrand refuse de joindre sa voix à ce qu’il considère comme l’établissement d’un pouvoir autoritaire. Sans aucun doute, le souvenir des 80 parlementaires qui avaient refusé d’accorder les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940 a joué dans son attitude d’opposition : « Il a voulu être des quatre-vingts de 1958 » (Éric Duhamel).
Dans la même logique, François Mitterrand appelle à voter contre la nouvelle constitution soumise au référendum le 28 septembre 1958 et, finalement, massivement approuvée par les Français. Est-ce à dire qu’il souhaitait en revenir à un régime parlementaire du type de celui de la IVe République ? Le lecteur s’étonnera peut-être de trouver dans tout un chapitre, le premier, une charge virulente contre cette défunte république et son personnel politique. Il ne faut pas oublier que François Mitterrand a voté contre la Constitution de 1946, lui préférant un régime plus fort, et que, bien qu’incarnant l’une de ses figures montantes, il n’a pas manqué de critiquer ce qu’il appelle ici ce « régime anachronique » (p. 35), soutenant ses différentes tentatives de réformes.
C’est donc moins le texte de la Ve République que la lecture et surtout la pratique qui en sont faites par le pouvoir gaulliste que François Mitterrand condamne violemment dans Le Coup d’État permanent : intervention directe du président de la république dans les affaires de justice ; centralisme excessif ; bureaucratie ; affairisme ; décisions liberticides – à l’égard de la presse, en créant des cours de justice ad hoc, des lois d’exception, en abusant de la garde à vue, en soumettant les juges à ses ordres, en instaurant progressivement un régime policier ; en ignorant superbement le Parlement, en le contournant ; en traitant ses ministres comme des exécutants, et d’abord le premier d’entre eux, etc. Voilà que sous la plume de François Mitterrand, le gaullisme devient « de Gaulle plus la police » (p.221) et qu’il appelle « le régime gaulliste dictature parce que, tout compte fait, c’est à cela qu’il ressemble le plus » (p. 86).
Le ton outrancier et notamment les formules sans concession que l’on trouvera dans le Coup ne sont pas sans rappeler la façon dont François Mitterrand se défend lors de l’affaire du vrai-faux attentat de l’Observatoire dont il ne fait aucun doute qu’elle a alimenté la méfiance, pour ne pas dire l’hostilité, de François Mitterrand à l’égard du régime.
Dans la soirée du 15 octobre 1959, après une course-poursuite en voiture, François Mitterrand a, en effet, été mitraillé dans les jardins de l’Observatoire. Quelques jours plus tard, un député d’extrême droite, Robert Pesquet, affirme, preuves en main, qu’il s’agit en réalité d’une machination montée de toutes pièces par François Mitterrand pour se faire de la publicité. Dès le lendemain, l’élu de la Nièvre est immédiatement cloué au pilori, la justice l’inculpant d’outrage à magistrat et le Sénat levant son immunité parlementaire. Que Pesquet ait été le véritable auteur de cette machination, cela ne fait plus guère de doute – ce dernier a d’ailleurs reconnu les faits bien plus tard. Que François Mitterrand ait été dupe de cette machination est une évidence : lui-même le reconnaîtra immédiatement. Mais il est convaincu que Pesquet a agi en service commandé pour le compte du Premier ministre du Général, Michel Debré, cherchant par ce biais à se disculper d’une affaire trouble – celle dite du bazooka – et ainsi éliminer un adversaire remuant. François Mitterrand voit dans cette affaire une nouvelle preuve de la duplicité des milieux gaullistes qui, sous les habits de la légitimité historique du grand homme, cacheraient en réalité de sombres et basses besognes.
En dénonçant donc, méticuleusement, les écarts du pouvoir, Mitterrand cherche à démontrer que le rôle historique joué par l’homme du 18 Juin ne saurait donner tous les droits, ni à lui ni à ses partisans. Et même s’il ne tient pas de Gaulle comme directement responsable des abus qu’il décrit, le fait même qu’il les tolère entretient un régime « personnel », un régime de coup d’état permanent, c’est-à-dire une violation répétée de l’esprit républicain.
Sur ce dernier point, il ne faut pas commettre d’erreur. En effet, on affirme souvent que le Coup d’État permanent est un livre au travers duquel François Mitterrand dénonce la décision prise en 1962 de faire élire directement le président de la République par le peuple français. Le lecteur s’étonnera peut-être de ne rien trouver de la sorte. Au contraire, l’élu de la Nièvre se montre très prudent sur ce thème, du moins en 1964, estimant que les politologues sont partagés sur son principe, le jugeant même « acceptable en soi » (p. 119). Là encore, c’est moins l’élection en elle-même qui posa problème que les conditions de sa réalisation. Sans revenir sur le débat juridique de l’époque, rappelons qu’en proposant cette modification de la Constitution directement par référendum, de Gaulle prit une fois de plus quelques libertés avec la légalité. Selon les termes de la Constitution de 1958, toute consultation référendaire sur un projet de loi constitutionnelle ne pouvait en effet intervenir qu’après une délibération parlementaire et non directement sur un texte élaboré par l’exécutif. C’est pourtant cette dernière voie que choisit le Général – ce qui lui valut l’opposition immédiate du Sénat présidé par Gaston Monnerville, qui accusa le Premier ministre Pompidou de « forfaiture », et la censure du gouvernement par l’Assemblée Nationale. Une seule fois dans l’histoire de France, en 1848, on avait procédé à l’élection d’un président de la république au suffrage universel (masculin) : or Louis Napoléon Bonaparte, élu, allait renverser trois ans plus tard la République par un coup d’état. La référence à cette période – que l’on retrouve à plusieurs reprises dans Le Coup – est bien présente dans toutes les têtes en 1964. Bien que les Français aient largement approuvé, le 28 octobre 1962, la révision constitutionnelle à laquelle François Mitterrand s’était opposé de toutes ses forces, celui-ci retrouve son siège de député de la Nièvre quelques semaines plus tard. Contrairement à ce qui s’était passé en 1958, l’opposition à de Gaulle commençait à devenir payante…
François Mitterrand envisage-t-il dès cette époque un affrontement avec de Gaulle devant les électeurs, en se présentant aux élections présidentielles qui doivent avoir lieu en décembre 1965 ? Certains de ses proches et lui-même affirment que, dès 1962, il a songé à se présenter, sans pour autant savoir ni quand ni comment. Car, on l’oublie trop souvent, lorsque Le Coup d’État permanent est publié en 1964, François Mitterrand n’est pas encore le candidat de la gauche contre de Gaulle. À cette époque, il soutient fidèlement la candidature de Gaston Defferre, le fameux « Monsieur X » dont la campagne est orchestrée par L’Express depuis l’été 1963, et qui a pour stratégie de ratisser au-delà de la SFIO jusqu’au MRP – mais pas en direction des communistes, ce qui n’était pas le choix de François Mitterrand – et de s’adresser à tous les républicains. D’où l’appel lancé par François Mitterrand en conclusion du Coup à un sursaut contre le régime. Car contrairement à Gaston Defferre ou à Pierre Mendès France qui insistent alors sur leurs programmes, l’élu de la Nièvre choisit, lui, d’affronter l’essence même du régime gaulliste, c’est-à-dire la stature même du Général et sa légitimité.
Quelques mois après la parution du Coup d’État permanent, François Mitterrand se retrouve finalement candidat contre de Gaulle aux élections présidentielles, le jeu démocratique ayant fini par placer les deux hommes à égalité devant le suffrage des Français. De Gaulle allait bien sûr nettement triompher de cette confrontation, ce que tous les commentateurs prévoyaient. En choisissant de faire de l’élection présidentielle le plus important rendez-vous politique du pays, Charles de Gaulle avait offert une formidable tribune à son opposant le plus déterminé et finalement un tremplin à son ascension politique. En obtenant 10,3 millions de voix au 2e tour de l’élection de décembre 1965, François Mitterrand était devenu le candidat unique de la gauche, ce qui lui ouvrait le destin que l’on sait.
Mais le chemin était encore long avant la victoire de 1981 et le retour de la gauche au pouvoir. Le 13 mai avait introduit un clivage durable au sein de la classe politique française. Ceux qui avaient accepté le retour au pouvoir de de Gaulle furent, à gauche et pour longtemps, disqualifiés. À l’inverse, les tenants de l’opposition au gaullisme, dont François Mitterrand, gagnèrent en importance, d’autant que la droite s’inscrivit progressivement dans le sillage du Général. Finalement, seule l’alternance de 1981 mit un terme à la séquence ouverte en mai 1958 en plaçant la gauche française, revanche de l’histoire, en situation d’exercer le pouvoir au sein des institutions de la Ve République.
Dès lors, plus que le pamphlet combatif et militant, le Coup d’État permanent entra progressivement dans notre histoire politique comme un texte appelant à la vigilance contre tous les pouvoirs. Il fut d’ailleurs utilisé pour critiquer son propre auteur, devenu à son tour président de la république. Jamais pourtant François Mitterrand n’en renia une ligne, lui qui encore, à la fin de sa vie politique, continuait de s’interroger sur l’équilibre de nos institutions : « Un président de la République française, même sous la Ve République, a toujours beaucoup moins de pouvoir que vous ne l’imaginez ; d’autre part, il en a plus que n’en ont la plupart des chefs d’états démocratiques. Comment allier ces contraires ? »


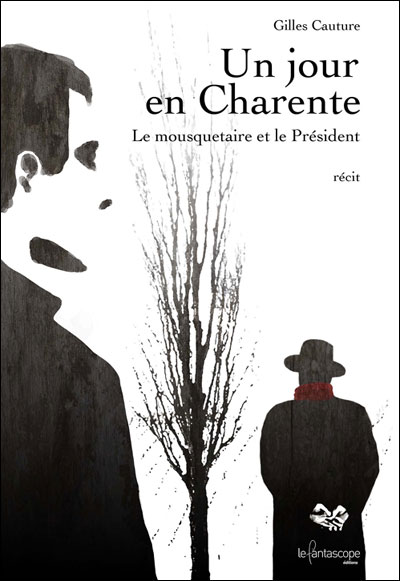



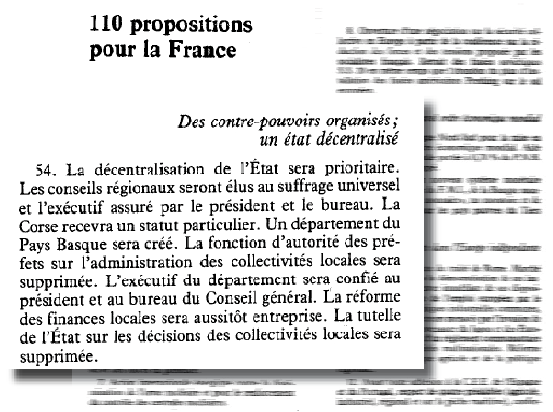
1 commentaire
Commentaires désactivés.