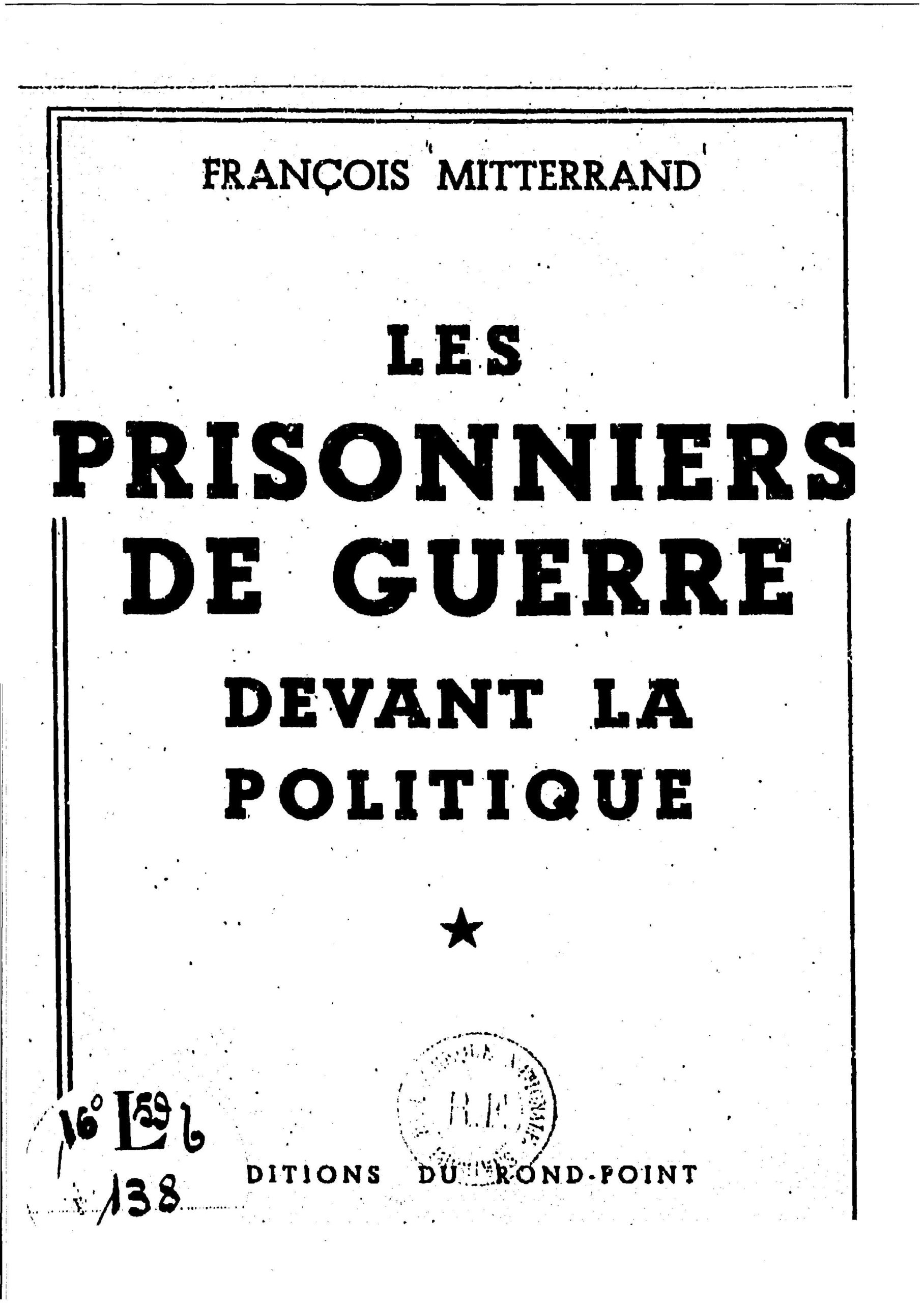« En France, je cherche à entraîner un mouvement populaire et je veux que les classes sociales qui composent ce mouvement populaire aient leur mot à dire dans les affaires de la Nation et dans les affaires de l’état. »1
La défaite de 1965, son éviction de la course à la présidentielle en 1968, ont fini de convaincre François Mitterrand de l’utilité d’être à la tête d’un grand parti qui rassemblerait toute la gauche non communiste. Il propose alors l’idée d’une fusion de la CIR – qu’il dirige toujours – avec le nouveau Parti socialiste d’Alain Savary. La vieille SFIO a en effet fait peau neuve même si Guy Mollet reste dans les coulisses.
Gaston Defferre, le jeune Pierre Mauroy, appuient cette démarche. Un congrès d’union est prévu pour juin 1971, à Épinay. Le PS d’Alain Savary s’apprête à absorber la CIR… c’est tout le contraire qui se produit. Grâce à une alliance entre le CERES de Jean-Pierre Chevènement, la motion Defferre-Mauroy et les Conventionnels, François Mitterrand prend la tête du PS, évinçant le tandem Mollet-Savary.
Cette bataille d’hommes recouvrait en réalité un vrai choix politique. En désignant François Mitterrand, les socialistes choisissaient la stratégie d’Union de la gauche – c’est-à-dire l’union avec le PCF de Georges Marchais – et rejetaient une alliance plus prudente de toute la gauche préconisée par Mollet. François Mitterrand avait d’ailleurs clairement indiqué ces enjeux dans Un socialisme du possible, publié en 1971.
Le nouveau premier secrétaire se met immédiatement au travail. Première étape, doter son parti d’un programme de gouvernement. C’est chose faite en mars 1972 avec l’adoption du programme « Changer la vie ». Débutent alors de longues et difficiles tractations avec le PCF. On peine à se mettre d’accord sur le nombre des nationalisations, la construction européenne, les alliances militaires. Finalement, le 26 juin 1972, avec l’aide des radicaux de gauche, le Parti socialiste impose à son puissant partenaire d’extrême gauche un programme comparable au sien. Pari gagné.
Le lendemain, devant ses partenaires de l’Internationale socialiste qui s’interrogent, François Mitterrand explique le sens de cet accord : « Notre objectif fondamental, c’est de refaire un grand parti socialiste sur le terrain occupé par le PCF lui-même, afin de faire la démonstration que sur les cinq millions d’électeurs communistes, trois millions peuvent voter socialiste. » Place du Colonel-Fabien, on s’étrangle.
Que penser de ce programme de gouvernement ?
À bien des égards, il est caricatural car empreint de phraséologie marxiste. Or, cela ne correspondait en rien à la pensée profonde de François Mitterrand, lui qui déclarait volontiers, dans ses œuvres comme à la tribune des Congrès, « Je suis de ceux qui ne se reconnaissent pas dans le marxisme. » Et, s’il voyait dans le marxisme un « irremplaçable instrument d’analyse », il en jugeait néanmoins le langage « abscons ». En revanche, si l’on fait abstraction, dans ce texte, des tournures marxisantes, il reste un catalogue de mesures que l’on pourrait qualifier de social-démocrates. Pêle-mêle, on trouve les idées d’une plus juste redistribution des richesses, d’extension des droits des salariés, de modernisation de l’économie française – y compris par les nationalisations qui correspondent moins à l’idée de collectivisation que d’industrialisation –, de préservation des grands équilibres financiers – notamment la lutte contre l’inflation –, de priorité donnée à l’éducation, à la recherche et à la culture, ainsi que différentes mesures dans des domaines aussi divers que le sport, la famille, la justice, la prison, la sûreté, etc. Au total, le Programme commun est un habile mariage entre le volontarisme étatique traditionnel français – que l’on retrouve dès 1945 dans le programme du Conseil national de la résistance –, un pilotage keynésien de l’économie, un effort de justice sociale et un ensemble de propositions visant à « libéraliser » les mœurs. On est là plus près de la pensée mitterrandienne. Le premier secrétaire du Parti socialiste compare d’ailleurs « son » programme avec l’expérience suédoise.
À l’été 1972, le Parti socialiste de François Mitterrand est donc en ordre de marche. L’union de la gauche est réalisée, elle a un programme à proposer aux Français. Mais le calendrier est soudainement bouleversé par le décès du Président Pompidou. La campagne est courte : moins d’un mois. Malgré une situation sociale tendue (4 millions de journées de grève pour la seule année 1973) et bien que la gauche ait progressé lors des élections qui viennent d’avoir lieu (grâce à une poussée du PS), le candidat Mitterrand échoue une fois de plus.
Quatre cent mille voix séparent le président de la République élu – Valéry Giscard d’Estaing – de son challenger. Il y a eu le terrible débat télévisé, où l’on sait François Mitterrand peu à l’aise, et la réplique cinglante de M. Giscard : « Vous n’avez pas le monopole du cœur, M. Mitterrand. » Dès le lendemain, dans ses bureaux de campagne de la tour Montparnasse, François Mitterrand appelle pourtant son équipe à ne pas désespérer et à continuer le combat.
Après 1974, le Parti socialiste continue de se transformer sous l’action énergique de son premier secrétaire. Ses effectifs augmentent. Il s’ouvre à l’entreprise. Il accueille le PSU de Michel Rocard. De nombreux militants de la CFDT, des milieux chrétiens de gauche – tels que Jacques Delors –, le rejoignent. Autour de lui, François Mitterrand fait surgir ses « sabra », jeunes intellectuels ou hauts fonctionnaires qui l’alimentent en notes de réflexion : Paul Quilès, Véronique Neiertz, Lionel Jospin, Jacques Attali, Laurent Fabius, Hubert Védrine, édith Cresson, tant d’autres… Cette modernisation a des effets politiques. Au congrès de Pau en 1975, François Mitterrand recompose une majorité autour de lui, mais sans le CERES, donc plus au centre. Les résultats sont là : en 1977, aux élections municipales, le PS fait un véritable raz de marée, emportant 37 villes de plus de 10 000 habitants.
C’est cet événement qui provoque l’affolement du Parti communiste. En 1968, le PCF obtenait 20 % des suffrages, la SFIO 16,9 %. En 1973, les deux partis font jeu égal, autour de 20 %. Aux élections législatives de 1978, le PS devance désormais les communistes : 26,3 % contre 20 %. La prophétie de François Mitterrand s’est réalisée. Georges Marchais, le leader communiste, met alors un terme à l’union de la gauche. À l’occasion de « l’actualisation du programme commun », les communistes claquent la porte. La conséquence est immédiate : lors des élections législatives de 1978, bien que la gauche et la droite fassent jeu égal, le mauvais report des voix à gauche entraîne la victoire de la droite au second tour.
Cet échec aux législatives de 1978 ouvre une crise de légitimité au sein du Parti socialiste. François Mitterrand est-il le candidat le mieux placé pour 1981 ? L’union de la gauche – et donc les concessions faites aux communistes en terme de programme politique – est-elle souhaitable ? Deux questions que posent désormais ouvertement Michel Rocard et Pierre Mauroy.
La réaction des « mitterrandistes » et de François Mitterrand lui-même est immédiate : un gauchissement de la ligne politique ; une guerre sans merci contre les « rocardiens. » Au congrès de Metz de 1979, le futur Président appelle à la « rupture ». Les militants applaudissent. Michel Rocard est écarté. La voie est libre pour François Mitterrand. Il lui faut désormais battre la droite. Président de centre droit, clairement en rupture avec le néo-gaullisme d’un Jacques Chirac, Valéry Giscard d’Estaing a tenté de mener, dans la première partie de son septennat, une série de réformes. Mais, à chaque fois, ses mesures furent limitées par sa majorité la plus conservatrice : il autorise l’IVG, mais pas son remboursement ; il démantèle l’ORTF mais ne supprime pas la tutelle politique sur les médias, etc. Dans le domaine des droits sociaux, c’est le statu quo qui l’emporte. Sur la peine de mort, exemple le plus emblématique, on sait que Valéry Giscard d’Estaing y est personnellement hostile, mais il se refuse à imposer son abolition. Sur le plan économique, les résultats sont mauvais. Les deux chocs pétroliers de 1973-1974 et de 1979 ont mis en évidence les faiblesses structurelles de l’économie française. Le nombre des chômeurs augmente. Le gouvernement de Raymond Barre ne parvient pas à maîtriser l’inflation.
À la fin des années soixante-dix, François Mitterrand concentre ses attaques sur l’action extérieure du Président. En effet, si ce dernier mène une politique européenne courageuse, il refuse de voir dans le regain des tensions entre l’Est et l’Ouest la fin de la « détente ». Lorsque l’Union soviétique envahit l’Afghanistan, son attitude lui vaudra d’ailleurs cette réplique acide de François Mitterrand qui le compare à un « petit télégraphiste ».
Dans La Paille et le Grain, publié en 1975, dans L’Abeille et l’Architecte, publié en 1978 et surtout dans Ici et Maintenant, publié en 1980, François Mitterrand ne ménage pas ses critiques à l’égard du pouvoir.
La campagne présidentielle s’engage au tout début de l’année 1981. Cette fois-ci, le candidat Mitterrand a confié son image à Jacques Séguéla. « Changer la vie », « La force tranquille » : les slogans sont porteurs. Il a par ailleurs résumé son programme dans un petit fascicule, que chaque Français peut lire facilement : les 110 propositions. Lors du débat télévisé qui précède le scrutin, à un Valéry Giscard d’Estaing qui l’accuse d’être « l’homme du passé », François Mitterrand réplique que le « Président sortant » est quant à lui « l’homme du passif ». Au soir du 10 mai 1981, recueillant plus de quinze millions de voix – alors que Valéry Giscard d’Estaing n’est pas parvenu à rassembler la droite –, François Mitterrand est élu président de la République avec 51,76 % des voix. Il apprend la nouvelle à Château-Chinon, d’où il s’exprime dans la soirée : « Cette victoire est d’abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, des forces de création, des forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l’emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. » Place de la Bastille, sous la pluie, le peuple de gauche s’est réuni. La foule reprend en cœur un slogan qui en dit long pour la suite : « Mitterrand du soleil. »