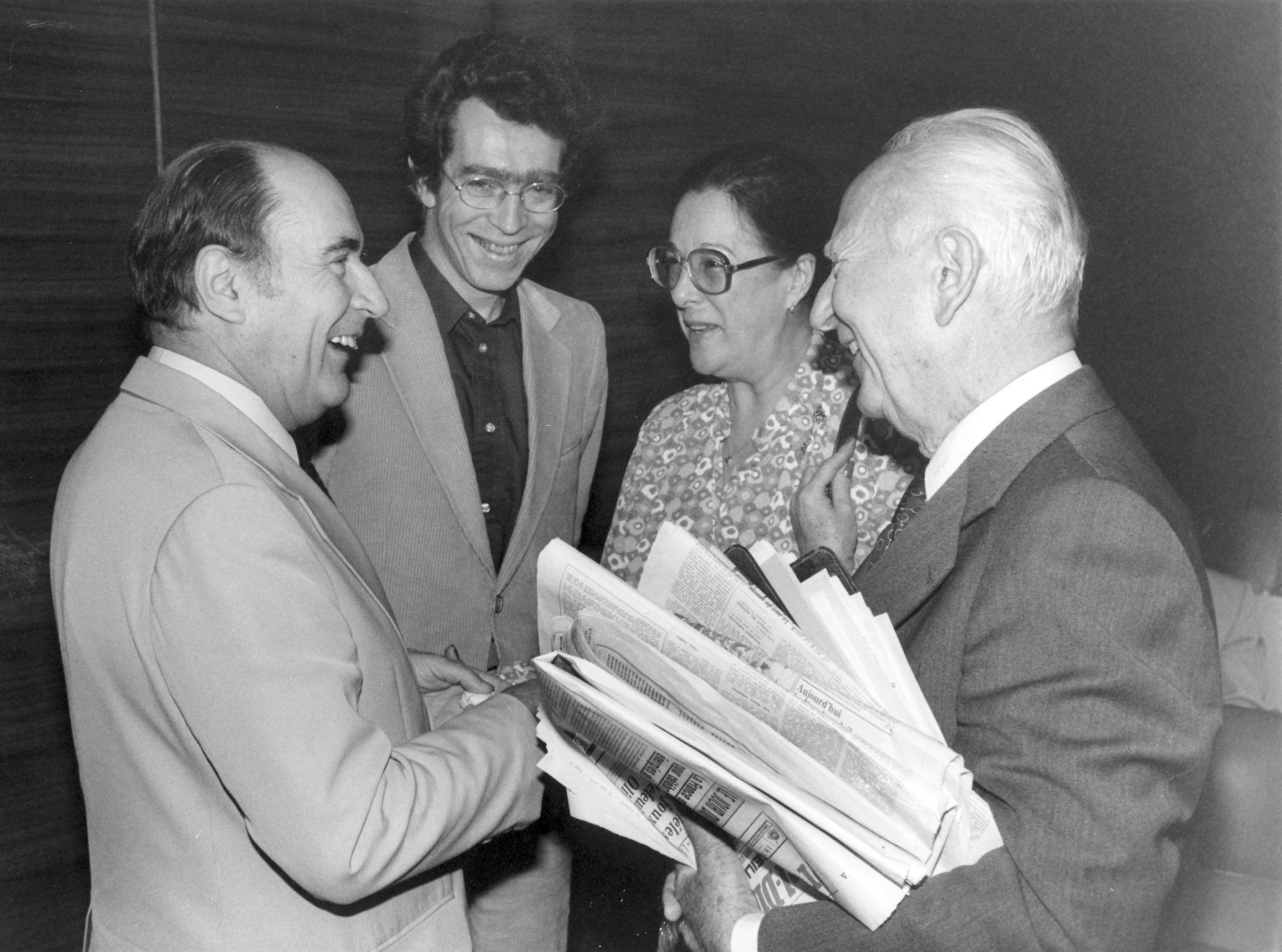En cette fin mai 1958 nous sommes une vingtaine réunis autour de François Mitterrand au rez-de-chaussée du Palais Bourbon, dans le Quatrième bureau, à quelques pas de l’hémicycle. Le député de la Nièvre a convoqué le groupe parlementaire de l’U.D.S.R.-R.D.A. et le bureau de l’U.D.S.R., la petite formation politique qu’il préside, pour prendre position sur l’investiture du Général de Gaulle, Président du Conseil désigné à la suite de l’insurrection du 13 mai.
C’est la première fois que j’entre au Palais Bourbon et j’observe avec une immense curiosité ceux qui ont pris place autour des tables disposées en fer à cheval: François Mitterrand, très ramassé sur lui-même, Joseph Perrin , le secrétaire général du mouvement, Georges Beauchamp, quelques députés dont Roland Dumas, Roger Duveau, Jean de Lipkowski, mais surtout les parlementaires africains du R.D.A., le mystérieux Houphouët-Boigny, le nigérien Hamani Diori, le guinéen Sékou-Touré impressionnant d’immobilité et de silence et qui ne manifestera aucun sentiment tout au long de la réunion.
François Mitterrand relate brièvement les conditions dans lesquelles la petite délégation de l’U.D.S.R. s’apprête à rencontrer le Général de Gaulle à l’hôtel Lapérouse. Très vite il nous exposera les raisons que nous connaissons et pour lesquelles d’ores et déjà il a décidé de ne pas voter l’investiture. Jean de Lipkowski émettra un avis contraire et répondra avec une certaine fougue: « Que voulez-vous! Voyons les choses en face. Aujourd’hui Rome n’est plus dans Rome ».
On connaît la suite. François Mitterrand s’adressera au Général de Gaulle du haut de la tribune de l’Assemblée en termes sans équivoque, mais avec la noblesse qui convient en de telles circonstances: « Lorsque le 10 septembre 1944, le Général de Gaulle s’est présenté devant l’Assemblée consultative issue des combats de l’extérieur ou de la résistance, il avait auprès de lui deux compagnons qui s’appelaient l’honneur et la patrie. Ses compagnons d’aujourd’hui qu’il n’a sans doute pas choisis, mais qui l’ont suivi jusqu’ici, se nomment le coup de force et la sédition ».
Mais il avait parlé auparavant, avec le souci constant chez lui, tout en combattant durement, de faire la part des choses, de s’opposer fermement, mais sans jamais humilier, il avait d’abord parlé de « l’homme au prestige unique, à la gloire incomparable, aux services rendus exceptionnels ».
La fierté d’être parlementaire
Dans le même temps, lui plusieurs fois ministre sous la Quatrième République, ministre également de Pierre Mendès-France, prenait ses distances avec le régime en train d’expirer: « Nous ne nous battrons pas, disait-il, pour les rites, pour les mœurs, pour les travers d’un système tant dénoncé ».
Discours d’une très belle facture, dans le droit fil de beaucoup d’interventions de Mitterrand tout au long de la Quatrième République, où la forme adhérait parfaitement au fond, et tout spécialement lorsqu’il dessinait le destin qu’il souhaitait pour la France. Au tournant du siècle passé deux sujets constituèrent l’armature de sa pensée politique, l’Outre-mer et l’Europe. L’Assemblée Nationale, le livre, les articles de journaux, les congrès de la petite U.D.S.R. lui fournirent à de nombreuses reprises l’occasion de s’exprimer sur le devenir de la France, aussi sur celui de l’Union française dont les colonialistes ne pouvaient être que les fossoyeurs féroces. Il le dit le 29 novembre 1957 à l’Assemblée Nationale: « Tant qu’on n’entreprendra pas franchement de construire la communauté franco-africaine, égalitaire et fraternelle, … rien ne sera fait et tout sera perdu ».
L’autre appel du grand large, c’est celui de l’Europe. La France doit y répondre, mais en rassemblant avec elle les siens « des Flandres au fleuve Congo ». « Le XXème siècle dénie aux nations isolées le droit de vivre. Il est celui des grands ensembles », déclarait-il en octobre 1953. Or, dès le 11 décembre 1951 il avait déjà expliqué devant l’Assemblée Nationale: « Nul n’a ici contesté que l’enjeu politique du plan (Schuman), pour l’Europe, pour le monde et surtout pour la France est historiquement primordial ».
François Mitterrand tout au long de la Quatrième République a été un grand parlementaire, parce que l’Assemblée était pour lui le lieu privilégié de l’expression politique, qu’il apportait un soin extrême à la préparation de ses interventions qu’il sous-tendait d’une forte vision historique.
Ce qui n’excluait nullement chez lui la claire conscience des défauts du système, déplorant que le règlement de chaque problème entraînât immanquablement la chute du gouvernement.
Il lui est souvent arrivé par la suite, sous la Cinquième République, d’évoquer le souvenir d’une Assemblée « souveraine et brouillonne », pour tempérer ainsi son jugement: « Sous la Quatrième les gouvernements tombaient après avoir réglé un problème, sous la Cinquième ils durent, mais ils n’en règlent aucun ».
Après son éviction de l’Assemblée Nationale en novembre 1958, suivie rapidement d’une entrée au Sénat et en 1962 d’un retour au Palais Bourbon, François Mitterrand combat le nouveau régime avec une ardeur renouvelée.
François Mitterrand face à Georges Pompidou
Le 24 avril 1964 il provoquera à l’Assemblée Nationale une discussion d’une portée considérable en posant une question orale avec débat sur les attributions respectives du Président de la République et du Premier Ministre Georges Pompidou. Il dénoncera à cette occasion la formulation extrême des pouvoirs présidentiels, telle qu’employée par le Général de Gaulle, selon laquelle « l’autorité indivisible de l’Etat est déléguée tout entière … au Président par le peuple qui l’a élu et qu’il n’y aucune autorité … ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire qui ne puisse être conférée ou maintenue que par lui ». Mitterrand réplique alors que le secteur réservé (Affaires étrangères, Défense) violait déjà la Constitution, mais que la prétention du Général d’étendre le cas échéant le « domaine suprême » qu’il détient « au gouvernement – peut-être au Parlement – et même à la justice, ruine la République ».
Ce débat d’une intensité extrême, au cours duquel Pompidou traitera, celui qui est désormais l’orateur principal de l’opposition, de « type d’homme de la Quatrième République que les Français ne veulent pas revoir » marquera l’un des temps les plus forts de la carrière d’orateur parlementaire de François Mitterrand.
J’ai vécu quelques années plus tard dans l’hémicycle les affrontements entre Georges Pompidou et François Mitterrand et assisté à l’apprentissage des Conventionnels élus en mars 1967.
François Mitterrand était intervenu dans l’après-midi du 19 avril 1967 sur une déclaration de politique générale du gouvernement. Il fut à nouveau présent à son banc pour la séance du soir, lorsque devant un hémicycle clairsemé nous faisions nos premières armes. Le nouveau député de Tarare Georges Vinson avait voulu monter à la tribune et parler sans notes à la manière de Giscard d’Estaing. Pompidou calé au banc du gouvernement ne quittait pas des yeux le jeune parlementaire soudain blême et tétanisé et qui ne retrouvait pas l’enchaînement de ses propos. Je pensais alors à la remarque de Raymond Barrillon, le talentueux journaliste du Monde: « La première fois, vous verrez, la tribune, c’est très impressionnant ».
Pendant toute cette période, l’hémicycle était devenu par excellence le lieu des confrontations entre Georges Pompidou et François Mitterrand. Ainsi les séances des 19 et 20 mai 1967 virent-elles les deux hommes s’opposer durement à l’occasion du débat sur les ordonnances, touchant à divers domaines dont celui de la sécurité sociale. L’ancien candidat à l’élection présidentielle de 1965, qui avait mené la bataille des législatives de 1967, dénonça une nouvelle fois l’abaissement du Parlement, avec regroupés autour de lui, les députés de la Convention des Institutions républicaines.
Les invectives venues les années précédentes des travées de la majorité avaient beaucoup perdu de leur virulence, car l’opposition n’avait manqué les élections de mars 1967 que d’une voix (récupérée in extremis par le gouvernement dans une circonscription d’Outre-mer). Désormais au cours des séances les parlementaires les plus avisés de la majorité semblaient parfois apprécier à sa juste valeur les talents du chef de l’opposition. Nous étions de notre côté sensibles aux progrès oratoires du Premier Ministre qui dégageait de plus en plus une impression de force et de solidité. A l’issue des séances François Mitterrand ne manquait pas de saluer certains élus de la droite tandis que Pompidou s’attardait au milieu de ses partisans. Un jour Mitterrand nous a expliqué : « Vous savez, le Parlement, c’est un club. Il faut veiller à parler à tout le monde (ou presque) ».
Dans les joutes oratoires on sentait que Pompidou prenait un réel plaisir à répliquer à Mitterrand. Il le faisait avec gourmandise, avec de petits claquements de langue qui évoquaient un lézard prêt à gober sa proie. La voix était légèrement chantante, le timbre harmonieux, musical dans les graves, alors que François Mitterrand s’exprimait souvent avec véhémence, à la limite parfois d’une certaine fureur.
Puis vinrent les journées de mai 1968, au cours desquelles François Mitterrand depuis son appartement de la rue Guynemer face au Jardin du Luxembourg où nous le retrouvions régulièrement, ne confondit jamais les événements du Quartier Latin avec une révolution. Prudent certes, mais cependant vigilant, il nous avait dit: « N’hésitez pas à m’appeler, même à n’importe quelle heure de la nuit ».
Se tenant à l’écart des manifestations étudiantes qu’il ne sentait pas, manifestations en partie noyautées par des éléments gauchistes, il se manifesta essentiellement à l’Assemblée Nationale, intervenant à plusieurs reprises pour défendre les étudiants contre les brutalités policières (ce qui ne l’empêcha jamais de rendre hommage au sang-froid du Préfet de Police de Paris Maurice Grimaud).
Le 22 mai il défendra contre le gouvernement Pompidou une motion de censure qui obtiendra 233 voix. Mais le moment le plus fort de la séance est marqué par l’intervention d’Edgard Pisani qui votera la censure, provoquant chez ses amis la surprise et la consternation qu’on imagine. François Mitterrand aux côtés duquel je me trouve alors, nous dit, comme fasciné par le côté théâtral de ce comportement: « Nous assistons à un grand moment ».
Les choses se précipitent après la conférence de presse de l’hôtel Continental où le Président de la F.G.D.S. suggère la formation d’un gouvernement transitoire présidé par Pierre Mendès-France, lui-même annonçant qu’il serait candidat à la présidence de la République, si le Général de Gaulle se retire après l’échec du référendum qu’il vient d’annoncer. Les parlementaires de gauche présents entourent Mitterrand et le congratulent.
Le Général de Gaulle contre-attaque en disparaissant quelques heures à Baden-Baden, puis en prononçant la dissolution de l’Assemblée. Les élections de 1968 sont marquées par un raz-de-marée gaulliste. François Mitterrand est le seul des Conventionnels à sauver son siège. La F.G.D.S. qui ne compte plus que 57 députés au lieu de 118 (le P.C. 33 contre 73) disparaîtra à l’automne. François Mitterrand nous confiera qu’il sent dans son ancien groupe parlementaire un climat de haine glacée. Il siège alors parmi les non-inscrits.
Sur le chemin du 10 mai
Les années suivantes seront consacrées à la reconstruction du parti socialiste, engagée définitivement par le congrès d’Epinay de juin 1971. La tribune que fournit à François Mittterrand l’Assemblée Nationale, comme l’écriture, lui permettront de dépasser les querelles d’appareil – un mot qu’il n’aimait pas: « Si je parle d’appareil, les gens de la Nièvre pensent appareil dentaire », nous dit-il un jour – et de faire connaître aux Français un projet collectif et enthousiasmant impliquant la France, les luttes de son peuple, le poids de l’Histoire, l’horizon européen. Il y met toute la force de ses convictions et de son éloquence, avec parfois des accents lyriques d’une autre époque.
La négociation du programme commun de gouvernement avec le parti communiste révélera comment Mitterrand entend s’appuyer sur les institutions de la Cinquième République pour asseoir son autorité le jour de la victoire et pour renforcer le parti socialiste face à son partenaire. Si la suppression de l’article 16 n’a jamais fait problème chez les socialistes, il n’est pas question de laisser démanteler les articles de la Constitution qui prémunissent le pays contre le retour à l’instabilité de la Quatrième République. Ainsi la demande des communistes de s’engager sur une dissolution automatique de l’Assemblée en cas de rupture du contrat majoritaire passé entre les composantes de la future coalition gouvernementale fut-elle rejetée de bout en bout avec la plus grande fermeté. En cas de renversement du gouvernement le chef de l’Etat devait pouvoir, dans l’esprit de François Mitterrand, nommer un nouveau Premier
Ministre.
Candidat de l’union de la gauche pour la seconde fois en 1974, il prévient le corps électoral qu’il appliquera la Constitution. Le Premier Ministre sera choisi parmi les députés socialistes, le gouvernement sera à l’image de la majorité présidentielle. Il se présentera devant l’Assemblée Nationale et engagera son existence. En cas de désaccord, les électeurs seront appelés à trancher.
Droits et prérogatives
Précisément dans la foulée des élections présidentielles de 1981 et de 1988, François Mitterrand procédera immédiatement à la dissolution de l’Assemblée Nationale afin de disposer d’une majorité qui permette au gouvernement d’appliquer le programme sur lequel lui-même, puis les députés ont été élus.
Dans son message au parlement du 8 juillet 1981 le nouveau Président de la République est très clair: « J’ai dit à plusieurs reprises, déclare-t-il, que mes engagements constituaient la charte de l’action gouvernementale. J’ajouterai puisque le suffrage universel s’est prononcé une deuxième fois qu’ils sont devenus la charte de votre action législative ».
Mais dès le début de la législature l’opposition est décidée à se battre pied à pied contre les projets du gouvernement Mauroy, qu’il s’agisse de la décentralisation ou des nationalisations. Elle usera donc de tous les moyens de procédure pour retarder l’adoption des textes, comme l’avait fait jadis la gauche au temps où elle était minoritaire. Aussi le recours à l’article 49-3 de la Constitution sera-t-il utilisé à sept reprises par Pierre Mauroy et à plus de vingt par Michel Rocard. Dans le premier cas il s’agit de mettre un terme à l’examen d’une pluie d’amendements qui visaient uniquement à retarder le débat (ou de ménager les susceptibilités de la majorité dans l’affaire de l’amnistie des généraux félons); dans le second cas de contraindre la majorité, plus particulièrement les communistes, en posant l’alternative solidarité ou dissolution, puisque les socialistes n’étaient plus majoritaires à eux seuls à l’issue des élections législatives de 1988.
De même au cours des deux septennats les gouvernements auront recours aux ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution: il y aura dix lois d’habilitation entre 1981 et 1995 (dont deux en période de cohabitation), au motif presque toujours qu’il fallait accélérer le rythme des réformes, ou bien, en janvier 1982, à l’occasion du prochain « tournant économique », terme d’ailleurs récusé par François Mitterrand, sauver la cohésion de la majorité et contraindre le groupe communiste.
A ceux qui posent de temps à autre le problème d’une révision de certains articles de la Constitution François Mitterrand pour bien montrer qu’il n’a pas oublié certaines pages du Coup d’Etat Permanent (1964) fait observer: « Oui! Tant que je serai là cette Constitution ne sera pas dangereuse », comme en écho aux déclarations de Charles de Gaulle: « Vous ne me voyez pas entreprendre une carrière de dictateur à mon âge ».
La première cohabitation va fournir l’occasion à François Mitterrand à partir du 17 mars 1986 de défendre et les prérogatives du Président de la République et celles du parlement. Il rappellera d’abord qu’il est le garant de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux de la France (article 5 de la Constitution). Il s’est d’ailleurs toujours élevé contre le terme empirique et abusif de « domaine réservé ». Nous l’avons toujours entendu dire: « Il n’y a pas de domaine réservé. Il s’agit des prérogatives constitutionnelles du chef de l’Etat ». François Mitterrand les défendra bec et ongles avec succès dès le Sommet des Sept à Tokyo en mai 1986 et dans toutes les rencontres internationales qui suivront. Quant aux droits du parlement il en sera pendant toute cette période le défenseur vigilant, comme l’illustre la question des ordonnances visant à privatiser des banques, des compagnies d’assurances, Elf, Havas, Bull et Matra.
Le Président de la République, refusant les 14 et 16 juillet 1986 de signer des ordonnances qu’il ne juge pas conformes aux termes de la loi d’habilitation, fera plier le Premier Ministre Jacques Chirac et l’obligera à retourner devant le parlement.
François Mitterrand, tant au plan intérieur qu’international, aura toujours utilisé la totalité des pouvoirs qu’il tirait d’une application scrupuleuse, mais intégrale, de la Constitution. Lorsque la gauche détenait la majorité à l’Assemblée Nationale, il est évident que son influence sur le gouvernement était forte: ce fut le cas de 1981 à 1986. Le fait que le groupe socialiste issu de 1988 ne disposa plus que d’une majorité relative, ajouté à la sensibilité de Michel Rocard, cela rouvrit le jeu parlementaire, l’abstention des communistes ou celle des centristes sauvant à plusieurs reprises le gouvernement, mais je me souviens aussi de la satisfaction de François Mitterrand chaque fois que le groupe socialiste affirmait une volonté politique.
La Constitution de la Cinquième République qui n’est pas présidentielle, et reste fortement parlementaire, conserve aux députés des pouvoirs considérables, mais dont ceux-là se soumettant au fait majoritaire n’usent que trop rarement.
François Mitterrand l’a souvent déploré devant nous, car s’il disposait pour conduire sa politique de 1981 à 1986 et de 1988 à 1993 d’un levier – le gouvernement – et pour réfréner l’exécutif de 1986 à 1988 du groupe socialiste à l’Assemblée Nationale. Il aurait souhaité parfois voir les socialistes lorsqu’ils étaient majoritaires, influencer et contrôler davantage l’action du gouvernement, sans pour autant l’entraver. Exercice ô combien difficile sous le regard d’un Président qui maniait avec adresse et parfois une certaine jubilation l’art du donner-retenir…
La Constitution de la Cinquième République à l’épreuve des faits. Il fut courant pendant ces quatorze ans d’entendre dire que François Mitterrand s’était parfaitement coulé dans les habits du Général – dont il disait par ailleurs, non sans une admiration certaine, qu’il était le dernier grand homme du dix-neuvième siècle. En fait, malgré la durée de sa présence à la tête de l’Etat, assailli par les combats politiques, en butte à l’opposition du Sénat, passage obligé de toute révision, François Mitterrand n’a pas eu pour préoccupation première de réformer la Constitution, à supposer que l’entreprise fût possible. Il considérait dans le fond que la Constitution devenait un peu ce que les hommes en faisaient, c’était là une boutade – mais elle était cependant significative de son état d’esprit.
Et cependant il ne renonça jamais vraiment à cette idée de réforme, même si la pratique du pouvoir suprême entraîna chez lui une évolution évidente. « Fini, avait-il dit en juillet 1981, je l’espère, cet abus de votes bloqués ou ces lois réputées adoptées par le subterfuge de la non-censure ». Dans le même temps il affirme que majorité et opposition ont des droits égaux au parlement. Lorsque j’organise en janvier 1982 une réception en son honneur à l’Hôtel de Lassay, je le sens triste et inquiet de constater que les députés de l’opposition, à de rares exceptions près, ne sont pas présents.
Beaucoup plus tard, lors de la seconde conférence sur la démocratie parlementaire organisée à Strasbourg par le Conseil de l’Europe à la fin de septembre 1987, il expose: « Un parlement omnipotent, et c’est l’impuissance du pouvoir, donc la perte de l’autorité de l’Etat au-dedans comme au-dehors. La France en a fait l’expérience à la fin de la Troisième République et sous la Quatrième, et c’est la raison pour laquelle je n’avais pas voté la Constitution de 1946. Mais un parlement faible encadré par des procédures trop strictes et un exécutif sans contrôle et voilà que s’affirme de nouveau la tentation toujours présente de contraindre les Assemblées … ». Le 10 novembre 1991, François Mitterrand annonce au cours d’une émission télévisée qu’il ne partira pas sans avoir modifié les institutions ou du moins avoir saisi le parlement et les Français des modifications qu’il estime nécessaires.
Et le 30 novembre 1992 il rend publiques les propositions de réforme de la Constitution qu’il entend soumettre à un Comité consultatif que préside le doyen Vedel. Sans remettre en cause « l’architecture générale et l’esprit des institutions ». De quoi s’agit-il? Essentiellement de rendre obligatoire la ratification par le parlement des dispositions prises par ordonnances et de limiter le recours à l’article 49-3 qui aboutit à l’adoption d’un texte hormis le vote d’une motion de censure.
Ces propositions visent selon un entretien accordé au Monde à « rééquilibrer les pouvoirs en restituant au parlement des compétences qu’il n’aurait jamais dû perdre ».
Bien qu’adoptées en Conseil des Ministres avant la fin de la législature, les propositions du Comité consultatif Vedel ne seront pas reprises après 1993 par le gouvernement Balladur ni par les gouvernements suivants.
Recevant en avril 1993 le Bureau de l’Assemblée Nationale que conduit Philippe Séguin, le Président de la République, après avoir approuvé l’allongement des sessions comparera l’équilibre des institutions à « la situation de l’oiseau que l’enfant veut attraper en jetant du sel sur sa queue: cela ne se produit jamais… on cherche, on approche, et puis l’oiseau s’éloigne … au total c’est tout de même cet assaut de bonnes volontés qui finit par faire vivre plus de démocratie ». Déclaration à cent coudées de tout postulat dogmatique!
François Mitterrand tout au long de sa vie publique a été présent au pays. Les témoignages abondent sur ses voyages à travers les régions de France, sa connaissance des terroirs et des paysages. Il entretenait des liens très originaux avec sa circonscription, liens faits de présence et de distanciation. J’entends un dimanche matin le Maire de Château-Chinon, alors leader de l’opposition, répondre avec une infinie patience à un jeune couple qui se plaignait de la hauteur d’une bordure de trottoir, et me dire quelques secondes après: « Si j’habitais Château-Chinon, ils me feraient travailler du lundi au dimanche soir … ». Mais le même François Mitterrand téléphonait devant moi quelques années plus tôt depuis la rue Guynemer pour s’enquérir de la satisfaction des habitants puisque les crédits pour la construction de la gendarmerie étaient débloqués. Le nouveau bâtiment s’élèverait à côté de la Maison des Jeunes. « Il est prudent! » faisait observer son ami Georges Dayan, tout en finesse et en humour, le même qui s’inquiétait en pleine discussion du programme commun de gouvernement de certaines dérives dirigistes et s’exclamait : « Il va dimanche à Château-Chinon. C’est bien. Là il est sérieux ». Cela n’aurait en rien offusqué François Mitterrand qui devant les péripéties ou les vicissitudes de la vie politique invoquait le bons sens des Français, on ne parlait pas alors ni de France profonde ni de France d’en bas mais tout simplement des Français.