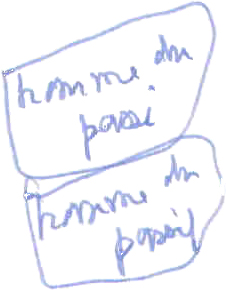Gaston Defferre n’a pas été que le maire de Marseille. Grand résistant puis Ministre sous la IVème et Vème République, il a marqué de son empreinte le paysage législatif français.
Premier candidat à fonder sa campagne sur les médias (« Monsieur X ») lors de la première élection présidentielle au suffrage universel en 1965, il a tenté en vain de rassembler la gauche et le centre à l’élection présidentielle de 1969, avant de rejoindre François Mitterrand.
Gérard Unger a enquêté pendant trois ans auprès des familiers, des amis politiques et des adversaires de Gaston Defferre pour publier, en fin d’année dernière, une belle biographie aux éditions Fayard.
Il revient au cours d’un long entretien pour l’institut François Mitterrand sur le parcours romanesque de ce personnage haut en couleur qui a occupé la scène politique française pendant près d’un tiers de siècle. Vous retrouverez la seconde partie de cette interview dans la prochaine Lettre de l’IFM.
IFM : Pourquoi avez-vous tenu à réaliser une biographie de Gaston Defferre ?
Gérard Unger : Je suis historien amateur et j’écris pour mon plaisir. Ce qui m’intéresse, c’est de changer de période. J’ai rédigé Lamartine il y a 10 ans, c’était le XIXe siècle. J’ai publié un Aristide Briand il y a 5/6 ans, c’était la charnière du XIXe siècle et du premier XXe siècle. J’ai voulu chercher un personnage plus contemporain sur lequel tout n’avait pas été dit. Ce n’était pas la peine de faire « un quarante-troisième » Charles De Gaulle, « un vingt-huitième » Mitterrand et « un soixante-treizième » Mendès France. Pourquoi pas Gaston Defferre ? Il a beaucoup agi et, paradoxalement, peu d’ouvrages lui sont consacrés. Il y a eu une bonne biographie à sa mort, celle de Georges Marion. Nous n’avons pas le même regard. Le sien est journalistique, le mien est plus politique. Il y a aussi l’album photos qu’a réalisé Edmonde Charles-Roux. Il contient beaucoup de renseignements et d’excellentes photos mais ce n’est pas non plus très politique. Je me suis dit qu’il y avait de la place pour une véritable biographie personnelle et politique.
IFM : L’aviez-vous croisé ?
Gérard Unger : Oui, trois fois. Le premier souvenir, c’est en 1965 lorsque je suis à Science-po. Il prononçait une conférence à Neuilly sur le Grande Fédération. A l’époque, cela me paraissait être une possibilité pour la gauche. Ensuite, quand j’étais directeur-adjoint de RMC en 1981, je l’ai vu deux fois. Une fois en prenant mes fonctions, avec Jean-Claude Hêberlé alors directeur général de la station. Nous avions déjeuné au Petit-Nice. Enfin, j’ai diné avec Hêberlé, Edmonde Charles-Roux et lui, fin 1982/début 1983, dans leur appartement avenue du Président Wilson. Je l’ai donc connu personnellement, mais peu.
IFM : Quel détail physique vous a le plus marqué chez cette personnalité haute en couleurs?
Gérard Unger : Ce qui m’a frappé, c’est son regard. Un regard pénétrant. Un regard tranchant. Un beau regard d’ailleurs qui essayait de savoir à qui il avait à faire.
Sa diction ? Il en jouait. Non pas qu’elle ait été bonne, elle ne l’était pas nécessairement. Mais elle n’était pas si mauvaise que cela. Il était avocat, il a plaidé fortement. Il a sauvé quelques têtes pendant la guerre. Il était capable de s’exprimer correctement. Mais quand il n’avait pas trop envie qu’on le comprenne, il savait s’arranger. C’est quelqu’un qui disait aux journalistes lors d’une interview : « vous en voulez pour combien ? 30 secondes, 45 secondes, 1 minute ? ». Il était tout à fait capable de calibrer son temps. Il avait une bonne maîtrise des interviews.
IFM : Gaston Defferre est indissociable de Marseille. Votre ouvrage permet, par son dimension politique, de découvrir la cité phocéenne. Aimiez-vous particulièrement cette ville ?
Gérard Unger : Non, je n’avais pas d’attachement particulier pour Marseille. J’en ai peut-être un aujourd’hui… La première fois que je suis allé à Marseille, c’était en 1969 et je n’ai pas aimé cette ville. Je l’ai trouvée sale et pauvre à beaucoup d’égards. Mais surtout, pour l’amateur d’art que je peux être, je ne l’ai pas trouvée belle. Je ne l’ai pas trouvé belle comme peuvent l’être des villes comme Bordeaux, Toulouse, Nancy,… Elles m’ont toujours paru beaucoup plus belles, beaucoup plus intéressantes que Marseille. A l’époque, je n’avais pas tout l’historique en tête, notamment la destruction du Panier. En revanche, elle s’est beaucoup améliorée sur le plan urbanistique. Déjà au temps de Defferre qui avait fait beaucoup (et en 1969 tout n’était pas fait), mais également par la suite, à l’époque de Vigouroux, puis de Gaudin. La ville s’est embellie et elle est devenue beaucoup plus agréable.
Malgré tout, Marseille est une ville passionnante. Ce que je dis de la beauté des villes ne vaut pas toujours pour leur intérêt. Bordeaux est une ville bourgeoise au possible. Si l’on veut s’en convaincre, il faut relire Mauriac. Marseille, c’est autre chose. Quand on lit sur Marseille, quand on y va, on apprend que Marseille tournait le dos à la France plutôt qu’elle n’en faisait partie. Il y a une fierté marseillaise qui pousse à se distinguer du reste du pays quand il le faut. C’est un melting pot où des gens venus de partout apprennent à cohabiter ensemble avec plus ou moins de réussite. C’est un creuset pour le reste de la France. Pour l’époque contemporaine, elle a un véritable intérêt sociologique. Contrairement à Paris, Lyon ou Lille, Marseille n’est pas une ville « plus » une banlieue. C’est une ville « et » une banlieue en même temps : la ville est très étendue, il n’y a pas de périphérique. La banlieue est dans Marseille. C’est une ville où il y a de l’espace.
S’il y a beaucoup de côtés attachants dans Marseille, il y en a de moins réussis. Depuis le début du XXe siècle, sa bourgeoisie n’a pas été très entreprenante et la ville n’a pas su se développer économiquement. Cela reste vrai. Marseille est une ville pauvre. Par ailleurs, il y a le « milieu », le banditisme, la petite ou moyenne délinquance qui créent beaucoup de problèmes.
Tout cela en fait d’une ville qui n’est pas la plus belle de France l’une des plus attachantes.
IFM : Au cours de vos recherches, vous avez dû vous rendre à Marseille….
Gérard Unger : Je suis allé à Marseille, à plusieurs reprises, pour « sentir » la ville. C’est important de sentir l’atmosphère d’un lieu avant d’écrire une page de son Histoire.
De la même manière, j’étais allé à Macon pour Lamartine et à Nantes et Saint-Nazaire pour Aristide Briand. A Nantes et à Saint-Nazaire, on ne retrouve plus grand chose parce que ces villes ont été détruites par les bombardements pendant la dernière guerre mondiale. A Macon, on ressent l’atmosphère du passé de la ville, et à Marseille aussi pour un passé proche.
IFM : Quelles ont été vos sources pour réaliser cette biographie ?
Gérard Unger : Les sources sont relativement simples et accessibles pour la quasi-totalité d’entre elles. Il suffit de prendre les débats parlementaires, les archives qu’Edmonde Charles Roux a déposées à la mairie et au département, les articles du Provençal et de la presse nationale, des témoignages. Avec ces quatre types de sources et quelques ouvrages, vous avez de quoi faire une bonne biographie de synthèse.
Prenons l’exemple de Defferre, Ministre de l’Intérieur. J’ai rencontré Eric Giuily, Frédéric Thiriez, Philippe Sanmarco et Michel Pezet. J’ai échangé un peu avec François Roussely. Je n’ai pas rencontré Robert Badinter mais il y a de nombreux éléments dans son dernier ouvrage.
Franchement, je ne me suis pas trouvé en pénurie de sources. Naturellement, il y a des domaines où les écrits peuvent manquer – par exemple, l’absence de relations avec « le milieu ». Mais pour le reste, on a tout.
De la résistance au maire de Marseille
IFM :Gaston Defferre, c’est avant tout le maire de Marseille. Chronologiquement, un lien logique s’établit entre l’engagement de Defferre dans la résistance et la prise politique de la ville. Seriez-vous d’accord pour dire que c’est la résistance qui amène Defferre dans la vie marseillaise ?
Gérard Unger : Guerre ou pas, résistance ou pas, je crois que Defferre, assez tôt, voulait être maire de Marseille où il est installé depuis le début des années 1930. Il semblerait qu’il aurait dit avant la guerre à Andrée Aboulker, sa première épouse, qu’il voulait être maire de Marseille. On ne peut pas complètement le confirmer. Mais c’est vrai que son attitude pendant la guerre et la résistance montre clairement sa volonté. On le voit lorsque De Gaulle lui propose de devenir député à l’Assemblée consultative en 1943 et qu’il refuse en affirmant vouloir rentrer en France, délivrer Marseille et en devenir le maire. C’était son ambition. Marseille a été l’essentiel de sa vie. Le Defferre législateur, le Defferre candidat à la présidence de la République, ça n’est venu que par surcroît.
Defferre ne se disait pas en se rasant le matin : « Je vais devenir président de la République ». Son but est d’abord et clairement Marseille. Le Provençal, il l’a utilisé pour dominer Marseille. Les grandes lois qu’il a portées sont aussi liées à Marseille :
– la loi de 1946 sur la presse, c’est – en partie – pour prendre le contrôle du Provençal
– la loi de 1950 sur la marine marchande : le lien avec Marseille est assez évident.
– la loi de 1956 sur la décolonisation : le lien est moins évident quoique Marseille travaillait comme port avec les colonies.
– la loi de 1982 : c’est clairement une volonté de décentralisation car il a trop souffert comme maire de Marseille des difficultés face aux administrations parisiennes.
IFM : C’est une facette du personnage assez peu mise en avant mais Defferre semblait être un grand résistant…
Gérard Unger : Oui, c’était un grand résistant. Un résistant courageux et de la première heure. Le courage, beaucoup en ont fait preuve. Mais à résister dès 1940, ils ont été peu nombreux. Dès 1940, il veut en découdre. Il ne peut pas gagner Londres mais dès juillet-août 1940, il est en contact avec ceux qui veulent résister aux Allemands et au régime de Vichy. Les liens avec Félix Gouin[[En 1940, il fait partie des quatre-vingts parlementaires à refuser les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
]] sont très nets et Gaston Defferre participe à la création du réseau Brutus…
IFM : Vous décrivez cette scène incroyable où Gaston Defferre est reçu par le préfet Bussière, successeur de Bousquet à la tête de la police, pour tenter de faire libérer l’un de ses compagnons. Et on ne l’arrête pas… Defferre racontera : « La situation était surréaliste. Tous savaient qui j’étais, quel était mon rôle dans la Résistance. […] Je ne m’attendais pas à être reçu comme un personnage officiel ». C’est presque un entretien entre deux forces politiques ?
Gérard Unger : On parle de puissance à puissance. Pour les Vichystes – non pas « les collabos » mais les hauts fonctionnaires nommés par Vichy –, il était clair qu’il fallait préparer l’avenir. Ils se disaient « ça va bouger, ça va changer ». Le calcul n’était pas entièrement cynique. Il pouvait y avoir une part de sincérité chez chacun. On ne peut pas sonder les reins et les cœurs. Chez Papon, la part de sincérité me parait faible. Chez Bussière, je ne sais pas… je n’ai pas étudié le personnage. Ce type de rencontres avait lieu à partir de fin 1943/début 1944. Les hauts fonctionnaires français savaient que le sort de la guerre était à peu près joué. On ne connaissait ni le jour, ni l’heure, ni les modalités de la fin mais il fallait être aveugle pour ne pas voir qu’après Stalingrad, l’Allemagne et Vichy n’allaient pas gagner.
IFM : Finalement Defferre est en contact avec tout ce qui fait la résistance intérieure et extérieure…
Gérard Unger : La Résistance se compose d’une multitude de réseaux interconnectés. Le réseau Brutus a mis du temps à trouver sa place. C’était un réseau lié aux socialistes. Cela ne plaisait pas à Jean Moulin qui ne voulait pas voir se reconstruire les vieux partis et souhaitait que les réseaux de résistance soient l’ossature politique de la France de demain. Les socialistes répondaient : « pourquoi le parti communiste et pas nous ? ». Le parti communiste avait une puissance dans la résistance que n’avaient pas les socialistes. Mais ces derniers étaient présents un peu partout et avaient ce réseau Brutus. Les socialistes l’ont pris alors qu’il était monté par un cagoulard, Fourcaud, qui était tout sauf socialiste. Ce sont les hasards de la résistance. Lorsque l’on voulait résister, on se rapprochait d’un réseau, où certes il pouvait y avoir des dominantes – Combat était plus à droite que Franc-Tireur ou Libération – mais cela n’était pas l’essentiel. Je raconte la première rencontre entre Fourcaud et Félix Gouin : ils sont à l’opposé l’un de l’autre. Mais qu’est-ce que l’on veut ? Mettre les Allemands dehors… quelles que soient les motivations des uns et des autres, ils parviennent à s’entendre.
IFM : Defferre était-il dans cette logique là ? Ce qui expliquerait pourquoi un peu plus tard – sous la IVe République – il avait des amitiés partout ?
Gérard Unger : La résistance, c’était une fraternité. Qu’on soit dans tel ou tel réseau, on sait les dangers encourus, on sait qui s’est battu, qui ne s’est pas battu. On sait qui sont les tièdes et ceux qui ont risqué leur peau. Ils peuvent être gaullistes comme Chaban-Delmas : cela crée néanmoins une amitié qui restera jusqu’au bout. Avec les communistes, c’est différent. Defferre n’a pas oublié qu’en 1940, ils n’étaient pas dans la résistance. On a trop tendance à l’oublier, par exemple, lorsque Sarkozy honore Guy Môquet. Guy Môquet était un gamin qui ne méritait pas d’être fusillé mais quand il a été arrêté en 1940, ce n’était pas parce qu’il appelait à la résistance contre les nazis. Le parti communiste faisait distribuer des tracts dénonçant la guerre impérialiste entre l’Angleterre et l’Allemagne nazie. Il ne faut pas se raconter d’histoires. Defferre n’a pas oublié que Duclos et d’autres ont demandé la reparution de l’Humanité en juillet 1940 aux autorités allemandes. Les communistes sont entrés dans la résistance quand l’URSS a été envahie. Et cela, pour Defferre c’est un peu particulier et il ne l’oublie pas.
Ceux qui se sont engagés seuls dès 1940-41 et qui combattaient les Allemands et le régime de Vichy – car chez Defferre, il fallait combattre les deux – faisaient partie de cette fraternité que l’on garde toujours en mémoire.
IFM : Il se retrouve pourtant aux côtés du PCF pour la prise politique de Marseille ?
Gérard Unger : Bien entendu. La prise politique se fait ensemble, tout en essayant de mesurer le rapport de force pour qu’il soit le plus favorable.
Il y a une alliance où l’un surveille l’autre. Les communistes acceptent que Defferre devienne le président de la délégation municipale – il n’y avait plus de maire – parce que c’était les socialistes qui dirigeaient la ville avant-guerre. Ils se disaient : « on en fera qu’une bouchée ». La tactique bien connue « de plumer la volaille socialiste » existait. On laisse les socialistes en avant et le moment venu on leur fait la peau. Leur calcul n’était pas mauvais : Defferre se fait battre.
De son côté, Defferre fait preuve d’une grande méfiance à l’égard des milices communistes. Lorsque De Gaulle les dissout en 1944, il voit cette décision d’un bon œil.
IFM : Revenons plus précisément au maire de Marseille. Peut-on considérer Gaston Defferre comme le modernisateur de cité phocéenne ?
Gérard Unger : Modernisateur, oui. Mais ce n’était pas difficile de faire mieux que le Marseille d’avant-guerre. A part l’escalier de la gare Saint-Charles, il n’y a pas eu de grands travaux entre les deux guerres.
Releveur de ruines, indéniablement. Je ne savais pas que Marseille avait été détruite à ce point. Outre les bombardements, c’est la destruction du quartier du Panier par les Allemands au début 1943 qui fut la plus spectaculaire. On a tendance à l’oublier : ils ont détruit le cœur de la ville populaire et procédé à des vagues de déportation (les Juifs vers les camps de la mort, les résistants vers d’autres camps, la population vers Fréjus).
L’image de Marseille était telle dans l’imaginaire nazi qu’il fallait purement et simplement la démolir. La bataille de Marseille a rendu le port complètement inutilisable. Il a fallu relever tout cela.
Defferre ne pouvait pas faire grande chose entre 1944 et 1945. Mais déjà entre 1945 et 1953 des choses ont été faites. Les projets pour reconstruire le quartier du Panier étaient largement avancés. Néanmoins, ils n’étaient pas satisfaisants et Defferre a fait modifier les plans des grandes barres que Pouillon voulait construire.
Pour le reste, Marseille était une ville complètement endettée, sans réseau routier digne de ce nom, une succession de villages mal reliés les uns aux autres, tout juste de l’eau potable et une industrie déclinante. Defferre s’est attaqué à tout cela. Il s’est d’abord attaqué aux finances entre 1953 et 1955, ensuite il s’est attelé à l’enseignement parce qu’il y avait le baby-boom, puis aux routes, à l’eau potable et ensuite à la santé avec des hôpitaux modernes, et enfin l’enseignement supérieur. Il a fait les choses méthodiquement, étape par étape.
IFM : Après cette grande période de modernisation, vous dites qu’il s’est un peu assoupi ?
Gérard Unger : Oui à la fin. Trente-trois ans à la tête d’une ville, c’est long, trop long. De mauvaises habitudes reviennent, on est moins attentif, on n’a plus le même souffle ni la même imagination. Defferre vieillissait, il ne voulait pas de successeur. Il avait un côté un peu autocratique. A la tête d’une ville comme d’une entreprise, il faut avoir du temps devant soi mais il ne faut pas non plus rester trop longtemps au risque de n’avoir plus rien à donner.
A partir de la fin des années 1960, on sent un essoufflement, sauf dans le domaine culturel grâce à Edmonde Charles-Roux, et à l’arrivée du métro en 1977.
Les mauvaises habitudes, il les avait purgées au début et, comme de mauvaises herbes, elles ont fini par revenir. Il fallait les éradiquer et il a fait appel à Sanmarco avec pour mission, à partir de 1977-1978, « de nettoyer les écuries d’Augias ». On peut penser à ce qui s’est passé en 1982 avec les fausses factures prolongement de l’affaire Lucet. Si cela avait éclaté quatre ans plus tôt, c’était Defferre lui-même qui aurait pu être emporté. L’incendie a été circonscrit grâce à la volonté politique de Defferre et l’habilité administrative de Sanmarco.
IFM : Finalement, la ville de Marseille apparaissait-elle comme un laboratoire aux yeux de Gaston Defferre ?
Gérard Unger : Non, ce n’est pas une ville laboratoire. Ce sont les problèmes rencontrés dans cette ville qui l’ont amené à des réflexions la dépassant, comme les lois de décentralisation, sur la marine marchande… Defferre n’était pas un imaginatif mais il savait gérer. C’était un pragmatique. Par exemple, il aurait aimé éviter de mendier de l’argent dans les ministères : c’est pour cela qu’il a fait la décentralisation. De même, il a déposé beaucoup de propositions de lois sur les dettes des communes, sur les appels d’offres concernant les transports et les réseaux d’eau… Il a vu les dégâts que cela pouvait causer. Marseille était une ville en faillite plus souvent qu’à son tour. Entre 1953 et 1986, elle ne l’a jamais été parce que Defferre était un très bon gestionnaire.
L’homme de presse
IFM : Comment peut-on expliquer cet intérêt pour la presse d’un homme qui était avocat de formation ?
Gérard Unger : C’est lié à Marseille. Defferre n’a jamais voulu construire un empire de presse. Comme il se plaisait à le dire : « s’il avait voulu le faire, il l’aurait fait ». Lorsqu’au début des années 1980, l’Elysée le sollicitait pour racheter tel ou tel journal – pour contrer Hersant ou parce qu’un journal de gauche était en train de « crever » -, il déclinait fermement l’offre. Ce qui l’intéressait, c’était le Provençal. C’était un moyen d’influence sur Marseille. De même, le contrôle du Méridional – contrôle un peu baroque1 –, était fait pour empêcher qu’un autre ne reprenne le journal.
IFM : C’est une partie amusante. Il ne cherche même pas à changer l’orientation politique de ce journal.
Gérard Unger : Cela ne servait à rien. Le Provençal avait déjà une ligne politique bien identifiée. Changer celle du Méridional aurait pu laisser un espace à un autre journal de droite. Defferre préfère mener une politique bien plus intelligente. Il contrôle économiquement un journal de droite et place un homme de confiance à sa tête, Roland Singer. Et pour le reste – les propos injurieux de Gabriel Domenech2, par exemple, – on fait avec. Il y a des lignes jaunes à ne pas franchir. Elles l’ont rarement été…
IFM : Vous racontez dans votre ouvrage le temps que pouvait passer Defferre à préparer un éditorial. Il semblait s’occuper de son journal…
Gérard Unger : Il contrôlait vraiment les éditoriaux. Il en écrivait lui-même s’il estimait que ça en valait la peine. Sinon, il avait des hommes de confiance… Par ailleurs, il donnait des consignes sévères à ses équipes dans le traitement de ses adversaires politiques : on n’en parlait jamais et on ne les montrait jamais en photographie.
Beaucoup tremblaient devant le patron. Au Provençal, c’était le patron. Il décidait de la ligne. Il était attentif et autoritaire.
IFM : Quels étaient ses rapports avec les autres médias ?
Gérard Unger : Ce n’était pas un patron de médias, au sens large du terme. Il ne cherchait pas à le devenir.
Dans le milieu de la presse écrite, il ne fallait pas marcher sur ses plates-bandes. D’où des accords compliqués, parfois difficiles à respecter, avec le reste de la presse régionale : Bavastro pour Nice-Matin, Bujon pour le Midi-Libre et Ligniel pour le Progrès. Ces rapports l’intéressaient particulièrement.
Il avait dans une moindre mesure un intérêt pour RMC. Il ne fallait pas que la station le gêne. Lorsque l’on passait des spots publicitaires de Minute sur les fausses cartes du PS, il déclenchait une bataille à boulets rouges.
Concrètement, seuls les médias de sa zone d’influence l’intéressaient. Ailleurs, non.
IFM : Et avec les journalistes parisiens ? Vous parlez de Jean-Jacques Servan-Schreiber, évidemment…
Gérard Unger : Ce n’était pas le journaliste qui l’intéressait chez Jean-Jacques Servan-Schreiber. Les deux hommes ont sympathisé parce qu’ils avaient la même vision moderniste du pays. Ils étaient tous les deux sensibles à la modernisation économique, à ce que voulait faire Mendès, sensibles à tout ce qui venait des Etats-Unis, à la bonne gestion, au management. Defferre était intéressé par l’homme qui avait une vision qui ressemblait à la sienne. Il était proche de ceux qui tournaient autour de Mendès dans ces années-là, qui apportaient une vision de gauche modernisatrice loin de celle de la vieille gauche idéologique du PC ou d’une partie de la SFIO.
Avec les autres journalistes ? Defferre n’était pas dupe. Lorsqu’il a été secrétaire d’Etat à l’information en 1946, il a nommé quelques-uns de ses proches à la radio. Par ailleurs, il avait de bons rapports avec certains d’entre eux. Pendant vingt ans, il a été ami avec Françoise Giroud. Ils se sont fâchés en 1974.
A suivre…
- Concurrent de droite du Provençal à Marseille, le Méridional était détenu depuis 1966 par la famille Brémond qui possède également Le Progrès de Lyon et Le Dauphiné. Le 24 février 1971, Defferre signe un contrat avec les Brémond prévoyant que les deux journaux marseillais seraient imprimés sur les rotatives du Provençal, qu’il y aura couplage de la publicité, une rédaction commune pour les informations locales, une distribution conjointe, un regroupement des services techniques… Pourquoi un texte aussi détaillé qui a l’allure d’un contrat de vente sans en être un ? Tout simplement parce que l’ancien propriétaire du Méridional, Jean Fraissinet, adversaire irréductible du maire de Marseille, avait fait insérer lors de la vente de son journal en 1966 une clause précise : l’interdiction de revendre le Méridional à Defferre.
- Rédacteur en chef du Méridonial, Gabriel Domenech deviendra député du Front national.