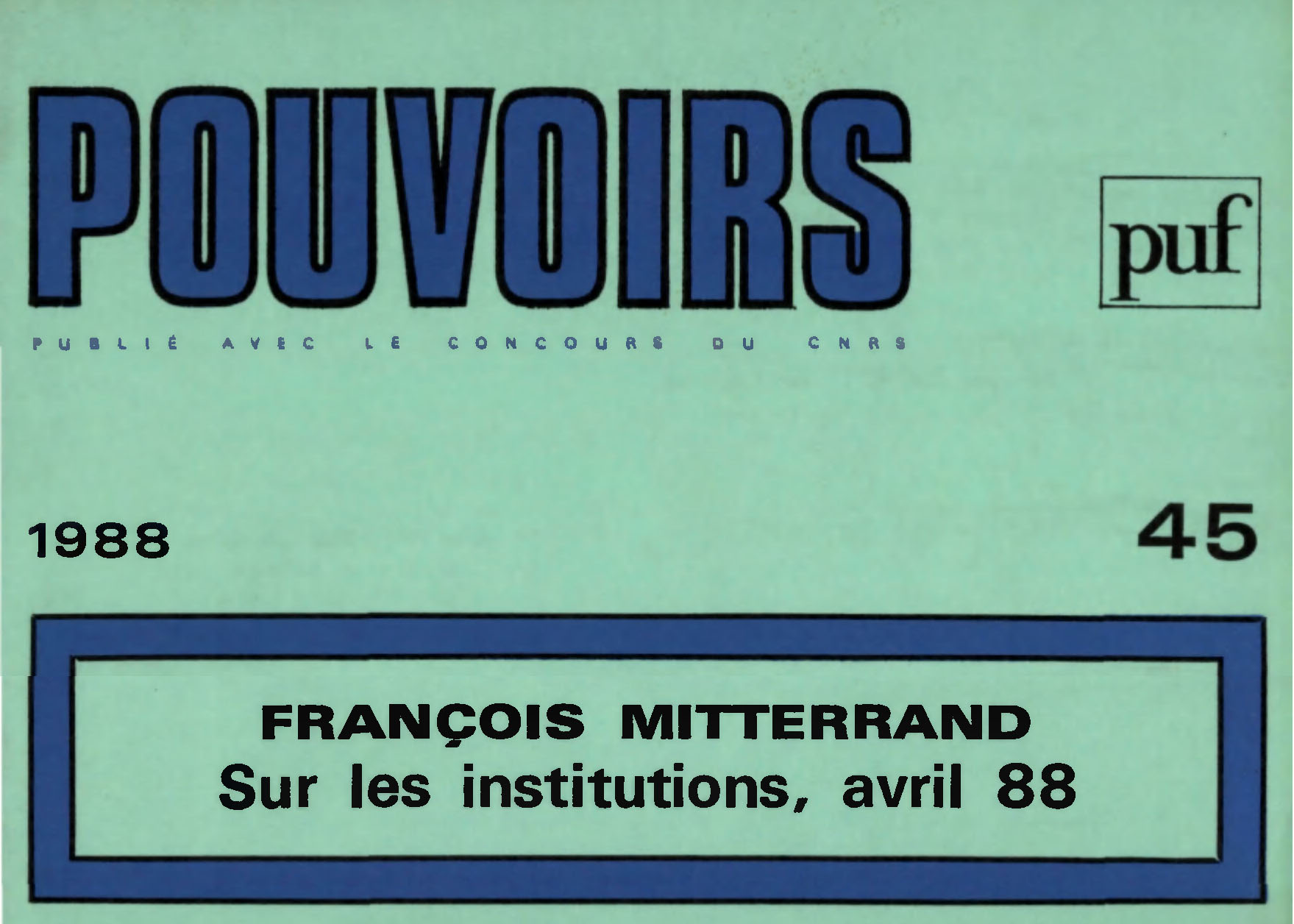Le Président de la République a accepté de s’entretenir avant la fin de son septennat avec Olivier Duhamel sur les problèmes institutionnels français.
Ces entretiens se sont achevés le 7 mars 1988, c’est-à-dire avant que le Président de la République ne fasse part de sa décision concernant sa candidature à l’élection présidentielle de 1988.
On en trouvera ci-dessous le texte intégral dans le N°45 de la revue Pouvoirs.
Vous avez été élu Président de la République au terme de près d’un quart de siècle d’opposition durant la Ve République. Ce que vous saviez et ce que vous imaginiez de la réalité du pouvoir présidentiel a-t-il été confirmé ? Quelles ont été vos surprises ?
Non, je n’ai pas été surpris. Le Président de la République, qui ne faisait pas tout, pouvait tout faire. Rien d’étonnant si le régime, demeuré parlementaire dans son principe, ne trouvait pas son équilibre. Je savais en arrivant à l’Elysée que la recherche de cet équilibre serait l’une de mes tâches principales. J’ai réduit peu à peu l’envahissement quotidien de dossiers qui n’avaient pas à remonter à la présidence. Ce n’était que le début d’une remise en ordre qui continue de me paraître nécessaire.
Durant les cinq premières années de votre mandat présidentiel vous avez bénéficié d’une majorité absolue de députés disposés à vous soutenir comme, avant vous, le Général de Gaulle et Georges Pompidou. Les constitutionnalistes en déduisent que le présidentialisme dominant s’est poursuivi sans grand changement. Or, vous estimez, à l’inverse, avoir amorcé un rééquilibrage des pouvoirs, une modification de la pratique institutionnelle dans vos relations avec le Gouvernement.
Le Général de Gaulle et M. Pompidou avaient obtenu la majorité absolue pour la coalition qu’ils dirigeaient. Première dans l’histoire de la République, cette majorité a été conquise en 1981 par un seul parti, le Parti socialiste. Certes, j’ai veillé à la bonne application des engagements que j’avais pris devant le peuple français. Mais les constitutionnalistes dont vous me parlez vont quand même un peu vite dans leurs déductions.
J’avais assez réfléchi et écrit sur ce sujet pour être prêt, devenu responsable, à changer la pratique constitutionnelle. Cependant une trop longue absence du pouvoir, et, par-là, une certaine inexpérience des ministres ne nous a pas permis, à Pierre Mauroy et à moi, d’aller aussi vite que nous le souhaitions. J’ai parachevé l’évolution avec Laurent Fabius. Après mars 1986, M. Chirac a souvent cru m’arracher des compétences que j’avais déjà réaménagées.
Et dans le rôle dévolu au Parlement ?
Les Premiers Ministres socialistes ont usé avec modération des moyens que leur accordaient la constitution et le règlement de l’Assemblée nationale en laissant la plupart des débats parlementaires suivre leur cours sans procédures contraignantes. Ils y ont eu quelque mérite, si l’on se souvient que c’est à partir de 1981 qu’a été systématisé, par l’opposition de l’époque, un véritable blocage de la machine parlementaire.
Et dans les rapports avec les citoyens ?
La décentralisation, les lois Auroux, la démocratisation du secteur public, la participation des assurés à la gestion des régimes sociaux, etc., répondent pour moi.
Vous êtes le premier Président de la Ve République qui ait perdu des élections législatives. Comment expliquez-vous cet échec ? Auriez-vous pu l’éviter ?

J’ai pris la direction du Parti socialiste alors qu’il représentait 11 % de l’électorat. Luttant pour qu’un jour cette minorité devînt majorité, je ne pensais pas que cela se produirait avant longtemps. Mes 26 % du premier tour de l’élection présidentielle de 1981 ont battu le record de toute l’histoire du socialisme.
La victoire massive de juin 1981 aux élections législatives, un mois après mon élection, risquait de faire illusion. En réalité les Français avaient voté comme s’il s’était agi d’un référendum et il n’aurait pas été sage de tabler durablement sur ce raz de marée. La réalité politique de la France ne permet pas ce genre d’illusions. Les choses se font plus lentement.
C’était déjà un résultat remarquable pour les socialistes que d’atteindre 32 % des suffrages le 16 mars 1986. Je n’ai donc pas ressenti ce scrutin comme un échec. J’y étais préparé. Il me restait à poursuivre l’effort, là où j’étais.
Plus précisément, quels ont été les principaux succès, quelles ont été les principales erreurs de la gauche entre 1981 et 1986 ?
Les historiens se chargeront de trancher ce débat. Nous avons en tout cas rendu l’alternance possible en démontrant que la gauche, au-delà de ses vertus propres, savait gouverner, et dans la paix sociale. Elle sait aussi maintenant que lorsqu’elle gagne, c’est la France qu’elle prend en charge.
Au lendemain de la victoire de la droite, vous avez appelé Jacques Chirac pour former un nouveau gouvernement. Au regard des prérogatives présidentielles, le choix du président du principal parti de la nouvelle majorité ne crée-t-il pas un précédent discutable ?
Je me suis posé la question. Mais ce choix, c’était la sagesse, on le voit aujourd’hui. Il eût mieux valu que M. Chirac se démît de ses fonctions de chef de parti. On fait avec ce qu’on a.
Et la constitution d’un gouvernement composé des dirigeants des principaux partis n’est-elle pas dans la tradition de la ive République plus que dans celle de la Ve ?
Vous avez raison. En rappelant dans son gouvernement des dirigeants de formations politiques décidés à le rester, le Premier ministre est retourné aux plus fâcheuses habitudes de la ive République. Je l’avais pourtant, et avec insistance, alerté. Il lui était difficile, sans doute, d’interdire aux autres ce qu’il se permettait à lui-même. Ce n’est pas à recommencer.
Quels ont été les développements de la cohabitation les plus inattendus ?
De mon point de vue, rien. Tout était prévisible. A la limite, me reportant à votre précédente question, je dirai que je ne pensais pas que les dirigeants de la nouvelle majorité répéteraient aussi vite les erreurs de la ive République. C’était sans doute leur pente naturelle. Ce n’est pas la mienne.
Depuis le 16 mars 1986, la pratique des institutions s’est-elle déroulée conformément à vos vœux ? Sur quels points ne vous a-t-elle pas satisfait ?
J’ai dû arrêter les tentatives de débordement que vous avez pu constater dans les domaines de la politique extérieure et de la Défense. Cela s’est réglé assez vite, et sur la politique européenne, et sur la stratégie de dissuasion, et sur la politique à l’égard du Tiers Monde, et sur l’Amérique centrale, et sur l’apartheid, et sur le désarmement nucléaire et sur I’IDS, etc., etc. Quant aux relations entre le Gouvernement et le Parlement, je les aurais aimées plus respectueuses des droits de ce dernier. Au moment où s’achève cette période, la fonction présidentielle reste intacte et conforme à la Constitution.
Pourquoi avez-vous accepté en certains domaines un repli présidentiel vous cantonnant parfois en deçà de vos prérogatives constitutionnelles ? Je pense par exemple aux nominations de hauts fonctionnaires…
En deçà, non. J’ai maintenu ce qui devait l’être. Mais j’ai laissé le gouvernement gouverner, ce qui était aussi mon devoir.
La cohabitation s’est finalement déroulée sans crise. Le Premier ministre aurait cependant pu la déclencher, par exemple en juillet 1986 lorsque vous avez refusé de signer les ordonnances sur les privatisations. Qu’auriez-vous fait s’il avait démissionné ?
Je l’aurais remplacé.
Comment auriez-vous pu assurer la survie d’un nouveau gouvernement ?
Renverser un gouvernement exige la majorité absolue des députés. Ce n’est jamais acquis d’avance. Mais si cela était arrivé, j’aurais remplacé le Gouvernement censuré. Et si celui-ci avait été à son tour battu, j’aurais dissous l’Assemblée nationale. En aucune circonstance je n’aurais quitté mes fonctions.
Vous attendiez-vous à connaître un regain de popularité aussi important dans sa durée comme dans son ampleur ?
Non. Mais ce « regain de popularité », comme vous dites, avait commencé avant mars 86. En fait, dès l’été 85.
Quels sentiments éprouvez-vous lorsque des Français vous appellent « tonton » ? Quel type de relation entre les gouvernés et le Président cette expression relève-t-elle ?
Je ne me reconnais pas dans ce terme familier dont l’intention est, à l’évidence, sympathique. Je n’en tire aucune autre conclusion sinon qu’il existe une relation affective entre beaucoup de Français et moi, fondée sur la confiance. Ce n’est pas pour me déplaire.
Le candidat François Mitterrand proposait une modification du mandat présidentiel soit dans le sens du quinquennat, soit du septennat non renouvelable. Quelles sont vos pensées sur ce point sept ans après ?
Je souscrirais à celle de ces réformes qui pourrait réunir une large majorité dans les deux assemblées, ce qui n’a pas été réalisable après 1981.
Quelles seront les principales traces laissées par la cohabitation (ou, si vous préférez mais pourquoi préférez-vous ce terme la coexistence institutionnelle) ?
Je préfère cette dernière expression parce qu’elle souligne que la situation ainsi créée n’a pas résulté de ma volonté personnelle mais du seul souci que j’avais de respecter la Constitution, c’est-à-dire la loi commune. La trace qu’elle laissera sera profonde. Chacun des pouvoirs sait désormais qu’il existe et voudra exercer sa pleine compétence, y compris lorsque majorité parlementaire et majorité présidentielle coïncideront de nouveau.
Lorsque vous parlez d’un nouvel équilibre des pouvoirs, qu’entendez-vous exactement dans le partage du pouvoir entre le Président et le Premier ministre ?
Le Président de la République exerce à la fois une fonction d’autorité, notamment dans les domaines désignés par l’article 5 de la Constitution, et une fonction d’arbitrage, de conciliation, de conseil en de multiples circonstances. Sa fonction d’autorité ne peut se substituer à celle du Gouvernement, et le Gouvernement, de son côté, doit se garder d’empiéter sur la fonction présidentielle. Mais la Constitution est là-dessus rédigée de façon très confuse. Témoin l’ambiguïté de l’article 5 et de l’article 20. La République aurait beaucoup à gagner à une répartition claire des tâches ; à une détermination plus précise des frontières au sein du pouvoir exécutif. Je trouverais excellent que le peuple, consulté, en décidât.
Le Président doit-il pouvoir révoquer le Premier ministre ?
Le Premier ministre, qui met en œuvre la politique de la majorité parlementaire, ne peut être révoqué que par elle.
Quel doit être le rôle des conseillers du Président ?
Pardonnez la redondance : conseiller le Président. Leur rôle s’arrête là. S’ils en sortent, ils manquent à leur devoir d’Etat. Après 1958, le cabinet du Président a longtemps eu tendance à se considérer comme un gouvernement bis. Ces mauvaises moeurs n’ont plus cours, mais chassez le naturel… J’ai naguère rappelé à l’ordre certains de mes collaborateurs qui s’étaient permis des interventions auprès des ministères. Je réagirais plus sévèrement encore aujourd’hui.
Les ministres disposent-ils d’une autonomie suffisante ?
En principe, oui. En pratique, cela dépend du tempérament du Premier ministre.
Jusqu’à quelle limite est-il souhaitable que des débats au sein du gouvernement s’expriment publiquement ?
Jamais. Le Gouvernement forme un tout. Aucun débat public entre ministres n’est acceptable.
La revalorisation du Parlement fait un peu figure de cliché pour campagne électorale, sans grande conséquence. Quels sont les moyens concrets pour permettre à l’Assemblée de jouer un rôle plus utile et plus visible ?
Vous touchez là l’un des problèmes centraux du système parlementaire où l’on navigue entre deux écueils : d’une part, l’excès des procédures parlementaires qui conduit au régime d’assemblée, d’autre part la soumission aux volontés du gouvernement qui conduit au système consulaire.
Afin d’y remédier, je conseille au Gouvernement de ne se servir que par exception des moyens contraignants dont il dispose et aux Assemblées de montrer une conscience plus fière de leurs droits. Elles devraient à cet égard s’affirmer beaucoup plus rigoureuses pour l’absentéisme qui les discrédite, ordonner plus strictement leurs débats, consacrer au moins deux après-midi par semaine aux questions posées aux ministres, contrôler de plus près leur action.
Faudrait-il, à terme, aller jusqu’à déconnecter le Gouvernement de l’Assemblée, supprimer donc la responsabilité parlementaire du Gouvernement pour que, à l’image des Etats-Unis, le Parlement remplisse son rôle de législateur et de contrôleur en toute indépendance ?
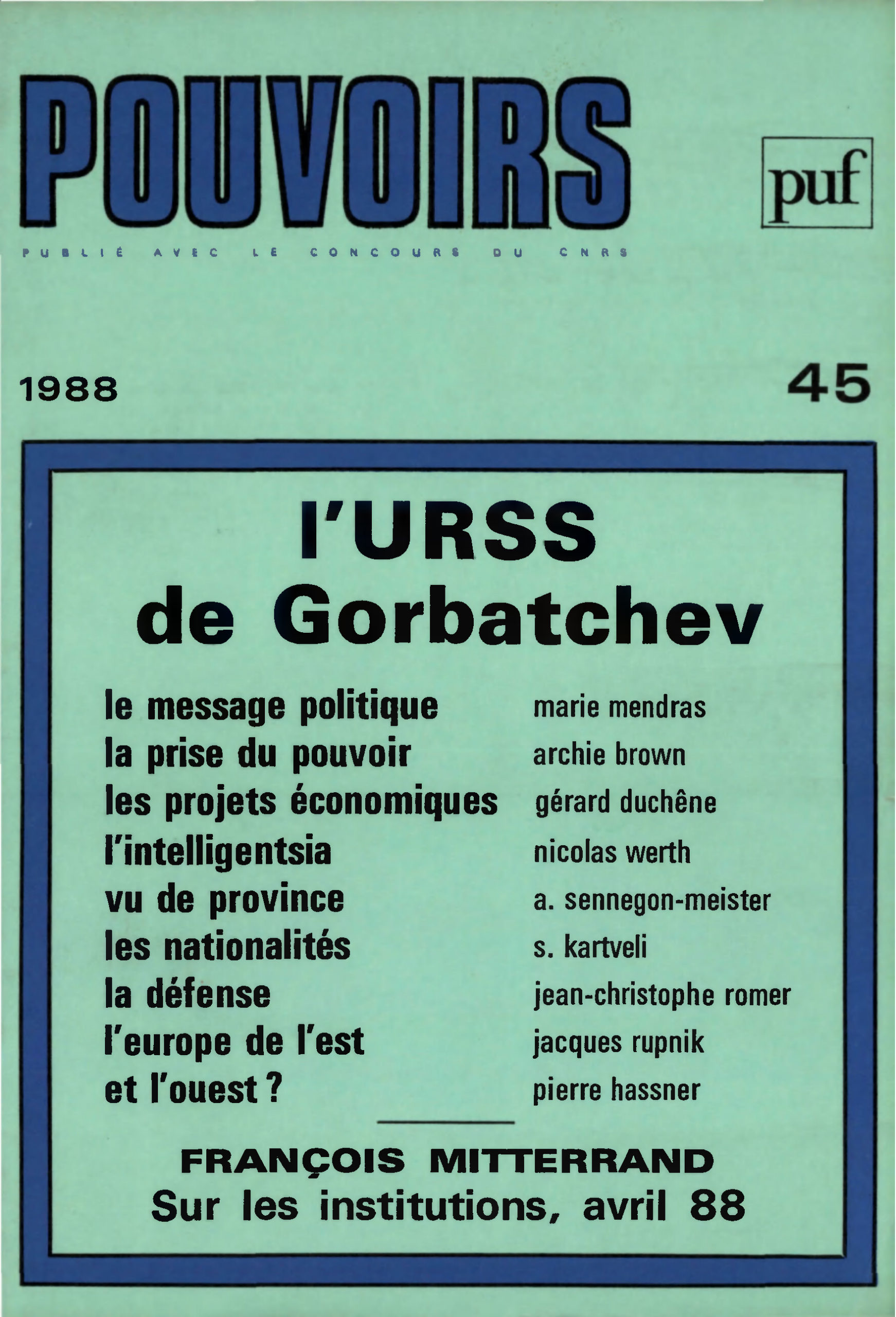
Que penseriez-vous, dans cette hypothèse, de l’instauration d’une vice-présidence de la République ?
Je ne retiens pas l’hypothèse.
Vous vous êtes prononcé à plusieurs reprises pour une extension du référendum. Pourquoi et comment ?
La Constitution n’autorise le référendum que s’il porte sur un accord international ou sur l’organisation des pouvoirs publics. Pas sur ce que l’on appelle les « problèmes de société ». J’ai proposé en 1984 une révision constitutionnelle pour élargir le champ du référendum. Le Sénat l’a refusée. Cette idée s’imposera pourtant un jour ou l’autre. Il faudra de même réfléchir à l’institution du référendum d’initiative populaire, moyen d’expression intéressant pour les citoyens.
Admettez-vous que l’article 11, tel qu’il existe, soit utilisé pour une révision constitutionnelle, comme le fit le Général de Gaulle, avec succès en 1962, sans succès en 1969 ?
L’usage établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme l’une des voies de la révision, concurremment avec l’article 89. Mais l’article 11 doit être utilisé avec précaution, à propos de textes peu nombreux et simples dans leur rédaction. Sinon, il serait préférable que la consultation des Français fût éclairée par un large débat parlementaire.
Le Conseil constitutionnel pourrait-il être mieux associé au référendum en donnant un avis public préalable ?
À l’heure actuelle, il est préalablement consulté, en vertu des articles 60 de la Constitution et 46 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, sur l’organisation du scrutin.
Comme il s’agit d’un avis qui ne porte que sur des questions très matérielles, souvent techniques, parfois mineures et de détail, il n’y a pas là de quoi retenir l’intérêt de l’opinion publique : c’est pourquoi cet avis est exclusivement destiné au Président de la République et au Gouvernement. Le Conseil agit d’ailleurs de la même façon pour l’élection présidentielle, et personne n’a jamais demandé la publication des avis qu’il rend à ce sujet.
Mais, en revanche, si le champ du référendum de l’article 11 devait être étendu un jour aux libertés et aux problèmes de société, un avis public du Conseil constitutionnel sur la conformité de la question référendaire à la Constitution, à son préambule, aux lois fondamentales de la République serait indispensable.
Le Conseil constitutionnel a évolué et votre jugement sur l’institution, très sévère à l’origine, semble avoir accompagné cette évolution. Jusqu’à quel point ?
Les passions se sont apaisées en même temps que le Conseil constitutionnel, surtout après l’extension des conditions de sa saisine en 1974, forgeait une jurisprudence moins sensible à l’opportunité. On peut dire qu’il a progressivement trouvé son « rythme de croisière ». Je m’en réjouis.
Disposant de grands pouvoirs, il doit à tout prix éviter de s’ériger en gouvernement des juges.
Plus généralement, que pensez-vous de la multiplication d’autorités administratives indépendantes : Commission des opérations de bourse, Commission nationale d’informatique et libertés, Commission des sondages, Haute Autorité, CNCL, Comité d’éthique, etc. ?
C’est une bonne chose que les domaines qui touchent de près aux libertés publiques soient protégés par des organismes indépendants des engagements et remous politiques. A condition qu’ils soient réellement indépendants et non pas camouflage déshonorant pour ceux qui s’y prêtent, à condition aussi que ce ne soit pas une simple habileté de circonstance pour permettre à un gouvernement d’échapper à ses responsabilités. On ne peut pas dire que la totalité des organismes que vous me citez ait répondu à ces deux exigences. Leur autorité morale en dépend.
La France a connu ces dernières années un développement démocratique non négligeable. Quels sont les principaux pas que vous aimeriez la voir accomplir d’ici l’an 2000 ?
Les institutions représentatives doivent être plus vivantes, et je ne pense pas seulement au Parlement ; la décentralisation plus poussée ; l’Etat et son administration moins lourds, moins vexatoires ; la justice plus accessible aux citoyens, moins chère, plus rapide, plus dégagée des pressions du pouvoir politique ; la vie politique plus transparente ; l’information vraiment libre ; les citoyens, les travailleurs consultés sur les grandes questions qui les concernent. Et, par-dessus tout, que soit repris le chemin de l’égalité des chances. Droit, justice, démocratie, ce sont des mots qui se confondent. Bref, cela fait du pain sur la planche.