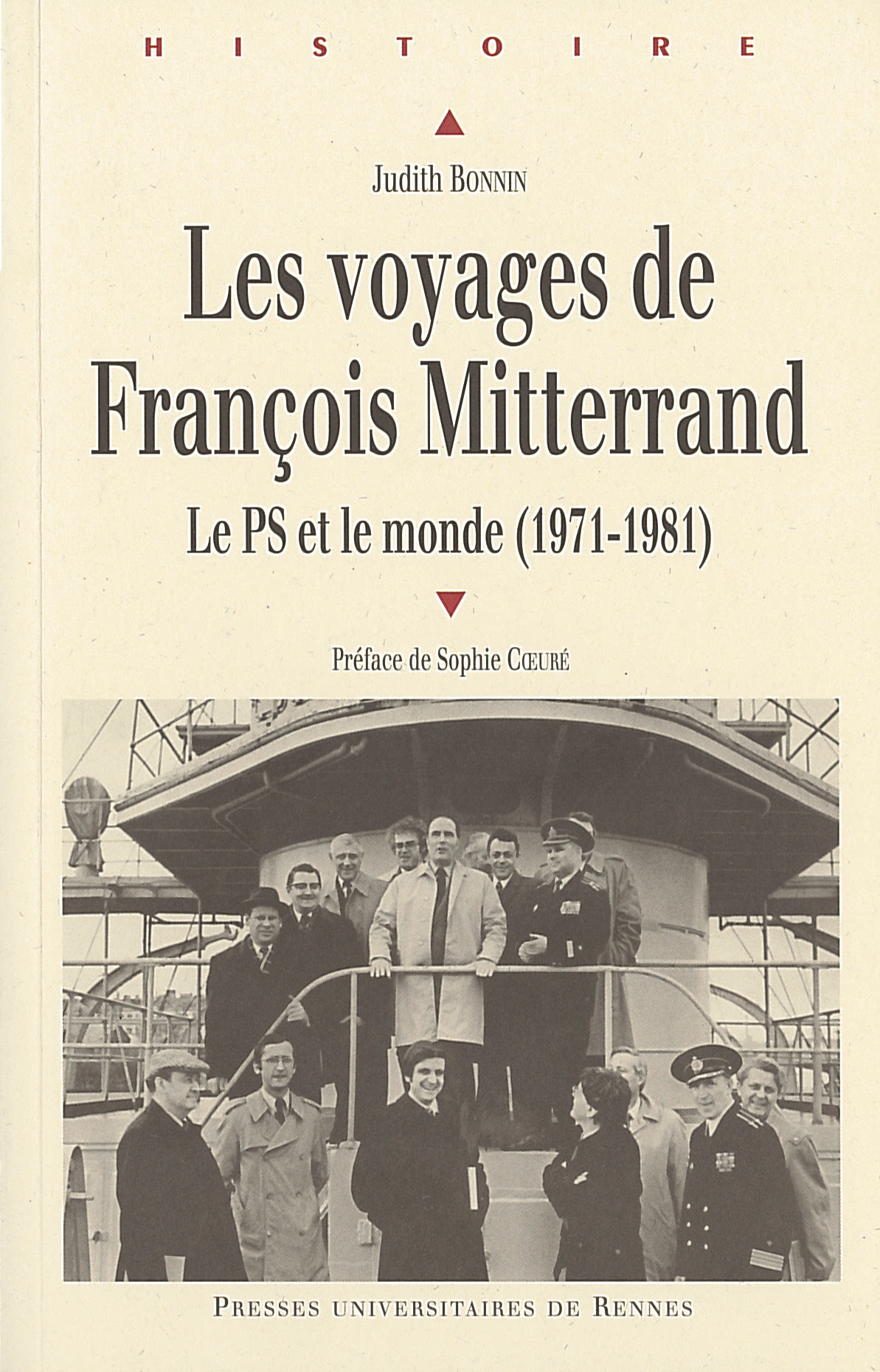Allocution prononcée par François Mitterrand, président de la République Française, au centre national et musée Jean-Jaurès à Castres, à l’occasion de son inauguration le mercredi 16 novembre 1988.

Je vous remercie de vos paroles d’accueil. Déjà depuis quelques heures dans le Tarn, j’ai pu rencontrer plusieurs des élus de ce département. Je me réjouis maintenant d’être à Castres et de pouvoir poursuivre encore quelques instants le dialogue que nous avons déjà amorcé.
J’ai pu voir quelques belles réalisations et particulièrement celle pour laquelle je suis initialement venu, c’est-à-dire le musée Jean-Jaurès.
J’ai pu cependant, m’arrêtant à Réalmont, constater des réalisations locales d’envergure, un nouveau collège. J’aurais pu sans doute m’arrêter en bien d’autres endroits, dans d’autres villes et constater les progrès constants grâce, il faut le dire, au dévouement et à l’assiduité des élus de ce département.
Vous avez, M. le maire, déjà exposé dans votre discours initial ce qu’était l’approche de Jaurès et, disons les choses, le fond de son enseignement.
Qu’est-ce que j’ajouterai ? Vous êtes là, venus passer un peu de cette soirée ensemble et avec moi, venu de la capitale plus lointaine et ravi de retrouver sur place des Françaises et des Français attachés passionnément à leur terre, aimant leur ville et désireux de les servir.
Comme je vous l’ai dit et comme vous le savez, je viens de visiter le nouveau musée Jean-Jaurès. J’étais déjà venu dans le passé et j’ai pu constater le progrès, la nouvelle installation, le nouveau local et le fait que ce musée-là est désormais consacré essentiellement à ce très grand personnage de toute notre histoire qui s’appelle Jean Jaurès et qui naquit à Castres.
On a pu rassembler dans ce local, d’une façon plus large et plus vivante, tout un ensemble de documents qui m’ont beaucoup intéressé sur la vie et les traces de l’action de Jean Jaurès et, au delà de Jean Jaurès, de son époque.
Je crois que je pourrai ainsi, comme d’autres, mieux comprendre comment la République s’est faite et s’est enracinée. Vous parliez d’enracinement à propos des arbres, citant Jean Jaurès, mais c’était bien l’enracinement de la République de France.
Vous avez créé un centre de recherche et de documentation qui offrira, j’en suis sûr, de nouvelles matières pour de nouvelles études et de nouveaux recoupements auxquels procéderont les historiens afin de mieux saisir cette période si complexe qui a conduit notre pays jusqu’à la guerre de 1914 et qui a vu la naissance et l’épanouissement du socialisme en France.
La mémoire de Jean Jaurès, elle vit à Castres, je le vois bien et vous avez raison. Et j’aime en vous cette fidélité au plus grand de vos anciens mais, vous le savez aussi, Jean Jaurès, c’est la France, et au delà de la France c’est l’un des points les plus lumineux du socialisme international, l’une des grandes histoires de la pensée et de l’action qui ont occupé les temps modernes.
C’est vrai que Castres n’aurait pas pu venir à bout à elle seule de ce projet. J’ai pu voir que les collectivités locales et régionales, que les ministères de la Culture et de l’Intérieur avaient pris leur part à l’effort commun. Mais enfin la conduite des travaux et l’heureux aboutissement qui dote Castres d’une richesse complémentaire, tout cela doit être restitué à l’initiative des administrateurs municipaux qui l’ont voulu.

Bien entendu, je ne brosserai pas en ce moment le tableau complet d’une vie telle que celle de Jaurès. Je veux dire simplement quelques mots du parcours d’un homme pour qui la République se devait précisément d’être fidèle à sa devise.
Cela fait déjà combien d’années ? C’était le 3 septembre 1859 que Jaurès vit le jour à Castres. Cela pourrait n’être qu’une anecdote : né à Castres puis on monte à Paris et puis la vie se fait. Non, les choses ne se sont pas faites comme cela pour Jaurès. Bien des jeunes provinciaux n’ont emporté de leur lieu de naissance que quelques souvenirs et à leurs semelles une poussière vite dissipée de leur sol d’origine. Mais cette région où Jaurès est né, où il a grandi, elle est restée la sienne, adulte, responsable, élu du peuple, au point qu’aujourd’hui à Castres, à Albi, à Carmaux, etc. on ne peut exactement démêler l’histoire de l’homme et celle de la terre qui l’a porté.
Bref, de sa prime jeunesse aux combats de sa maturité il est resté l’enfant du Tarn, de ce Tarn que l’on dit indocile, parfois un peu farouche, doué d’une forte personnalité originale, le Tarn où survit le souvenir de nombreuses révoltes quand ce ne serait que la révolte spirituelle de l’époque cathare. Oui, mais c’est avec des femmes et des hommes de cette trempe que l’on bâtit un pays solide et j’entends bien le bâtir avec vous ce pays, notre pays, la France.
On peut dire de Jaurès que, bien que né dans cette province, il restait une sorte de campagnard. Non pas simplement parce que ses parents se sont installés à Fédial-Haute, dans la ferme que son père avait fait construire mais parce que c’était son goût, parce qu’il a voulu y revenir, parce qu’il avait de nombreux rameaux familiaux dans ce département. Il était sensible, on le retrouve à travers ses écrits, au parfum des blés, au charme des rives de l’Agout, aux horizons bornés seulement par la Montagne noire, par les Monts du Sidobre, ou de Lacaune, à ce ciel immense au dessus des collines qui éveille le sentiment de l’infini, de la communication avec l’espace à peine pénétré aujourd’hui. Telle est la nature du contact de laquelle s’est formée la sensibilité de Jean Jaurès et c’est là qu’il est venu toute sa vie reprendre forces.
Dans votre terre, mesdames et messieurs, je pourrais dire parmi vous, parmi vos pères. C’était déjà le même pays et c’étaient les mêmes hommes si ce n’était pas la même époque.
Or la terre dans le Midi languedocien n’est pas hostile, mais ce qu’elle produit est le résultat d’un travail obstiné. Elle n’est pas complaisante, la terre ici. À l’image du labour, patiemment recommencé, ou du travail d’entretien de la vigne. Bref, rien n’est jamais acquis.
Rien n’est jamais acquis pour un paysan quand l’orage peut saccager en quelques instants la récolte, quand la grêle vient cisailler la vigne. Et la seule garantie, où est-elle sinon dans l’effort des hommes, dans l’entêtement souvent solitaire du paysan mais aussi dans le travail partagé des moissons, des vendanges auquel Jaurès a participé, parlant avec tous la langue occitane. On retrouve les mêmes vertus dans la mine, ici, à l’usine là, dans tous les domaines où s’exerce l’activité humaine. Voilà bien des vertus permanentes dont Jaurès continue d’incarner le symbole.
Jaurès avait une grande force poétique ; pour lui, la nature était un bonheur de l’esprit et un bonheur du corps. Les infinies possibilités humaines, il y croyait. C’était un homme d’espérance et d’optimisme et il s’émouvait à regarder autour de lui les choses vivre. Voilà comment s’est créée cette alliance entre les choses si belles mais si rudes et l’homme qui, lui, doit s’inventer, travailler, façonner, transformer et produire. C’est la geste racontée du travail des hommes sur la terre et qui se trouve à l’origine d’une explication de la société qui a inspiré plus tard Jaurès, lorsque, non seulement il adhéra au socialisme, mais lorsqu’il en représenta la figure de proue. Mais je retiens ces mots que l’on peut retrouver dans l’œuvre de Jaurès : « Je suis », disait-il, grâce à ma chance et à mes parents, « un paysan cultivé ».
Il a beaucoup insisté, Jean Jaurès, sur les valeurs de l’enseignement, ayant très tôt exprimé sa foi dans l’homme, sa foi dans l’esprit de l’homme, dans sa capacité à conquérir tous les secrets de la matière. Tout commence là, par l’appréhension du savoir. Jean Jaurès a donc accordé la priorité à l’éducation, comme d’autres le font aujourd’hui, comme nous le faisons instinctivement et parce qu’il a été formé, et loin dans sa jeunesse, aux plus grandes écoles de l’esprit que nous connaissions dans notre pays.
Il était boursier. Et il s’est passionné pour tout ce que l’on apprend. C’était un élève brillant, il a laissé le souvenir d’un des plus brillants qu’on ait connus dans les établissements scolaires de ce département. Il a, combien de fois, raconté que son horizon s’était élargi à l’école. Il a décrit les années studieuses vécues à l’École Normale Supérieure. C’était, pour lui, comme une confrontation permanente et joyeuse, sans vainqueur ni vaincu, où chaque intelligence grandit au contact des autres. Alors parce qu’il savait ce qu’apporte l’école, il n’a pas cessé de se battre pour que cette chance soit accessible à tous. C’est à l’école que, tout jeune élu, il consacra sa première intervention à la Chambre des députés. C’est de l’instruction et de la culture que, conseiller municipal de Toulouse, il se chargea tout aussitôt, concevant le projet d’un musée ouvert aux travailleurs. Et dans ce long combat pour que la République se dote d’un enseignement laïque à sa mesure, sans sectarisme mais avec clarté d’esprit et fermeté de conviction, il s’est placé tout aussitôt du côté de Jules Ferry.
Bref, le savoir était pour lui, comme il l’est pour nous, le premier droit, la première liberté, la première dignité. C’est pourquoi il a dénoncé le fossé scandaleux entre l’école des riches de son époque et l’école des pauvres. C’était un gâchis, gâchis de l’intelligence, gâchis des chances humaines. L’enseignement, la formation sous toutes ses formes, sont pour tout républicain la condition majeure de la démocratie vécue, dans la cité, comme à l’atelier. Il s’agit d’acquérir l’intelligence de ses actes et de l’œuvre d’ensemble à laquelle nous tous nous concourons là où nous vivons et là où nous travaillons.
Jaurès portait aux conditions de l’enseignement comme à la responsabilité des maîtres un intérêt particulier. Il ne s’agit pas, disait-il, de former des « machines à épeler » mais des hommes et des femmes qui devront – c’est encore lui qui parle – être conscients de leurs droits, de leurs devoirs et désireux d’apprendre encore. Alors pour cela, il faut des maîtres, des instituteurs qui disposent eux-mêmes de leurs droits et parmi ces droits, surtout à l’époque, il y avait celui de se syndiquer, c’est-à-dire de s’associer. Jean Jaurès fut l’un des premiers à lutter pour que les enseignants puissent se syndiquer. Il a parlé, encore l’un des premiers, « du droit des enfants », et d’un droit des enfants distinct du droit de l’État, bien entendu, mais aussi du droit des parents.
Le droit des jeunes, comme des moins jeunes, à l’éducation ou à la formation, nous en avons fait, nous aussi, – à la suite de cet héritage intellectuel qu’il nous a légué – une priorité.
Quand j’était tout à l’heure au collège de Réalmont – je vous en ai parlé – j’ai su que l’on y accueillait de nombreux boursiers. On y a fait un bel effort de modernisation ; on est au dernier cri de la connaissance technique. Je songeais qu’on a, depuis Jaurès, certes parcouru du chemin. Mais il faut avancer encore et encore et c’est après tout la même recherche, la même passion qui doit nous habiter. Si les techniques ont changé, si le niveau moyen d’instruction a progressé, si le monde bouge, si l’économie évolue, s’il faut sans cesse s’adapter, ajuster les moyens aux dispositions du moment, il n’empêche que c’est exactement la même démarche depuis le premier jour. C’est une suite sans interruption. Nous nous plaçons dans la ligne de Jean Jaurès.
Et lorsque je me suis rendu au Panthéon, le 21 mai 1981, en m’inclinant devant la tombe de Jean Jaurès, c’était bien ce que j’avais dans l’esprit, afin de communiquer aux Français la valeur symbolique que je ressentais si fort au-dedans de moi-même au moment où j’accédais à la première responsabilité du pays.
Pour Jaurès, vous le savez bien, comme pour nous, la question scolaire rejoignait la question sociale. Il s’est très vite identifié au combat par lequel les travailleurs affirment leurs droits dans un système qui semble n’avoir pour objectif ou pour règle que l’essor inhumain des forces productives. Songez à ce que cela pouvait signifier à la fin du dernier siècle ou au début de celui-ci. Hommes, femmes, enfants, arrachés à la terre – notre société était une société rurale, pastorale –, ont soudain peuplé le carreau des mines, les cours des usines. Ils se trouvaient sans aucune protection, sans droits reconnus, sans moyens collectifs de défense, sans autre horizon que l’interminable journée de travail, l’interminable semaine, d’interminables années ainsi jusqu’à la mort. Et tout cela pour un salaire souvent dérisoire, et à la merci d’un rapport de forces qui jouait toujours contre le travailleur.
D’un côté tous les droits, de l’autre rien. Comment voulez-vous empêcher la montée des colères ? Alors, révoltes et répressions souvent sanglantes. La grève, mais considérée comme impossible et interdite. Des militants pourchassés, emprisonnés. Les organisations, interdites.
Imaginons un instant Jean Jaurès, jeune républicain, convaincu que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; cela avait été dit et proclamé avant lui, nous allons en célébrer le bicentenaire bientôt. Imaginons-le : il a vingt-cinq ans lorsque enfin les syndicats professionnels sont autorisés. À peine plus de trente ans lorsqu’à Fourmies, petite ville de filatures au nord du pays, la troupe ouvre le feu sur la manifestation du 1er mai, faisant neuf morts dont un enfant ; les images sont dans notre mémoire collective. Il n’est pas alors socialiste, Jean Jaurès. C’est l’expérience et la vue du monde qui l’ont porté à définir ses positions, à s’ancrer dans le service d’une grande idée, d’une grande cause. Et il a choisi ce camp car cela ne pouvait être que celui de la justice. Il ne le quittera plus. Songez que l’année suivante cela a été la longue grève des mineurs de Carmaux, dans le Tarn, contre le propriétaire de la mine qui refusait d’admettre l’élection d’un républicain, d’un travailleur à la mairie.
Il faudra dix mois de lutte pour que ce droit élémentaire – élire le candidat de son choix, sans que celui-ci soit frappé d’un licenciement, c’est-à-dire d’une sanction immédiate – soit reconnu aux mineurs. Jaurès a découvert, au contact de la dure condition ouvrière, tout ce qui restait à faire pour que s’accomplît l’idéal républicain ; en un mot : élargir la démocratie politique aux dimensions économiques et sociales. On ajouterait aujourd’hui culturelles.
Voilà ce qu’est le socialisme de Jaurès. Il le disait à l’Assemblée, à la Chambre des députés en 1893, je le cite : « Nous apportons des projets de réformes que vous n’avez pas apportés » – il s’adressait à l’époque à la majorité hostile à tout progrès – « et puisque vous désertez la politique républicaine, c’est nous qui la ferons ici ». La suite on la connaît : Jaurès, député de Carmaux, est de tous les combats pour la justice sociale. Aux côtés des verriers, qui à leur tour affrontent le marquis de Solages. Pour la journée de huit heures. Pour le renforcement du droit syndical. Pour les assurances contre le chômage, la maladie, l’accident, sorte de sécurité sociale naissante. Pour la retraite, à 65 ans à l’époque. Contre les égarements xénophobes, contre les exclusions qui frappaient déjà la main-d’œuvre étrangère. Et pour agir collectivement, pour appuyer les lois qui consacraient des droits nouveaux, il a voulu l’union des socialistes, comme il disait lui-même, dans un « grand parti d’intérêt général ».
En même temps, il organisait un débat permanent, un débat inlassable, contre ceux de ses propres camarades qui boudaient les réformes, qui, parce qu’ils préféraient un objectif lointain, indéfini, grandiose, plus proche de l’idéal, refusaient de mettre la main à la pâte à l’instant et d’accepter les réformes qui signifiaient quelques pas en avant. À quoi sert, leur disait-il, de rallier des millions d’hommes si l’abîme entre aujourd’hui et demain demeure infranchissable ? Mieux vaut essayer de diminuer la largeur du gouffre. Car pour Jaurès – c’est encore lui qui le disait – « la cité future se bâtit à chaque instant, pierre par pierre », en recherchant, comme à toute époque, l’union la plus large contre les abus et contre les privilèges. Est-ce que vous ne croyez pas que cette leçon ne continue pas d’être actuelle ? Il en est ainsi de toute société. Je le répète, rien n’est jamais acquis, tout exige une grande vigilance, la force d’un combat et la grandeur d’un idéal.
Il raillait ceux qui, prétendant que les socialistes de l’époque voulaient supprimer la libre initiative – je ne sais pas pourquoi j’ai dit « de l’époque », on a toujours dit ça –, étaient en fait les premiers à entraver la concurrence. Dans un article intitulé « Les misères du patronat », il décrivait avec compassion la ruine qui menaçait les industriels honnêtes lorsque triomphent l’entente et la spéculation. Il avait raison. Qui est victime du privilège et de la domination du plus fort ? Tous ceux qui sont un peu moins forts. Pas simplement le travailleur, l’ouvrier et l’employé, le cadre mais aussi l’entrepreneur libre qui se trouve à son tour dévoré et détruit, par des forces économiques concentrées jusqu’au monopole et à la toute-puissance.
À l’époque, la classe ouvrière subissait une autorité sans limite. Et cela signifiait une atteinte à la dignité aussi douloureuse que le refus du bien-être matériel. Tout ce qui a été accompli depuis cette époque, grâce aux efforts et aux luttes de millions de femmes et d’hommes, vous le savez.

Bref, il ne faut jamais se dérober. Il ne faut jamais croire que ce type de lutte est rejeté dans le passé. Il faut simplement savoir que l’ensemble des forces sociales et économiques ont un point de rencontre, et c’est très important. C’est le service commun de la patrie et à partir de là chacun devrait avoir le sentiment de diriger son effort vers l’histoire à construire de la collectivité nationale, celle qui vit sur un sol que l’on appelle la patrie. Mais à l’intérieur de cette collectivité, à l’intérieur de la nation, la lutte pour le progrès, la dignité, le plus vaste espace de liberté ne cessera jamais d’être un combat moderne.
Jaurès est celui qui prit le plus fermement parti, sans jamais renoncer à se faire comprendre des autres. En tout cas d’abord de tous ceux qui avaient compris comme lui « que depuis 1789, bien d’autres questions se sont posées qu’il faut chercher à résoudre par la solidarité ». Il ne faut pas s’intéresser seulement, même si le combat s’inscrit dans ce cadre, à la classe ou au groupe socioprofessionnel auquel on appartient. Il faut être capable de comprendre l’intérêt de la nation tout entière. Et ayant tenté de retenir cette leçon, je tiens aussi ce langage, parce que c’est en même temps ma conviction.
Jaurès sait que l’histoire, bien qu’elle connaisse de brusques accélérations de temps à autre, enseigne surtout « la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements ». C’était l’essentiel de son propos devant les lycéens d’Albi que vous avez cité il y a un moment, que l’on connaît j’espère par cœur par ici, que l’on devrait connaître dans toutes les écoles de France. Je suis sûr que monsieur le ministre de l’Éducation nationale qui m’écoute veillera à ce que dans l’éducation civique comme dans l’éducation tout simplement littéraire et historique, on apprenne le grand rôle et l’enseignement déterminant de Jaurès dans notre histoire nationale. Alors voilà, je voudrais saluer devant vous, mesdames et messieurs, la construction à laquelle nous sommes attachés, et que d’autres continueront après nous, dans l’ordre de pensée et d’action de Jaurès. Nous nous efforçons de tenir bon, dans la même ligne, de préserver le cap que le noble et le grand enfant de Castres a enseigné partout dans le monde. C’est l’explication la plus simple de ce qui est tenté aujourd’hui en tenant compte bien entendu de la réalité moderne et des conditions de ce juste combat.
Dernière observation : Jaurès avait déjà compris que la dimension de l’Europe devenait nécessaire. Vous vous souvenez de ces campagnes de calomnies qui l’ont abattu. Jean Jaurès assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale, cela comporte une signification profonde, c’était l’homme de la paix, l’homme du dialogue. Il y croyait, il le voulait. Comme sa voix nous a manqué !
En 1910, à Francfort, en Allemagne, devant quelque 25 000 personnes, voici ce qu’il déclarait : « Ce serait la plus grande joie de ma vie que de vivre le jour où l’Allemagne démocratique, l’Angleterre démocratique et la France démocratique se tendront les mains pour la réconciliation éternelle et la paix dans le monde ».
Pour ceux d’entre nous, et j’en suis, qui ont fait le choix de l’Europe, tout est dit. Les douze pays de la communauté démocratique, l’Europe, et au delà, le mouvement irrésistible qui rapprochera – toutes frontières idéologiques ayant été abattues dans le sens de la démocratie – l’est et l’ouest de l’Europe dans la même construction historique.
De Jaurès, Jules Renard, le Nivernais, disait à la même époque : « il avait les poings pleins d’idées ». Et j’imagine tous ceux qui ont choisi cet emblème d’un poing qui va s’ouvrir pour former le signe de la main tendue, porteur de la fleur qui elle-même représente le symbole de la beauté et de l’amour. « Il avait les poings pleins d’idées » : si le poing s’ouvre, les idées partent un peu partout. Le monde les recueillera, j’en suis sûr.
Jaurès assassiné, ce fut le premier deuil, une immense douleur. Jaurès toujours vivant dans nos mémoires, c’est aussi le premier espoir, une immense espérance. Merci.
Vive Castres !
Vive le Tarn !
Vive la République !
Vive la France !