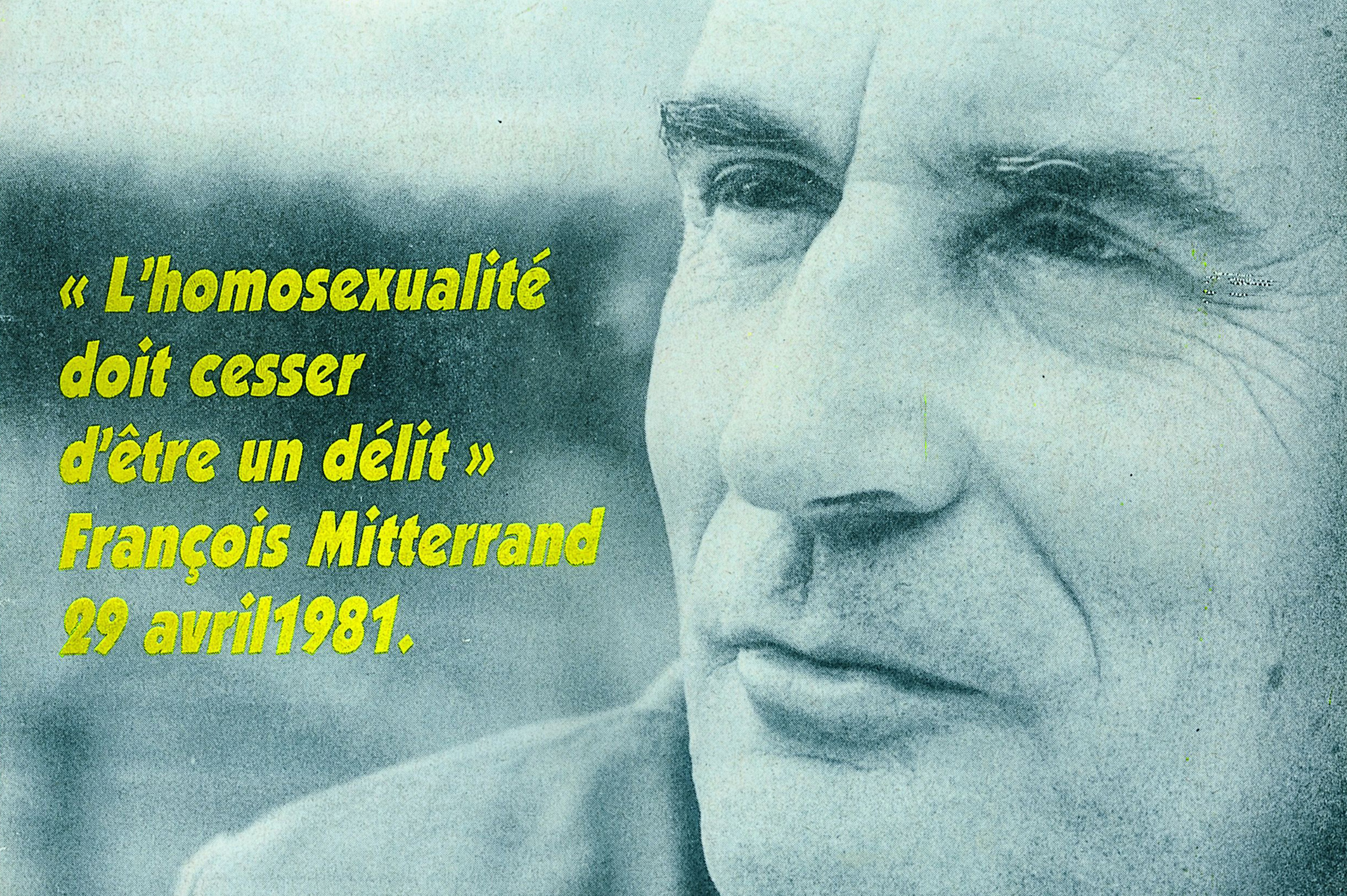Vingt ans après sa ratification par le peuple français, le 20 septembre 1992, le traité de Maastricht continue d’être au cœur du débat politique. Comment pourrait-il en être autrement au moment où la crise économique secoue les institutions de l’Union européenne ? Encore convient-il de resituer ce traité et sa négociation dans leur contexte. C’est ce que nous ferons en étudiant notamment les attentes de la diplomatie française à l’occasion du Conseil européen de Maastricht, ceci en nous appuyant sur les archives de la Présidence de la République.
“Après-Yalta” et approfondissement européen
La désintégration du bloc soviétique est certainement l’élément majeur pour comprendre cette époque. À la fin des années quatre-vingt, les principaux leaders européens cherchent en effet les voies d’un nouvel équilibre du continent. Pour les responsables français, et en premier lieu pour François Mitterrand, plusieurs questions se posent. Comment assurer la sécurité future du continent – et donc celle de la France ? Que faire de l’OTAN ? Quelles relations établir avec les pays anciennement communistes ? Enfin, et peut-être même surtout, quel partenariat construire avec l’Allemagne réunifiée ? Comment, à l’occasion de la disparition des blocs, obtenir des autorités allemandes les décisions nécessaires à l’établissement de liens durables entre les deux rives du Rhin – par exemple l’instauration d’une monnaie unique ?
À ces questions, la diplomatie française répond : « Europe. » C’est en renforçant les différentes institutions européennes que François Mitterrand compte contrôler le passage du monde de Yalta – pour reprendre son expression – à celui du xxie siècle. Cette politique prendra plusieurs formes : Charte de la CSCE, la proposition d’une confédération européenne et surtout l’approfondissement de l’intégration européenne entre les douze États membres de la Communauté européenne. C’est cette dernière volonté qui deviendra le Traité de Maastricht. Pour Paris, cet approfondissement comportait deux axes prioritaires : la création d’une Union économique et monétaire (UEM) ; la mise en œuvre d’une Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Ce contexte de fin de guerre froide n’explique cependant pas à lui seul la genèse du traité de Maastricht. L’idée de créer une monnaie unique ou de mettre en œuvre une diplomatie commune étaient des idées anciennes qui avaient connu un début de réalisation dans les années soixante-dix. Mais il s’agissait avec Maastricht de franchir une étape supplémentaire. En effet, dans les années quatre-vingt, la Communauté européenne avait étendu son pouvoir, tant géographiquement (élargissement à l’Espagne et au Portugal) que politiquement (nouvelles compétences de Bruxelles). Ce développement, et en particulier la perspective de l’achèvement du marché unique à l’horizon de 1993, rendait nécessaire la rédaction d’un nouveau traité qui viendrait à la fois modifier et compléter le fonctionnement communautaire.
1990-1991 : la négociation
L’idée d’un nouveau traité européen s’est nouée progressivement. Au printemps 1990, parallèlement à la gestion de l’unification allemande, l’Élysée et la Chancellerie s’accordent pour qu’intervienne une nouvelle étape de la construction européenne. En avril, la première des lettres conjointes Mitterrand-Kohl concrétise cette ambition. L’ouverture, au mois de décembre suivant, des deux conférences intergouvernementales – la première sur l’UEM, la seconde sur l’Union politique – marque le coup d’envoi des négociations. Elles s’étalent tout au long de l’année 1991, avec une accélération aux mois d’octobre et novembre, le Conseil européen de Maastricht devant parvenir à un accord final, les 9-10 décembre.
Contrairement au début du premier septennat, les sommets européens n’ont alors plus de secret pour François Mitterrand ni pour ses ministres – en particulier Roland Dumas et Pierre Bérégovoy. Ils sont secondés par un groupe de conseillers et de hauts-fonctionnaires maîtrisant les rouages communautaires, en contact permanent avec leurs homologues notamment allemands.
Bien que les sondages d’opinion publique enregistrent en 1990-1992 une baisse notable et que des voix s’élèvent désormais pour la critiquer – à l’extrême-gauche et à l’extrême-droite –, la priorité européenne de François Mitterrand continue d’être soutenue. C’était d’ailleurs l’un des thèmes majeurs de sa campagne de 1988.
Le Conseil européen de Maastricht
Priorités françaises
Rétrospectivement, l’UEM apparaît comme le projet phare de cette négociation. Il s’agissait assurément d’une priorité pour François Mitterrand, procédant plus d’une vision politique qu’économique. Avec l’Euro, l’Allemagne – l’Allemagne réunifiée – sera irréversiblement liée à l’Europe, et donc à la France. Les concessions françaises dans ce dossier – en particulier l’indépendance de la Banque centrale européenne – s’expliquent par ce choix politique. Par ailleurs, ce projet devait permettre de ne plus subir l’hégémonie du deutschemark et l’unilatéralisme monétaire américain. Quant aux entreprises européennes, elles bénéficieraient des avantages d’une monnaie unique à l’intérieur du grand marché.
Autre dossier important, celui de la PESC. Dans cette affaire, les négociateurs français, en accord avec les Allemands, poursuivaient deux objectifs : d’une part, faire inscrire dans le texte du traité d’Union européenne la possibilité d’une future défense européenne ; d’autre part, simplifier – et donc renforcer – l’adoption de positions et d’actions diplomatiques entre les Douze.
Enfin, la négociation de Maastricht devait déboucher sur une nouvelle architecture institutionnelle de l’Europe, mieux à même de faire face aux développements des politiques communautaires. L’idée du gouvernement français était de faire naître une Union à la fois démocratique et efficace – donc dotée de réelles prérogatives – sans pour autant décomposer les États qui la constituaient. François Mitterrand, par exemple, n’hésitait pas à employer le terme « fédéral », mais à ses yeux, ce fédéralisme prendrait des voies nouvelles et préserverait les « intérêts », « tempéraments », « caractères », « coutumes », « lois » des États membres. Ceux-ci ne devaient en aucun cas « se fondre dans la grisaille. » D’où l’insistance des négociateurs français, lors de la négociation, pour que la future Union européenne soit coiffée par le Conseil européen, seul organe réellement légitime puisque réunissant les plus hautes autorités souveraines des États membres. D’où l’appui au principe de subsidiarité – c’est-à-dire la clarification des compétences entre États et Europe –, de même qu’au projet de Congrès européen – réunion des parlements nationaux et européen.
En plus de ces trois dossiers, les autorités françaises s’étaient fixées trois autres objectifs :
– sur le social. Il fallait que le terme figure expressément dans le traité et permette de nouveaux progrès dans ce domaine ;
– l’industrie. La future Union devait pouvoir agir de façon volontariste dans ce domaine ;
– la culture. Les États membres devaient pouvoir prendre des initiatives dans ce domaine.
À ces dossiers, il fallait ajouter certaines demandes d’autres États membres – allemand et espagnol en particulier – que la délégation française avait décidé de soutenir, tant par intérêt que par nécessité du compromis : la mise en place de fonds de cohésion, l’émergence d’une citoyenneté européenne, etc.
Un front uni à Onze
Telles étaient les ambitions françaises lorsque les travaux du Conseil s’ouvrirent à Maastricht, le lundi 9 décembre dans la matinée, dans la salle de conférence du Conseil provincial. Toutefois, en dépit de préparatifs minutieux et d’ultimes tractations, l’incertitude demeurait quant au résultat final de cette rencontre. Un projet de traité, préparé par la présidence néerlandaise, était sur la table et convenait à la France. Mais plusieurs pays s’y opposaient. Le Chancelier Kohl le jugeait soit trop timide soit trop ambitieux sur certains points. Felipe Gonzalez considérait que les transferts financiers en faveur des régions pauvres de l’Europe y étaient insuffisants. Surtout, la Grande Bretagne s’opposait à tout ! UEM, PESC, social, citoyenneté, option fédérale : John Major – pourtant considéré comme plus “europhile” que sa prédécesseur – refusait son accord. Ces désaccords expliquent la durée des discussions : ce n’est que dans la nuit du 10 au 11, vers une heure du matin, que l’accord final fut annoncé.
La tactique française fut la suivante : devant l’opposition de la Grande Bretagne, constituer un front à Onze décidé à conclure pour la forcer à accepter un nouveau traité, sans pour autant l’obliger à rompre la négociation. Ce stratagème porta ses fruits mais explique aussi les concessions que la France du concéder.
Ce ne fut pas le cas, cependant, sur l’UEM. Dès l’ouverture des travaux, François Mitterrand proposa que le traité fixe une date butoir (janvier 1999) à partir de laquelle, quoi qu’il arrive, la monnaie unique verrait le jour. Il s’agissait d’un impératif. En effet, encore à la veille du sommet, le projet de traité restait imprécis sur les modalités de passage à la monnaie unique. En faisant inscrire une date dans le traité, le Président français rendait la marche vers l’Euro « irréversible. » Le principal objectif était atteint même si, pour y parvenir, il avait fallu accepter un statut dérogatoire pour la Grande Bretagne.
Objectif atteint, pour l’essentiel, à l’égard de la PESC. Certes, le texte restait en deçà des ambitions françaises et allemandes, mais la possibilité d’une défense européenne figurait bien dans le texte. De même, certaines modalités d’exécutions se décideraient à la majorité.
Enfin, la structure du traité, avec le Conseil européen à son sommet, fut confirmée, comme le souhaitait Paris.
Sur le social, où l’opposition était très forte, l’accord final se fit sur un texte minimal, assez éloigné de ce que souhaitait Paris. Il fallut en particulier se résoudre à un accord à Onze, sans la Grande Bretagne. Or, par ce biais, Londres continuerait de faire pression sur le coût du travail, ce qui risquait d’empêcher tout progrès dans ce domaine. Néanmoins, la Charte sociale figurait désormais au traité, ainsi qu’un certain nombre de politiques, ce qui représentait une avancée. En réalité, l’échec français le plus flagrant concernait l’industrie où Paris était totalement isolé et où l’unanimité resterait requise. Pratiquement, cela donnait un droit de veto à chaque pays et condamnait de fait l’Union à l’immobilisme dans ce domaine.
* * *
« En avril 1990, le Chancelier Kohl et moi même, avions proposé à nos partenaires de constituer une union politique. Aujourd’hui, nous avons à Douze, décidé de lui donner vie. »
C’est par ces mots que François Mitterrand commente, le 11 décembre 1991, à 2h du matin, le résultat des longues discussions de Maastricht.
Sur la plupart des dossiers, et en premier lieu sur l’UEM, la délégation française avait atteint ses objectifs. Certes, des concessions avaient été faites. L’Europe à la française restait à construire, comme le confirma François Mitterrand lui-même : Maastricht devrait être complété. Toutefois, dans le contexte de l’après-guerre froide, ces concessions semblaient minimes par rapport à l’objectif politique que représentait l’Union européenne. En devenant réalité, elle matérialisait une solidarité de fait entre les États européens – et d’abord entre la France et l’Allemagne. Une solidarité qui empêcherait, lors des crises à venir, les funestes divisions de l’Europe.