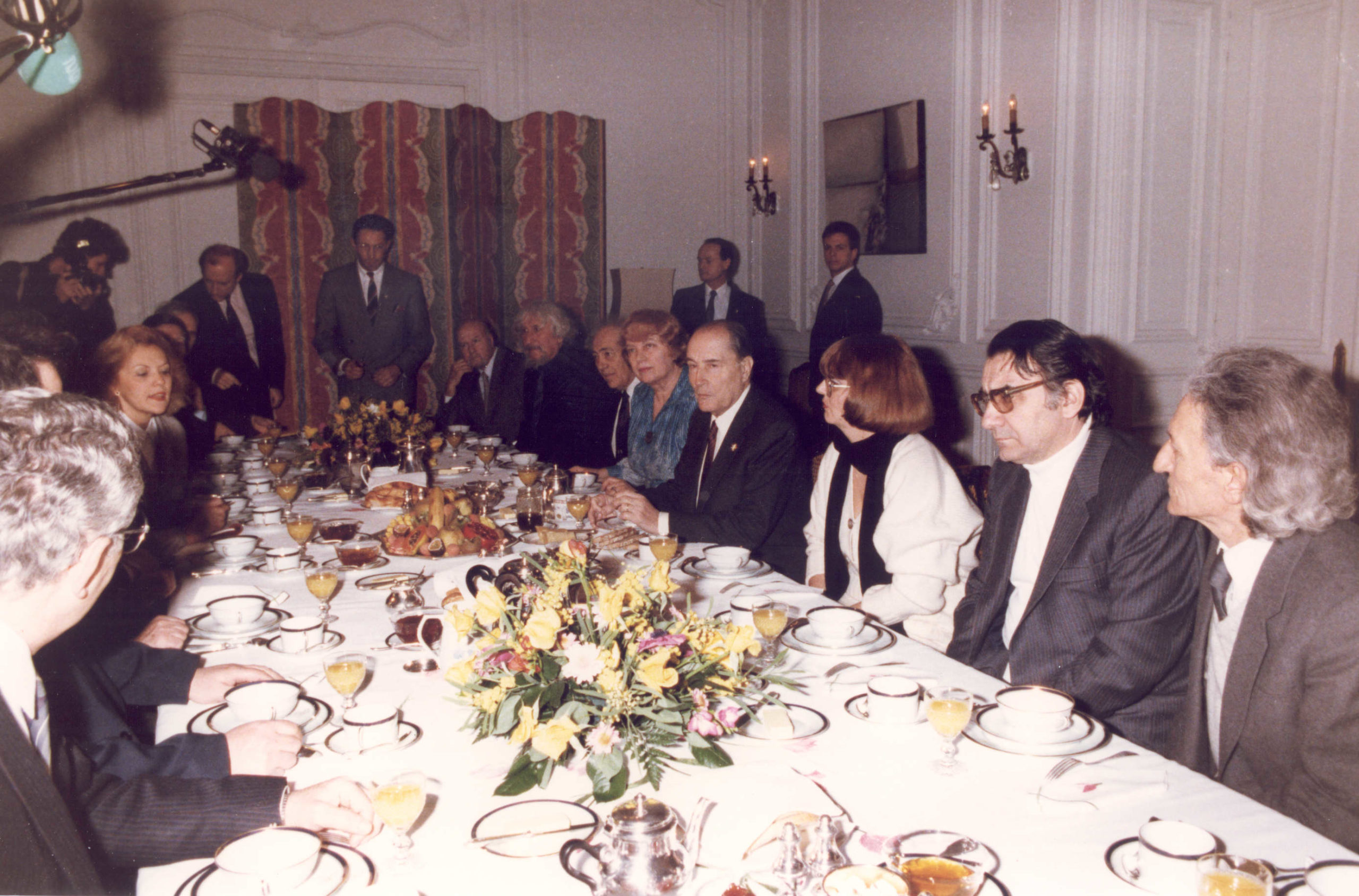Intervention de Michel Charasse lors du colloque « Le Président de la Ve République et les libertés » organisé par l’Institut Maurice Hauriou (Université Toulouse 1) et le Centre Maurice Hauriou (Université Paris V) les 23 et 24 février 2015 à Paris.

Toute sa vie, François Mitterrand a été un homme de liberté et d’abord de la liberté individuelle. Il n’était pas très « libertés collectives », puisqu’il a constamment préservé son indépendance d’esprit à l’égard de la pensée unique, de la bien-pensance, de la presse, des puissances financières et sociales etc…et sa liberté d’agir, tout au long de sa présidence, y compris en politique extérieure où il a défendu bec et ongle l’indépendance et l’autonomie de la France.
Toujours il a veillé à garder la main quoi qu’il arrive. Il l’a manifesté dès la guerre en tentant de s’évader par trois fois, comme on le sait, dont une qui fut la bonne. Il est entré dans la Résistance, sans pour autant accepter que son mouvement de prisonniers évadés ne se range sous la bannière du Général De Gaulle. D’où un certain nombre de difficultés à l’époque dont les ouvrages les plus savants retracent les étapes. Il a résumé cet état d’esprit dans ses Mémoires interrompus, écrites à la veille de sa mort :
« Je ne me sentais pas né pour vivre citoyen d’un peuple humilié (…). Je ressentais également l’occupation de mon pays comme un viol. »2
D’où son premier geste en prenant ses fonctions le 21 mai 1981, lorsqu’avant de s’installer dans son bureau, il est allé saluer au Panthéon la mémoire et la sépulture de Victor Schœlcher, combattant contre l’esclavage, de Jean Jaurès pour son combat socialiste et pour la République, et de Jean Moulin en hommage à son combat et à son sacrifice pour la liberté.
D’où son impatience à mettre en œuvre son engagement politique pour les libertés dès les premières semaines de sa présidence : abolition de la peine de mort bien sûr, suppression des juridictions d’exception (Cour de sûreté de l’Etat, etc…), abrogation des lois sécuritaires les plus contestables et contestées, comme la loi « sécurité et libertés », plus connue sous le nom de « loi Peyrefitte », décentralisation et libertés des collectivités locales… D’où ses interventions systématiques en s’appuyant le plus souvent sur la Constitution, sur la prééminence du chef de l’État, et notamment sur l’article 5, et sur ses engagements de campagne en matière de libertés (je pense aussi aux lois Auroux et la refonte complète du code du travail), en ayant à l’esprit, à l’occasion de ses interventions dans le débat public et en Conseil des ministres (je pense à la controverse entre Gaston Defferre, Ministre de l’intérieur, et Robert Badinter, Garde des Sceaux sur les contrôles d’identité et à l’opposition classique en la matière entre la place Beauvau et la place Vendôme), en gardant à l’esprit, comme il l’avait écrit bien avant 1981 dans son livre Politique 1, que les textes ne régissent pas tout, « je crois en l’usage qui fait loi ». C’est-à-dire, ce qu’il invoquait souvent, la « tradition républicaine ». Au fond pour lui, la République c’est tout le contraire de la monarchie de l’Ancien Régime, ne parlons même pas de la Restauration, de la Monarchie de juillet et des Empires, notamment dans le domaine de la liberté qui est essentiel pour permettre au peuple souverain d’exprimer le vote sur lequel repose, pour François Mitterrand en tout cas, exclusivement le fonctionnement du régime constitutionnel, le bonheur du pays et l’unité de la nation, unité qui fut d’ailleurs son obsession pendant quatorze ans. Et c’est en raison de cette obsession que se sont produits, en 1984, les évènements sur l’école. Je n’oublierai pas de mentionner son attachement à la liberté de la presse et de la communication, à travers les radios libres, dont il a été le promoteur (il a été poursuivi pénalement avant d’être Président, parce qu’il avait participé au Parti socialiste à une radio libre), et son refus systématique de poursuivre les journaux pour diffamation. Même s’il avait une grande réserve pour les entreprises de presse et les médias des temps modernes qu’il jugeait comme des produits commerciaux ordinaires peu soucieux d’informer et préférant l’émotion qui fait vendre. Plus encore à l’égard beaucoup de journalistes, à partir des années 68/70, qu’il jugeait ignares et incultes, paresseux, à l’exception de quelques très proches et souvent de sa génération, dont il se méfiait beaucoup mais qu’il savait utiliser ici et là pour lancer des faux bruits dont il avait le secret.
Je n’oublierai pas non plus sa méfiance vis-à-vis de la justice, je devrais dire « du corps judiciaire ». Souvenir de la guerre sans doute, mais aussi souvent des procès plaidés pour les pauvres lorsqu’il était jeune avocat. Il citait souvent ce conseil de Saint-Louis à son fils Philippe III le Hardi, en 1270 : « Si un pauvre a querelle avec un riche, soutiens le pauvre contre le riche jusqu’à ce que la vérité soit éclaircie. Après, tu diras le droit. »3
Après ces propos introductifs, je vais prendre successivement les articles de la Constitution pour vous citer quelques points types sur lesquels François Mitterrand est intervenu en matière de libertés.
L’article 4, sur les partis politiques. Il y était très attaché. Il considérait que c’était l’un des fondements des libertés pour l’expression du suffrage. Il était très attaché au suffrage universel. C’est ce qui explique qu’en janvier 1995, lorsqu’il est allé à Strasbourg pour présenter le programme de la présidence française de l’Union Européenne, il a convié tous les parlementaires européens à une réception à la préfecture de Strasbourg, Front National et Le Pen compris. Un certain nombre de ses collaborateurs lui ont dit « même Le Pen ? » et il a répondu : « lui, oui il est élu….pas vous » (…).
L’article 5, concernant la responsabilité du Président de la République.
Il a utilisé cette disposition dans une lettre au Président de l’Assemblé nationale, M. Mermaz, pour lui dire que le Président de la République étant en France pénalement irresponsable, l’Assemblée Nationale ne pouvait pas convoquer le Président Valéry Giscard d’Estaing à une commission d’enquête parlementaire pour parler de l’affaire des « avions renifleurs » survenue sous son septennat4. Cela s’est arrêté immédiatement.
On peut aussi parler de son intervention en matière d’indépendance nationale et d’intégrité du territoire : lorsque nous avons rencontré Khadafi en Grèce pour parler du Tchad5, à un moment, j’ai vu le Président se lever (j’étais loin et n’entendais pas ce qu’il disait, mais je le voyais se lever après une discussion vive) puis se rassoir un moment plus tard. Je lui ai demandé ensuite de quoi il s’agissait et il m’a répondu : « Khadafi m’a dit : « Et si on parlait de l’indépendance de la Corse ? », Je lui ai répondu : « Je ne suis pas venu ici pour parler du démembrement de la France. Par conséquent si vous continuez sur ce ton, je m’en vais » ».
L’article 9 : « le Président de la République préside le Conseil des Ministres ». Le Président Mitterrand a toujours estimé que, celui qui préside le Conseil des ministres avait seul compétence pour arrêter l’ordre du jour. En période de cohabitation en particulier, il a été parfois amené à dire aux Premiers Ministres (Chirac, Balladur), « Je ne veux pas de cette affaire, je ne l’inscris pas au Conseil des ministres ».
Mais c’était relativement rare parce qu’il disait toujours, « Vous voulez tel projet de loi ? » (Il n’empêchait pas le gouvernement d’inscrire les projets de loi). « Après tout, ce sont vos affaires, allez au Parlement !»
En revanche, il empêchait l’inscription des ordonnances : « Vous n’avez qu’à aller demander à votre majorité parlementaire de vous voter les lois dont vous avez besoin ». Et bien entendu, il refusait les quelques nominations pour lesquelles il n’était pas d’accord. Je pense en particulier à la nomination du Directeur Général de la gendarmerie (1993); le candidat ne lui plaisait pas : « Ce n’est pas un homme de liberté, en tout cas je n’en suis pas sûr. Je n’en veux pas ». Après trois mois d’attente, la gendarmerie n’ayant toujours pas de directeur, il a fini par nommer Patrice Maynial, un Président de chambre à la Cour d’appel de Paris, qui lui convenait.
Donc en matière d’inscription à l’ordre du jour du Conseil, il était le patron, et bien sûr quand on lui proposait des textes, autres que les projets de loi qu’il jugeait liberticides, il disait non et ajoutait « faites voter un projet de loi par votre majorité. ». Pour la promulgation de la loi dans les 15 jours, pas de problème évidemment, c’est une obligation ! Cependant, il a demandé par deux fois une seconde délibération mais n’a jamais saisi le Conseil Constitutionnel sur une loi ordinaire, seulement sur des traités (…).
L’article 11, sur le référendum. L’essentiel a porté sur l’affaire de l’école en 1984 mais je n’oublie pas l’Europe, ni la Nouvelle Calédonie. Le président François Mitterrand a toujours considéré qu’il était le seul à pouvoir décider s’il pouvait y avoir un référendum ou pas : « Le seul qui dans tous les cas peut convoquer le référendum, c’est moi ! » C’est l’article 5 !
Dans l’affaire de l’école en 1984, il a été saisi d’une proposition de référendum par le Sénat qui n’a pas été votée par l’Assemblé nationale. Mais il a décidé à ce moment-là de prendre le contrepied, en disant : « Je ne peux pas, aux termes de l’article 11, faire un référendum sur un tel sujet, mais si vous voulez que je le fasse, il faut d’abord modifier la Constitution pour élargir le champ du référendum aux libertés fondamentales». Il a pris le contrepied en déposant un projet de révision constitutionnelle de l’article 11, que l’opposition parlementaire a ridiculement enterré, n’étant pas à ce sujet à une contradiction près.
L’article 13, sur la signature des ordonnances et des décrets. J’ai eu de longues discussions avec lui à propos des ordonnances. Je lui ai dit : « Mais, enfin, je ne comprends pas que vous acceptiez de les inscrire à l’ordre du jour du Conseil et qu’ensuite, quand on vous les propose à la signature, vous les refusiez. » Puisqu’au fond elles étaient inscrites à l’ordre du jour pour être délibérées par le Conseil puis signées par le Président de la République. Or, il ne signait pas. Il me dit : « Je veux laisser le débat aller jusqu’au bout ». Je trouvais que là, il y avait une certaine contradiction. À la fin, il a fini par dire qu’il ne voulait plus inscrire au Conseil des ordonnances sur lesquelles il n’était pas d’accord.
En ce qui concerne les nominations, celles qui arrivent au Conseil des ministres, ce sont celles qu’il a préalablement approuvées. Il n’y a pas eu de nomination, à ma connaissance, en quatorze ans, retoquées en Conseil des ministres. Mais il lui est arrivé d’intervenir pour faire nommer des gens. Je ne parle pas du corps préfectoral ou des ambassadeurs où il avait toujours des candidats. Par exemple, en 1981, il a dit « Je veux rétablir M. Rosenwald dans ses droits. » C’était un magistrat de la Cour des comptes victime, pendant la guerre, des lois juives et qui avait perdu une partie de ses annuités de carrières. Il avait dû prendre sa retraite alors que normalement, si l’on avait compté des annuités normales, il aurait été promu Premier président de la Cour des comptes. On l’a sorti de sa retraite, réinstallé, régularisé la période d’exclusion puis nommé Premier président de la Cour des comptes6. Inutile de vous dire que personne d’autre que lui n’a fait de proposition à ce sujet. C’était une question qui le touchait personnellement car il avait rencontré M. Rosenwald dans la clandestinité pendant la guerre.
Il lui est arrivé aussi de demander en Conseil des ministres la révocation d’un fonctionnaire. Je me souviens un matin, il est arrivé au Conseil des ministres très en colère. En écoutant la radio de bonne heure, il avait entendu que dans le département de la Creuse, des camions de viande anglais avaient été arrêtés nuitamment par une horde de paysans qui les avaient jetés dans le fossé, qui avaient déchargé la viande, qui l’avaient arrosée d’essence et brûlée, etc., sans qu’apparemment le préfet ne s’en émeuve puisqu’il ne l’a appris que vers 7h ou 8h du matin. Et il y avait ce jour-là en Conseil des ministres un mouvement préfectoral. Le Ministre de l’intérieur présente : « Monsieur X (…) préfet du Pas-de-Calais est nommé préfet de Lot-et-Garonne, Monsieur. Y, préfet du Lot-et-Garonne, est nommé préfet de l’Isère, etc. » A la fin de la liste le Président dit : « vous n’oubliez personne ? » Le ministre de l’intérieur dit : « Non Monsieur le Président » le Président réplique : « Mise hors cadre du Préfet de la Creuse. » Et il dit au Ministre de l’intérieur : « Vous n’êtes pas au courant des incidents de cette nuit, M. le ministre de l’Intérieur ? Vous ne tenez pas votre maison. »
L’article 15, Chef des armées. Ça touche aussi aux libertés, parce que ce sont les libertés de la France, c’est l’intégrité du territoire, etc. Il a beaucoup critiqué – toutes les facultés de droit savent ça – le décret de 1964 sur l’engagement de la force nucléaire stratégique et, finalement, il a fini par l’assimiler complètement en disant : « Je suis chef des armées. » Car il ne voyait pas comment on pouvait partager, dans un collégial comité « Théodule », la responsabilité d’engager la force nucléaire. Et c’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, dans tous les débats européens, il a toujours refusé la mutualisation des forces armées. Il disait : « Je ne veux pas donner l’arme atomique française à un comité Théodule européen qui n’appuiera pas sur le bouton, sauf si la majorité de ses membres est menacée. Et si c’est la France qui est menacée et pas la majorité des membres du comité Théodule, on ne s’en servira pas. L’usage de l’arme nucléaire ne peut pas être livré à un Conseil machin ! »
Je vous signale qu’il a toujours été très attentif à maintenir la tradition républicaine sur la levée des punitions dans l’armée pour le 14 juillet, sous réserve de l’appréciation des chefs de corps lorsqu’il y avait des fautes particulièrement graves. Chaque année, on lui soumettait une directive aux armées dans laquelle il était question des punitions. Quelques fois il corrigeait lui-même le texte, avec une très grande précision pour dire : « dans tel cas c’est « oui », dans tel cas c’est « non » ».
Je ne parlerai pas de l’article 16[[Sur les pouvoirs exceptionnels donnés au Président de la République en cas de menaces graves sur la République.
]], puisque, la seule proposition qu’il ait faite l’a été à la suite de la Commission Vedel, à laquelle il a demandé de statuer. La Commission Vedel a donc proposé sa suppression mais le projet de révision constitutionnelle déposé par François Mitterrand peu avant les élections législatives de 1993 n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée. Il reprenait plusieurs propositions de la Commission Vedel, dont la suppression de l’article 16.
La seule chose que je me demande c’est : est-ce qu’il aurait, comme le général De Gaulle dans le cadre de l’article 16, suspendu temporairement l’inamovibilité des magistrats du siège en Algérie ? On ne peut pas faire parler un mort et je n’en sais rien. Mais si l’ordre public avait été conditionné par ça, je pense que, sans me tromper, je peux dire « oui » ; il l’aurait fait. D’ailleurs ça a concerné très peu de magistrats ; ceux d’entre vous qui suivent cela d’un peu près savent que cette mesure a dû concerner trois ou quatre magistrats en poste en Algérie soupçonnés de « fricoter » un peu trop avec l’OAS.
L’article 17 sur le droit de grâce. Le Président a toujours contesté cette méthode, qu’il a trouvée en arrivant à l’Élysée, qu’on appelait la « grâce collective ». Donc, tous les 14 juillet, on lui mettait sous le nez un décret de grâce, qui en réalité était un décret de vidage des prisons. On sortait ainsi 6000 prisonniers comme ça d’un seul coup, en fonction du quantum de la peine, graciés. Il disait toujours : « C’est une déviation du droit de grâce. » Mais, les gardes des sceaux successifs lui expliquaient toujours : « Oui mais, avec les chaleurs d’été qui arrivent, ça va péter dans les prisons. Elles sont surchargées, etc. » Donc, de mauvaise grâce, si on peut dire, il signait. Je dois avouer que je me suis réjoui de la proposition du Président Sarkozy de ramener la grâce à une décision individuelle, ce qui figure dans la révision de 2008.

L’article 29, sur la session extraordinaire. Il y a eu une vraie difficulté avec M. Balladur, qui voulait terminer un processus parlementaire, comme c’est l’habitude en matière de session extraordinaire, et qui avait glissé dans le lot la révision de la loi Falloux. Et là, ça a été « non ». Donc il a refusé de signer le décret inscrivant modification de la loi Falloux à l’ordre du jour.
Sur l’article 34, sur ce qui doit être fixé et déterminé par la loi. Je vous ai parlé tout à l’heure des contrôles d’identité ; on pourrait parler aussi de la loi qu’il a demandée à Michel Rocard sur les écoutes (la première loi sur les écoutes téléphoniques a été préparée par Michel Rocard en 1990), et sur l’affaire de l’école. François Mitterrand était tout à fait laïque, partisan de l’école publique. Mais il considérait que l’école privée avait le droit d’exister, d’autant plus qu’elle avait été confortée par le Conseil constitutionnel dans une décision de 1977 sur la loi Guermeur. Et il disait : « Ce n’est pas la peine d’aller faire de la provocation dans ce domaine » et il ajoutait même pour la loi Savary : « pour se retrouver à la fin Gros-Jean comme devant après un petit clapotis devant le Conseil constitutionnel ». Donc, il disait : « Il faut laisser aux familles la deuxième chance » (elles ont bien le droit, en tous cas pour leurs enfants, de vouloir choisir ce qui leur paraît le meilleur). Au moment de la grande manifestation de Versailles de juin 1984, nous regardions la télévision le dimanche soir, il m’a dit : « Vous voyez Michel, dans tous ceux qui défilent, la moitié ont voté pour moi ». Donc il a tenu bon là-dessus, en veillant à ce qu’on applique sa formule qui était « convaincre sans contraindre ».
L’article 35, sur la déclaration de guerre, n’a plus le même contenu aujourd’hui que celui qu’il avait à l’époque. Il n’empêche que les interventions françaises qui ont été faites découlaient de la Charte de l’ONU ou d’accords de défense bilatéraux, essentiellement avec les pays africains. Il estimait là qu’il n’avait pas à consulter les assemblées. En revanche, pour la guerre du Golfe, qui était une opération dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, il a demandé au Premier ministre, M. Rocard, d’engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale par une déclaration de politique générale, et, devant le Sénat, mais là sans risque – bien entendu – d’être renversé.
Article 36. L’état de siège n’a pas joué. En tout cas, il a demandé l’état d’urgence pour la Nouvelle-Calédonie (1985) en limitant, autant qu’il le pouvait, la portée du texte que souhaitait le Ministre de l’Intérieur.
L’article 50. Il n’a pas eu à régler un problème de chute du gouvernement. Il avait toujours dit : « Si le gouvernement est renversé, ce n’est pas grave : je le remplacerai !».
L’article 52. Le président négocie et ratifie les traités. Il a toujours été très attentif à tout ce qui concernait la négociation des textes concernant l’Europe, l’ONU, l’Afrique ; et il a négocié personnellement un certain nombre de choses. Il a observé d’un œil particulier la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car il n’était pas très favorable à ce texte. Il considérait que c’était l’introduction en France du droit anglo-saxon comme l’interdiction de la fessée aux gamins. Il disait que négociation et signature ne veulent pas dire loi de ratification, que loi de ratification ne veut pas dire ratification. Et il était très vigilant sur les dépôts des réserves8.
Je citerai, en matière de libertés, son discours au Kremlin (21/06/1984), son discours à la Knesset (04/03/1982), son discours au Bundestag (22/01/1983), et son discours à Ouagadougou (17/11/1986), qui est peu connu mais que l’on aurait intérêt à relire puisque nous étions reçus par le Président du Burkina Faso, Thomas Sankara, remplaçant son prédécesseur qu’il avait assassiné. Ce dernier nous a fait une leçon de morale, genre « jeune dirigeant du Tiers monde ». Comme disait François Mitterrand : « la France est une vieille nation démocratique qui n’a pas beaucoup de leçons à recevoir, notamment de quelqu’un qui a fait un coup d’État ». En plus, c’était un mauvais jour puisque qu’on venait d’apprendre, juste avant le banquet à Ouagadougou, l’assassinat de Georges Besse, le patron de Renault. On était en cohabitation. François Mitterrand était très en colère. Par conséquent, Thomas Sankara a fait un discours violent. François Mitterrand lui a répondu en laissant de côté les papiers du Quai d’Orsay, sur la liberté et le reste. En sortant du banquet, c’était absolument glacial. Il m’a dit : « Barricadez-vous dans votre chambre, et faites attention. Préparez vos bagages parce que, demain matin, nous allons être expulsés. » On n’a pas été expulsés du tout. Sankara était très content de nous. Et donc tout ça s’est très bien passé !
Il a saisi le Conseil constitutionnel sur les traités, notamment sur Maastricht. Ce qui l’intéressait beaucoup dans Maastricht, c’était ce que dirait le Conseil constitutionnel sur la question du droit de vote accordé aux Européens qu’il rattachait à sa vieille intention de donner le droit de vote aux immigrés en France. Donc il a veillé en particulier là-dessus de très près.
Pour les nominations au Conseil Constitutionnel je ne dirai rien. Il a quand même nommé comme Président de Conseil constitutionnel, après Roger Frey, Daniel Mayer. Ce qui a été un symbole puisqu’il avait été Président de la Ligue des Droits de l’Homme. Cela voulait bien dire ce que cela voulait dire. De même pour Robert Badinter.
L’article 61, sur la saisine du conseil constitutionnel, Il n’a jamais saisi sur une loi ordinaire. Mais il a fait savoir quelquefois, notamment au Conseil constitutionnel, son opposition à certaines dispositions. J’ai été chargé de transmettre des messages. Lorsqu’on a voté pour la première fois, en 1982, une loi sur la parité aux élections municipales – qui n’était d’ailleurs pas la parité totale, puisque c’était un tiers (ou quelque chose comme ça) –, il considérait que c’était contraire à l’unicité et à l’égalité du peuple français tel qu’il résultait de l’article 2 ou 3 de la Constitution. Et il a fait savoir, de même, au moment où, en 1991, le Conseil des ministres a délibéré et le Parlement adopté une loi parlant du « Peuple corse composante du peuple français ». Il a fait dire de façon assez carrée au Conseil constitutionnel que cela lui paraissait être une atteinte à l’unité nationale. Le Conseil a d’ailleurs partagé cette opinion9. (…)
En ce qui concerne l’article 64, l’indépendance de l’autorité judiciaire : aujourd’hui le Président de la République ne préside plus le Conseil supérieur. A l’époque, il le présidait. Il est intervenu une fois, à ma connaissance, pour en préserver l’indépendance. Fin 1994, dans une affaire délictueuse dans les Hauts-de-Seine, connue sous le nom de Schuller-Maréchal, il a été question de dessaisir le juge d’instruction qui s’appelait M. Halphen. Les conditions de ce dessaisissement par le Garde des Sceaux paraissaient au Président de la République comme étant une démarche politique de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Je vous passe les détails parce que ça a duré toute une journée. Le 23 décembre, il a reçu, à six heures du soir, le Premier Ministre, M. Balladur, et le Garde des Sceaux, M. Méhaignerie. Et, finalement, l’accord n’ayant pas pu se faire, ou n’ayant pas été clair, il a décidé, à huit heures du soir, alors qu’il partait en vacances en Égypte une heure après, d’utiliser la disposition de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature disant que le Conseil supérieur était habilité à faire des enquêtes sur le fonctionnement des cours et tribunaux. Donc il a dit : « je vais saisir le Conseil supérieur ». Et j’ai aussitôt préparé, à huit heures et quart, une lettre pour le Doyen du Conseil supérieur, qui était l’ambassadeur Graf (un ami du Président de la République) lequel venait d’arriver en Autriche pour ses vacances d’hiver. Il venait de poser ses valises et m’a dit au téléphone : « Je n’ouvre pas mes valises, je repars. » Le lendemain matin, veille de Noël, il a convoqué le Conseil supérieur. C’était la première fois. Le Conseil supérieur en a été très fier. Et François Mitterrand se posait la question de savoir si le Conseil n’allait pas rejeter sa demande en disant : « Après tout, je ne suis pas chargé de ça !». Au contraire, il a statué. Et ceci a abouti au dessaisissement partiel du juge Halphen sur deux points et à la confirmation dudit juge sur tout le reste.
Pour les nominations de magistrats, il a toujours veillé aux propositions sur la transparence. Il a toujours suivi, en matière de nominations, les avis du CSM. Et il a procédé pour les procureurs généraux, comme pour les autres fonctionnaires. Chaque fois que cela touchait aux libertés, il faisait très attention. (…)
Sur la Haute Cour, il a plaidé pour sa réforme parce qu’il considérait que son existence était une juridiction politique. Pour l’affaire du sang contaminé, c’est comme cela qu’on s’est retrouvés avec la Cour de Justice de la République.
Je passe sur la décentralisation, qui est tout de même le renforcement des libertés locales.
C’est lui qui a créé la Francophonie parce qu’il considérait que le monde était menacé par la pensée unique américaine et que la Francophonie, l’usage du français dans le monde, était un élément de la liberté de choix et d’une certaine ouverture des esprits.
Sur Schengen, il a été appelé à intervenir à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en août 1993 annulant une disposition de la loi Pasqua qui conduisait à condamner la convention de Schengen, pourtant validée précédemment par le Conseil. Il y avait des engagements européens. François Mitterrand a estimé qu’on ne pouvait pas en rester là et il a dit à M. Balladur : « Nous allons réviser la Constitution pour faire rentrer Schengen dans la Constitution ». Et c’est ainsi qu’a été préparé, par Renaud Denoix de Saint Marc, Secrétaire Général du Gouvernement, un projet de loi constitutionnelle comportant un article qui ajoutait un article 53-1 à la Constitution avec un premier paragraphe qui fait entrer Schengen dans la Constitution. Mais François Mitterrand avait un souci : Il considérait qu’il n’y avait en France qu’un seul droit d’asile, l’asile du roi de France qui accueille qui il veut sur son territoire. Il considérerait que l’asile alimentaire, l’asile humanitaire, ça n’existait pas. Et il n’y avait aussi, après l’asile du Roi, que les « combattants de la liberté », c’est-à-dire l’expression qui figure dans le Préambule de 1946. C’est la raison pour laquelle il a dit à M. Balladur : « J’accepterais votre premier alinéa qui fait rentrer Schengen dans la Constitution, si on rajoute le deuxième » (que je lui ai rédigé, et il a eu la gentillesse de se rallier à ma plume). [Article 53-1 al. 2 de la Constitution] « Toutefois [donc en dehors des accords de Schengen], même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords [de Schengen], les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté (ça c’est la reprise de la formule de 1946) ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. » Et il [Mitterrand] disait : « je reçois qui je veux sur mon territoire et je n’ai pas d’explication à donner à mes voisins ». Et ça c’est une disposition qu’il a utilisée à plusieurs reprises, notamment pour des gens qui – intellectuels, écrivains, ou autres ; d’Afrique du Nord, notamment du Maroc – avaient demandé asile et qui n’avaient pas du tout le droit automatique ou presque d’obtenir l’asile. Donc ça c’est un des points sur lesquels il a agi véritablement en défenseur de la liberté (…).
Conclusion. Voilà, je crois que j’ai fait un balayage aussi rapide que possible, dans l’improvisation la plus totale. Et enfin, je vous rappellerai qu’il a refusé systématiquement, malgré les criailleries, les pressions et les injures, de condamner la République au sujet des évènements de 1942 du Vel d’Hiv et autres, en estimant que la République n’existait plus après le 10 juillet 1940 et qu’on ne pouvait pas condamner un régime qui n’existait pas.
- Nicole Belloubet, juriste, membre du Conseil Constitutionnel.
- François Mitterrand, Mémoires interrompus, Odile Jacob, Paris, 1996, p.22.
- « S’il advient qu’il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soubtiens de preference le pauvre au riche jusqu’à ce que tu sçaches vérité, et, quand tu la cognoistras, fais justice. » Instructions de Saint-Louis au lit de mort, adressées à son fils le Hardi, J.F. Michaud, Histoires des croisades, Furne, Paris,1841.
- Lettre du mercredi 29 août 1984
- Le 15 novembre 1984 en Crète.
- Jean Rosenwald, délégué régional des Forces françaises de l’intérieur (FFI) à Montpellier et Croix de guerre 39-45, premier président de la Cour des comptes de 1982 à 1983.
- Philippe Maurice n’a été libéré que 4 ans plus tard, Matignon n’ayant pas voulu contresigner le décret : Louis Joinet, Mes raisons d’Etat, Mémoires d’un épris de justice, La découverte, Paris, 2013.
- Les réserves sont les clauses restrictives apportées par un état lors de la ratification d’un traité
- Décision n° 91-290 DC du Conseil constitutionnel.