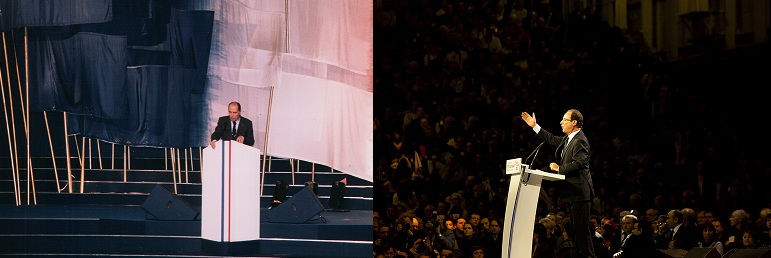Gaston Defferre n’a pas été que le maire de Marseille. Grand résistant puis Ministre sous la IVème et Vème République, il a marqué de son empreinte le paysage législatif français.
Premier candidat à fonder sa campagne sur les médias (« Monsieur X ») lors de la première élection présidentielle au suffrage universel en 1965, il a tenté en vain de rassembler la gauche et le centre à l’élection présidentielle de 1969, avant de rejoindre François Mitterrand.
Gérard Unger a enquêté pendant trois ans auprès des familiers, des amis politiques et des adversaires de Gaston Defferre pour publier, en fin d’année dernière, une belle biographie aux éditions Fayard.
Il revient au cours d’un long entretien pour l’institut François Mitterrand sur le parcours romanesque de ce personnage haut en couleur qui a occupé la scène politique française pendant près d’un tiers de siècle. Retrouvez la seconde partie de cette interview.
Gaston Defferre face à la question coloniale
IFM : La loi de 1946 sur la presse régionale. Peut-on parler d’une affaire de Defferre ?
Gérard Unger : C’est Defferre qui l’a porté sur les fonts baptismaux. Mais il était d’accord avec tous les milieux issus de la résistance. La presse d’avant-guerre était une presse « pourrie », à part quelques journaux comme Le Temps, Le Figaro, ou des journaux de partis comme L’Humanité ou Le Populaire. Le reste, c’était une presse qui se vendait au plus offrant ou qui dépendait de groupes industriels comme celui de François Coty dans les années 30. Defferre voulait une presse d’opinion, libre, qui ne dépende pas des intérêts d’argent. On a vu comment la presse s’est comportée entre 1940 et 1944 : on a décidé en plein accord avec de Gaulle que les journaux qui sont parus après juillet 1940 dans la zone nord et après novembre 1942 dans la zone sud devaient disparaître. Certains ont ressuscité sous une forme voisine : Le Temps qui est devenu Le Monde, avec la même typographie mais avec une équipe différente. Le Figaro avait eu le bon goût de se saborder quand il le fallait. En dehors de cela et de la réapparition de L’Humanité et du Populaire qui étaient interdits pendant la guerre, les autres sont passés à la trappe.
Après, est-ce l’affaire de Defferre ? Je ne le dirais pas comme cela. Disons en revanche qu’à chaque fois qu’il a été ministre, il a essayé de faire une grande loi : 1946, 1950, 1956, 1982.
IFM : On peut voir un parallèle avec la carrière de François Mitterrand sous la quatrième République. Ils incarnent un certain renouvellement de la classe politique…
Gérard Unger : Defferre et Mitterrand ont six ans d’écart. Mitterrand est ministre pour la première fois en 1947, il a 31 ans. Defferre est ministre en 1946, après le départ de De Gaulle, il a 36 ans. Ils sont clairement de la même génération.
Defferre incarnait une sorte de renouveau de la SFIO. Il y avait André Philip avec une ligne plus idéologique et Daniel Mayer qui perd le secrétariat général en 1946 au profit de Guy Mollet. Ils ne sont que quelques jeunes à incarner le renouveau d’un parti qui en a bien besoin. Mitterrand, c’est différent. Il préfère créer un parti qu’il contrôle.
IFM : L’un des grands dossiers de la IVe République : la décolonisation. Vous décrivez Defferre comme un libéral. Que mettez-vous derrière ce terme ?
Gérard Unger : Il ne faut pas faire d’anachronisme. Defferre ne veut pas l’indépendance. L’indépendance n’est voulue que chez les communistes et uniquement pour l’Indochine. Pourquoi ? Parce que la rébellion du Vietminh est une rébellion communiste. Sur l’Afrique noire et sur l’Algérie, jamais le PCF n’a réclamé l’indépendance. L’indépendance ne fait pas partie du schéma de l’époque. A gauche, on considère qu’il faut davantage d’autonomie pour les populations. C’est la position de Defferre. Il voit bien que ça bouge, qu’il faut une évolution. Les populations doivent gérer leurs problèmes internes, la France ne gardant que la défense, la monnaie et les affaires étrangères. C’est pour cela qu’en 1958, Defferre se rallie à de Gaulle. La Communauté correspondait à son ambition.
J’insiste : il ne faut pas faire d’anachronisme. Les gens de gauche ne croyaient pas dans les années 1950 à l’indépendance de l’Algérie et encore moins à celle des territoires d’Afrique noire.
IFM : Même chez Pierre Mendès France ?
Gérard Unger : Oui, c’est pareil. C’est différent pour les protectorats d’Afrique du Nord. Ils avaient des structures telles que la France n’avait pas le droit d’envisager une intégration. L’évolution d’un protectorat, à terme, c’est de redevenir indépendant.
IFM : Sur la question algérienne, Mitterrand et Defferre étaient-ils sur la même ligne ?
Gérard Unger : Defferre voyait plus clair que Mitterrand. Il avait la vision, la connaissance du monde colonial que n’avait pas Mitterrand. Il a vécu à Dakar pendant sa jeunesse, il a vu ce qu’avait été la répression à Madagascar en 1947. Mitterrand ne connaissait pas encore ce monde là. A Marseille, Defferre côtoie déjà des Kabyles. Il est mieux placé à son poste d’observation que Mitterrand à Château-Chinon.
J’ai le sentiment que Defferre voit clair sur cette question depuis les années 1940, notamment après 1947 où il voit les ravages du colonialisme. Ce n’est que plus tard que Mitterrand a compris qu’il fallait une solution libérale tendant vers l’indépendance. Mais cela le faisait souffrir de soutenir de Gaulle. Defferre n’avait aucune difficulté à appuyer le Général sur l’Algérie et à rejeter la politique du gouvernement de Michel Debré.
IFM : Un mot sur l’Eurafrique ?
Gérard Unger : Pour les « libéraux » comme Defferre, il s’agissait de mettre un terme au « colonialisme de papa », qui était violent. Ils souhaitaient conserver une sorte de Commonwealth à la française, qui permettait à la France d’avoir en Europe une assise sur un cercle d’influence colonial complètement rénové et de peser sur le territoire européen.
IFM : Vous décrivez Defferre comme pro-européen…
Gérard Unger : Contrairement à certains de ses amis résistants, pour lui, la page était tournée. Parce qu’il est fortement anti-communiste, il considère que l’Europe qui se construit est nécessaire y compris sur l’armée européenne – il est favorable à la CED. L’Allemagne est redevenue démocratique, il y a la guerre froide et le bloc soviétique. Il faut y faire pièce sinon ce seront les Etats-Unis qui auront une multitude de petits alliés secondaires, ce qui ne lui paraît pas souhaitable.
Defferre, la Ve République et François Mitterrand
IFM : Quels étaient ses rapports avec De Gaulle ?
Gérard Unger : Ils ont toujours été bien meilleurs que ceux de Mitterrand avec de Gaulle. Les deux hommes s’appréciaient car tous les deux ont résisté dès 1940. Mitterrand c’était Vichy pendant assez longtemps, même s’il a rejoint la résistance en 1943 et qu’il a été – contrairement à ce que certains disent – un résistant courageux.
En 1958, Defferre n’est pas tellement défavorable à de Gaulle et considère qu’il peut empêcher les putschs et la guerre civile. Après le débarquement en Corse, il estime tout de même que les institutions républicaines sont menacées et finit par s’opposer au retour du Général. Il semblerait – mais je n’en ai pas la preuve – que de Gaulle lui ait proposé un ministère.
Le contact se renoue en août 1958 à Matignon et ils s’aperçoivent qu’ils ont la même vue sur l’Outre-mer et l’Algérie : une évolution progressive vers l’indépendance. Defferre voit qu’ils ont la même vision sur l’Afrique noire. Et sur la question algérienne, il se rend compte que de Gaulle n’est pas inféodé à l’Algérie française.
Par ailleurs, Defferre ne veut pas avoir les gaullistes contre lui à Marseille – au risque d’être battu. C’est pourquoi, il se rallie à De Gaulle et le reçoit à la mairie de Marseille en 1958.
Les rapports entre les deux hommes resteront de l’ordre d’une estime réciproque.
IFM : Defferre était-il favorable à l’élection du président de la République au suffrage universel ?
Gérard Unger : En 1962, il s’aligne sur la position de la SFIO sans enthousiasme excessif. Très vite, il comprend mieux que la plupart des autres qu’on ne pourra pas mettre Jean Rostand ou Albert Schweitzer comme candidat à la présidence de la République. C’est Jean-Jacques Servan-Schreiber qui l’aide à le comprendre.
IFM : Au moment où Defferre se lance dans la campagne de 1965, Guy Mollet ne comprend pas…
Gérard Unger : Pour Guy Mollet, comme pour Mendès France, la République ce n’est pas l’élection du Président au suffrage universel direct. La République, c’est au mieux un contrat de législature entre l’exécutif et le législatif. C’est le Parlement qui est à la base de la souveraineté et de la légitimité. Pour des gens formés à la IIIe et à la IVe République, l’élection au suffrage universel n’est pas compréhensible. Ils n’ont pas compris que cette élection changeait la donne.
Defferre s’en est rendu compte assez tôt grâce à Servan-Schreiber. Je dirais que Mitterrand l’a compris de son côté tout seul…
IFM : Il y en a un – Mitterrand – qui considère que l’alliance avec les Communistes est nécessaire même s’il est comme Defferre peu favorable au PC. Defferre va, lui, tenter un regroupement plus centriste…
Gérard Unger : Oui. C’est un regroupement de centre-gauche pour faire ensuite pièce au PC et discuter avec lui dans une meilleure position. Mitterrand, dans cette période 1963/64, est à mon avis sur la même ligne. Il soutient Defferre loyalement. On le voit bien lors des conversations avec le Centre de Lecanuet et Fontanet. Mitterrand ne fait rien pour gêner Defferre dans sa tentative. Au contraire, il l’appuie. Quand il voit que ça ne marche pas, Mitterrand dépose sa candidature. Cela déplait à Defferre. Il a l’impression que Mitterrand va réussir là où il a échoué. Pour l’élection de 1965, Defferre fait le service minimum. Il n’organise qu’un meeting à Marseille. Il ne soutient pas Mitterrand outre mesure, d’autant plus que ce dernier se rapproche du parti communiste.
Les rapports entre les deux hommes s’aigrissent d’autant que Mitterrand réussit à faire 32% des voix au premier tour et 45% au second. Leurs relations entre 1965 et 1969 ne vont pas êtres bonnes. La présidentielle de 1969 illustre cette mésentente. Defferre prend Mitterrand de vitesse qui se serait bien à nouveau vu candidat. Le score minable du maire de Marseille – 5 % oblige les deux hommes à se rapprocher. S’ils veulent rénover la gauche, ils doivent se débarrasser de Guy Mollet. Comme le dit l’expression : « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Jamais Defferre n’a voulu être le secrétaire général du nouveau parti socialiste contrairement à Mitterrand qui comprenait mieux l’importance de ce levier.
IFM : A épinay, Defferre ignore-t-il que Mitterrand prévoit l’union de la gauche et l’alliance avec le PC ?
Gérard Unger : Ce n’était pas son souci. Defferre était prêt à passer là-dessus car l’homme à abattre c’était Guy Mollet. Mauroy n’était pas non plus favorable au parti communiste et pourtant il se lance dans cette bataille. C’est l’alliance des « Bouches-du-Nord ».
Defferre procède par étape. Il faut d’abord se séparer de Guy Mollet puis réduire l’audience du parti communiste. Il s’aperçoit très vite que ce que propose Mitterrand est la bonne solution.
Il se rallie à Mitterrand en constatant que sa vision est plus adaptée que la sienne. Il est séduit par son intelligence politique. Le fait de jouer les brillants seconds ne l’a jamais gêné dans sa vie. Il a été le second d’André Boyer dans la résistance, il n’a jamais cherché à jouer les tout premiers rôles dans la SFIO. Alors pourquoi ne pas être derrière Mitterrand ? Dès lors, les liens personnels et humains vont réellement apparaître. Cela donnera Si demain la gauche en 1977 préfacé par François Mitterrand.
J’ajouterai même que Mitterrand était prêt, en 1974, à prendre Defferre comme Premier ministre.
IFM : C’est certain ?
Gérard Unger : Oui, il n’y a pas de doute là-dessus. Les sources concordent. Je pense vraiment qu’il l’aurait pris. On était dans un cadre d’Union de la gauche et il ne fallait pas un Premier ministre à la solde des communistes. Il n’aurait pas choisi Chevènement ou Joxe. Il fallait un homme d’expérience qui puisse faire pièce aux communistes. Deferre était l’homme de la situation : il avait l’expérience politique de la IVe République.
Dans la même logique, s’il a pris Mauroy en 1981 c’est parce qu’il fallait quelqu’un qui n’était pas suspect de sympathie excessive avec le PC. J’en suis persuadé.
IFM : En 1981, Defferre est trop âgé pour espérer le poste de Premier ministre ?
Gérard Unger : Oui, je crois que c’est vrai. En 1981, Defferre a 70 ans et à l’époque, plus qu’aujourd’hui encore, c’est assez âgé. L’Histoire ne repasse pas les plats.
IFM : Pourquoi Defferre n’a-t-il jamais soutenu Rocard, lui, le réformateur ?
Gérard Unger : Rocard ? Defferre ne comprend rien à ce qu’il dit. Et surtout, il lui en veut d’avoir été candidat en 1969. Rocard a fait près de 4% des voix. Ces voix auraient rendu moins misérable le score de Defferre. Les deux hommes ne se sont jamais appréciés.
IFM : Pourtant, la ligne réformatrice de Rocard…
Gérard Unger : C’est une ligne marquée par la gauche chrétienne… Ce n’est pas la sienne, ce n’est pas la même gauche. Defferre est un pur produit SFIO, il lui a toujours été fidèle. Il n’a jamais songé à en partir, même quand il était le plus opposé à Guy Mollet et que beaucoup ont quitté l’organisation pour fonder le PSU. Rocard c’est une gauche chrétienne idéologique à laquelle il ne comprend rien.
IFM : 1981. Le voici Ministre de l’intérieur et il se lance dans l’une des lois qui a sans doute encore aujourd’hui les effets politiques les plus considérables : la décentralisation. Il crée la libre administration des collectivités locales…
Gérard Unger : Toute l’histoire de France est une centralisation progressive du pouvoir aux mains de l’Etat central. Les révolutionnaires n’ont fait que perfectionner ce qu’avait fait l’Ancien Régime. Defferre veut casser ce modèle paralysant. Ce dernier empêche les initiatives locales et favorise un pouvoir bureaucratique. L’administration, bien qu’elle soit de qualité, ne peut pas tout faire ni tout voir : elle est trop loin du terrain. L’Allemagne est constituée de Länder, l’Italie est en partie régionalisée, l’Espagne prend la même direction depuis la chute de Franco. En Europe, parmi les grands Etats, seule la France est centralisée. Et dans le monde, à part les dictatures, les grands Etat sont décentralisés. Par ailleurs, Defferre a trop souffert à Marseille. La décentralisation, c’est sa marotte et sa conviction.
IFM : Il va très vite…
Gérard Unger : Defferre sait qu’il y a un « état de grâce ». Il ne veut pas laisser le temps à l’opposition de démantibuler son projet de loi. Il réunit une jeune équipe de trentenaires brillants… et en avant ! Ils font ça plutôt bien.
C’est une volonté politique, bien évidemment en accord avec Mitterrand mais surtout avec Mauroy. Comme Defferre, il était un grand élu provincial.
IFM : A vous lire, Gaston Defferre a été un très bon ministre de la décentralisation mais un très mauvais ministre de l’intérieur…
Gérard Unger : Je dirais plutôt un « mauvais ministre de la police ». Mais il y a débat. J’ai entendu deux sons de cloche. Thiriez me disait qu’il s’intéressait aux affaires policières. Sanmarco disait au contraire qu’il y avait un côté résistant, libertaire chez Defferre.
Concrètement, il n’a pas été aidé par les circonstances extérieures avec les attentats à Paris et en province, commandités par la Syrie et les Palestiniens dissidents.
Par ailleurs, Defferre connaissait mal le monde la police. Il a fait des réformes sans mesurer le poids et l’importance de la hiérarchie. Quand il propose au commissaire Marcel Leclerc d’aller à Marseille, ce dernier considère cette décision comme une punition alors que c’était une promotion dans l’esprit de Defferre. Dès lors, le dialogue devient difficile. Defferre a commis l’erreur de s’appuyer sur les syndicats contre la hiérarchie alors que la droite les noyautait et les téléguidait. Il a vite été dépassé et ce n’est pas l’arrivée de Joseph Franceschi qui a arrangé les choses…
J’ai tendance à rejoindre Sanmarco plus que Thiriez. Defferre n’a pas été un bon ministre de la police. Ce n’était pas de sa compétence.
Cela n’enlève cependant rien à ses réussites et à sa trace dans l’histoire de notre pays. Defferre a marqué la politique française plus que de nombreux Premiers Ministres. Il avait l’amour de sa ville, de son parti et de son pays. Il a toujours été loyal et efficace à la fois, ce qui n’est pas si fréquent…
La fin
IFM : En mai 1986, Gaston Defferre connaît ce que vous appelez « sa première défaite complète à Marseille ». Il perd son influence au sein de la fédération socialiste et voit, impuissant, les appétits s’ouvrir pour sa succession. Le destin en décidera autrement avec son décès, brutal, quelques heures après un comité fédéral houleux… Pourriez-vous revenir sur la fin de sa vie ?
Gérard Unger : La fin de vie de Gaston Defferre est effectivement marquée par les difficultés qu’il rencontre au sein de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Il s’oppose en effet à Michel Pezet qui se verrait bien prendre la place de celui qui règne depuis trente-trois ans à la mairie et trente-six ans à la Fédération. En 1986 Defferre a en effet près de 76 ans mais il ne veut pas décrocher et se sent en pleine forme.
Le combat pour le contrôle de la Fédération est rude, marqué par toute une série de coups bas dont les réunions locales du PS ont le secret. In fine après de multiples péripéties, Defferre perd la bataille, peut-être par fatigue car tous les observateurs de la dernière réunion de la Fédération sont frappés par son absence intellectuelle à la fin de la soirée. Defferre rentre chez lui et tombe peu après sur le sol, sa tête heurtant un bac « Riviera », il saigne beaucoup mais a la force d’appeler le Professeur Sanmarco, frère de celui qui l’a beaucoup aidé à mettre de l’ordre à la mairie de Marseille.
Par un malheureux concours de circonstances (il faut aller chercher le chauffeur pour trouver les clés de l’appartement), le médecin et les marins pompiers arrivent trop tard. Defferre est sans connaissance et déjà pratiquement mort.
IFM : Les réactions au décès de Gaston Defferre sont nombreuses et ses obsèques particulièrement impressionnantes… Qu’en dire ?
Gérard Unger : Les obsèques de Defferre, quelques jours après, ont été en effet impressionnantes. Elles ont eu lieu sur le Vieux Port, à la hauteur de la Mairie . Le Président de la République François Mitterrand était présent ainsi que Charles Pasqua et François Léotard, ministres de la toute nouvelle cohabitation ; tous les « ténors » du PS assistaient à la cérémonie et Lionel Jospin a prononcé un discours émouvant. Une célébration oecuménique a eu lieu ensuite à la cathédrale de la Major, et le cercueil fut porté par des jeunes représentants de toutes les communautés qui constituent le Marseille d’aujourd’hui. Les Marseillais avaient pu la veille se recueillir devant le cercueil et ils furent nombreux à le faire, ce qui explique sans doute que la participation de la population marseillaise aux obsèques elles-mêmes fut relativement mesurée.
IFM : Vous faites de Gaudin l’héritier de Defferre. Pourquoi ? Comment expliquez-vous le passage à droite d’une ville à gauche depuis la fin de la seconde guerre mondiale (excepté le passage du gaulliste Michel Carlini entre 1947 et 1953) ?
Gérard Unger : J’ai dit effectivement que Jean-Claude Gaudin était l’héritier de Defferre car d’une part, il a vu pendant plus de vingt ans comme conseiller municipal comment gouvernait le maire de Marseille et d’autre part, il a appliqué les mêmes méthodes que lui : municipalité composée de proches mais aussi d’alliés, contacts suivis par les réseaux politiques avec les différents quartiers et les communautés de Marseille, liens avec le syndicat FO pour le bon fonctionnement de la mairie etc…
Comme Defferre, Gaudin a pour préoccupation principale sa ville et il n’a pas voulu sacrifier sa carrière nationale (il n’a été qu’une seule fois ministre de novembre 1995 à juin 1997). Quant au passage à droite de la ville, on peut l’expliquer par l’usure de la domination socialiste pendant plus de 40 ans (en y incluant le mandat de Robert Vigouroux) mais surtout par l’évolution de la composition sociale et politique de la population : arrivée des Pieds-Noirs qui votent majoritairement à droite, venue de nombreux Maghrébins et Comoriens dont la présence provoque des incidents racistes, et montée du FN dans la ville comme dans le reste du pays.
Defferre intime
IFM : Dans cette dernière partie, nous souhaiterions aborder la dimension moins politique du personnage.
A la frontière entre politique et vie privée, nous retrouvons la pratique des duels. Gaston Defferre est considéré comme le « dernier duelliste ». On pense bien évidemment à son opposition à l’épée contre le député gaulliste de Seine-et-Oise, René Ribière, en 1967. Ce n’était pas une première pour le maire de Marseille. Pourriez-vous revenir sur cette pratique qui illustre une nouvelle fois le caractère bien trempé de Gaston Defferre ?
Gérard Unger : Defferre est en effet le seul homme politique qui ait eu recours après la guerre au duel. La première fois ,ce fut en 1947 contre Paul Bastid, Directeur de l’Aurore, journal auquel il reprochait de l’avoir mis en cause – à tort – dans l’affaire des vins. Le combat eut lieu au pistolet et ne fit pas de victimes.
En 1967, agacé à l’Assemblée Nationale par les interruptions incessantes du député UNR René Ribière, Defferre l’honora dans l’hémicycle d’un sonore « abruti ! » Ayant refusé de s’excuser, le duel devint quasiment inévitable malgré les interventions du Général de Gaulle qui trouvait ce mode de règlement de conflit quelque peu dépassé. Defferre, qui avait repris des cours d’escrime, blessa son interlocuteur au bras, après avoir déclaré à tous les medias qu’il allait viser chez son adversaire un endroit stratégique vu que ce dernier allait se marier le lendemain…Il mit ainsi les rieurs de son côté et la France entière, amusée, eut droit au dernier vrai duel de son histoire. Tout ceci montre effectivement le courage physique de Defferre qu’aucun de ses adversaires n’a jamais contesté.
IFM : Vous décrivez un Gaston Defferre épris de culture, notamment du mouvement surréaliste. Ce n’est pourtant pas l’une des facettes de sa personnalité la plus connue…
Gérard Unger : Defferre était un homme de culture bien qu’il n’ait jamais voulu le montrer. Apparaître cultivé pour un homme politique à Marseille ne passait pas pour un signe de vigueur…
Dès l’adolescence Defferre s’est passionné pour le mouvement surréaliste au point qu’à sa mort, lorsqu’on a ouvert son coffre, on y a trouvé toutes ses cartes du Parti Socialiste depuis son adhésion en 1933, les lettres échangées avec le Général de Gaulle.., et le « Manifeste du surréalisme » d’André Breton. Lorsqu’à la fin des années 1960, Jacques Brel est en tournée à Marseille et, qu’après le spectacle, il chante « Amsterdam », pour Paul Lombard et Gaston Defferre seuls, Defferre répond en récitant par cœur « le Fard des Argonautes » de Robert Desnos.
Après s’être marié en 1973 avec Edmonde Charles-Roux, Defferre, grâce à son épouse prend publiquement des contacts avec des intellectuels qu’ils ne fréquentait guère auparavant. Et c’est ainsi que l’on voit le maire de Marseille, qui s’est opposé frontalement depuis la guerre aux communistes, apprécier la conversation de Louis Aragon et d’Elsa Triolet…
IFM : Andrée Aboulker, Edmonde Charles-Roux et dans une moindre mesure Marie-Antoinette Swaters, pourriez-vous revenir sur l’importance des femmes dans le parcours de Defferre ?
Gérard Unger : Les trois femmes que vous citez ont compté dans la vie de Defferre. Andrée Aboulker, sa première épouse, lui a ouvert, dans les années 1930, des horizons intellectuels, notamment sur le monde communiste et les milieux politiques de gauche. Si elle n’est pas à l’origine de la vocation socialiste de Defferre et n’a pas fait de lui un idéologue, elle a contribué à façonner son intérêt pour la politique.
Marie-Antoinette Swaters, dite « Paly », a, après la guerre, renforcé la position de Defferre dans les milieux bourgeois marseillais et l’a délivré de tout souci d’argent. Peut-être moins séduisante qu’Andrée Aboulker, mais très courageuse elle aussi,– elle a servi dans l’armée britannique durant la guerre –« Paly » avait les pieds sur terre et un très solide bon sens.
Quant à Edmonde Charles-Roux, ainsi que je l’ai dit plus haut, elle a ouvert à Defferre des horizons intellectuels et lui a fait connaître les milieux culturels nationaux. Si Roland Petit est venu diriger les ballets à Marseille et Marcel Marechal créer le théâtre de la Criée, c’est largement à elle qu’on le doit.
Au-delà de la vie sentimentale on voit bien que ces trois femmes de qualité, de milieux et d’origine très divers, ont contribué à faire de Gaston Defferre ce qu’il est devenu.