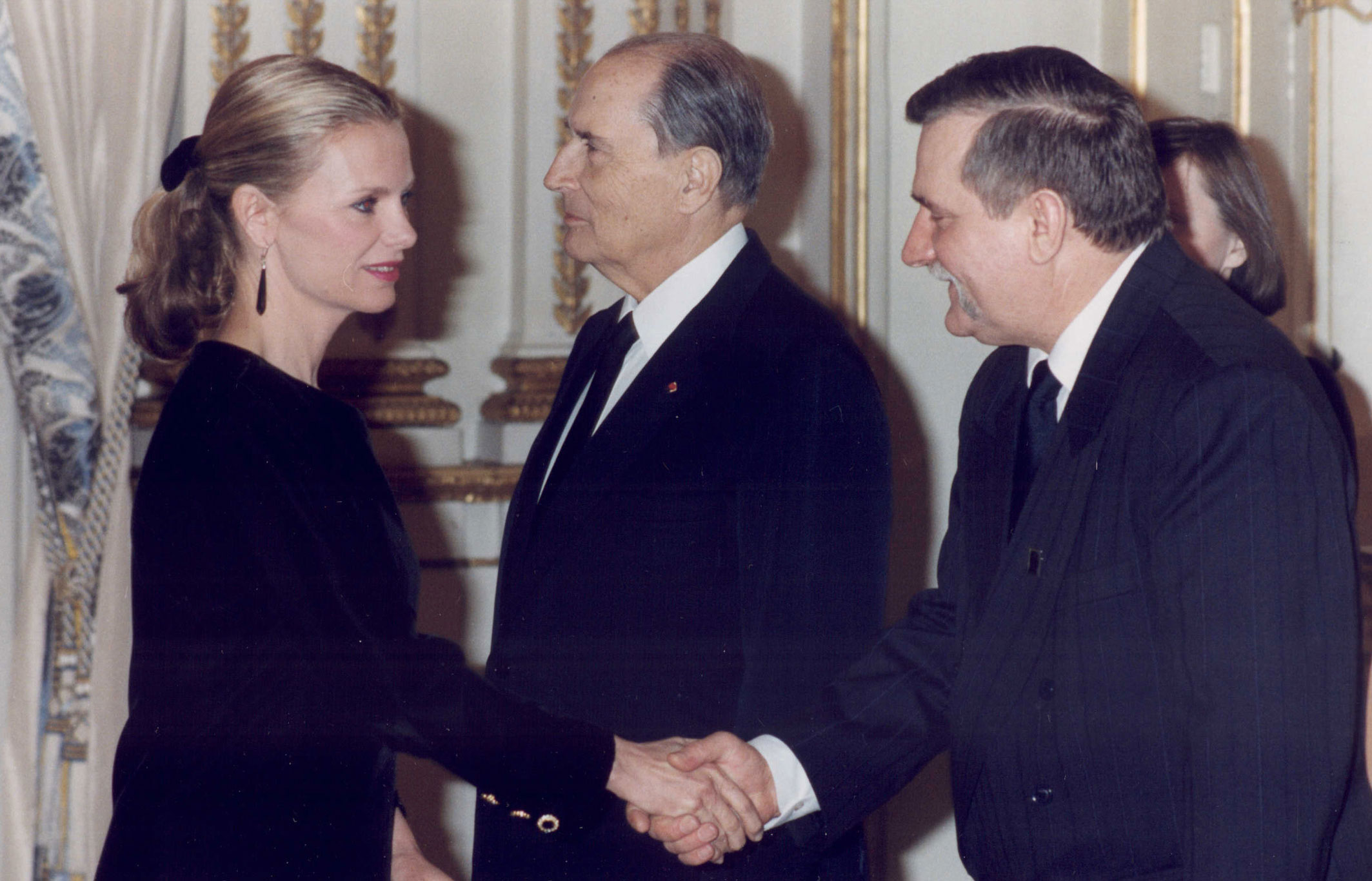A l’invitation de l’association « Image de l’Europe à Bruxelles » et de son Secrétaire général Patrick Huart, l’Hôtel de ville de Bruxelles a accueilli le 18 février 2016 un hommage « Européen » au Président François Mitterrand. La manifestation débuta par un mot d’accueil de Jean-Marie Amand, au nom de la Ville de Bruxelles, puis Gilles Ménage, Secrétaire général est intervenu pour l’IFM. Jean-Pol Barras, secrétaire général du Parti socialiste belge de 1995 à 2008, délégué des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie à Paris de 2008 à 2013 et auteur du Journal d’un juré de campagne. François Mitterrand d’un bout à l’autre à prononcé une longue allocution sur le thème « Mitterrand l’Européen », texte que que nous publions ici.

Dire et faire. Tout est là chez les hautes personnalités qui marquèrent leur époque, aussi bien du côté de Talleyrand que chez Victor Hugo. Il ne faut pas fignoler, interpréter ; il convient juste de s’attacher aux traces, de les servir et de les révéler en tant que témoins.
Il ne faut pas non plus trop s’arrimer aux anniversaires historiques. Le système décimal nous en procure le prétexte en distillant les caprices des dates et le hasard taquine les destins. Prudence !

Féru de littérature et passionné d’Histoire (un mot qu’il orthographia toujours avec un H majuscule), François Mitterrand aurait sans doute été sollicité pour commenter ces rendez-vous-là.
Peu sensible à la philosophie, il n’avait pas dû être attiré par la personnalité de Thomas More. Le mot utopie, il l’employait surtout dans ses envolées lyriques pour rappeler les conquêtes obtenues grâce aux luttes sociales, en affirmant : « les utopies d’aujourd’hui seront les réalités de demain. »
Profondément pétri de culture française, il n’était pas polyglotte. Très sensible au choix du mot exact, à l’emploi du terme propre, il se méfiait des traductions. Shakespeare ne devait donc pas figurer parmi ses livres de chevet. Quant à Cervantès, il le citait comme n’importe quel connaisseur de Don Quichotte. Il y avait puisé la fameuse formule « Laisser du temps au temps » et il affectionnait l’allusion au combat contre les moulins. Ainsi, lors de la conférence de presse à l’issue du Conseil européen du 30 mars 1982 : « Je suis, disait-il, un partisan d’Epictète : ce sur quoi je peux agir, j’agis. Ce sur quoi je ne peux pas agir, je n’agis pas. Permettez-moi de trouver cela plus efficace que de lutter contre les moulins à vent. »
On peut parier que cette étrange coïncidence du 23 avril 1616 ne laissa pas Mitterrand indifférent. Car un écrivain de ses amis, disparu le mois dernier, Michel Tournier, en était tout à fait subjugué. Il y décelait d’autant plus un signe miraculeux que ce jour-là, c’est le jour de la Saint-Georges, saint patron de la chevalerie qui mourut aussi un 23 avril, en l’an de grâce 303 après avoir terrassé le dragon, symbolisant la victoire de la foi chrétienne sur le démon (Qu’on m’autorise ici une parenthèse en forme de clin d’œil à Monsieur le bourgmestre de Mons Elio Di Rupo, en l’imaginant accueillir François Mitterrand et Michel Tournier lors des festivités du Doudou dans sa bonne ville, ou visitant la somptueuse exposition consacrée au mythe de Saint-Georges l’an dernier dans le cadre de la capitale européenne de la Culture…)
Michel Tournier habitait un presbytère, à Choisel, dans la vallée de Chevreuse ; Mitterrand lui rendait visite de temps en temps pour parler de littérature. Il avait découvert que Tournier connaissait tout l’œuvre d’Emile Zola, un auteur qui le passionnait « au fait précisait-il que son œuvre littéraire est une œuvre politique, même quand il ne l’a pas voulu, et que son œuvre politique est toujours restée littéraire ».
Mais Michel Tournier dégageait une autre caractéristique, plus rare : il était germanophile et l’érudition qu’il en tirait intéressait le président au point d’améliorer ses connaissances de l’Allemagne.
Car avec François Mitterrand, on en revient toujours à l’Europe. L’Europe, c’est la grande affaire de sa vie. Plus il entre dans l’Histoire, et plus on perçoit cette constance dans son engagement.
Comme celles et ceux qui avaient connu la guerre, il savait attribuer à l’expression Plus jamais ça ! une fonction créatrice empreinte d’une volonté indéfectible, ferment d’un monde nouveau à créer sur les ruines de l’apocalypse éradiquée.
Oui, au lendemain de l’effroyable conflit mondial qui naquit sur nos terres, la prédiction de Victor Hugo plantant son chêne avant de rentrer en France trois quarts de siècle plus tôt enflammait les cœurs et motivait la raison.
Oui, en cette époque-là, l’Europe devenait un idéal de vie commune.
Oui, en ce temps-là, on parlait des États-Unis d’Europe sans que cela ne paraisse absurde.
Des ligues et associations naissaient dès 1946 qui appelaient au rassemblement des États du Vieux continent : Les Nouvelles équipes internationales chrétiennes, le Mouvement socialiste français pour les Etats-Unis d’Europe, la Ligue européenne de coopération économique, d’inspiration libérale, l’Union européenne des fédéralistes et bien d’autres finirent par se coordonner. François Mitterrand est aux avant-postes des rencontres et des congrès fondateurs. C’est tout naturellement qu’il assiste donc au fameux congrès de La Haye du 7 au 10 mai 1948, considéré comme la base de la naissance d’un fédéralisme européen. Plus de 750 délégués issus de quasiment tous les pays européens y participèrent. Des observateurs officiels venant des Etats-Unis et du Canada y avaient été conviés.
Au soir de sa vie, Guy Spitaels1 nous confiait avec émotion que lors de sa première visite à l’Élysée, Mitterrand avait commencé d’emblée par lui parler de ce rendez-vous haguenais. Spitaels s’était contenté de dire : « J’y étais, j’y croyais » et Mitterrand de laisser tomber : « Moi aussi » avant de revenir tout de suite aux choses du présent comme pour se délivrer de la nostalgie.

Cependant, il saisissait les moments propices pour évoquer ces journées-là. Écoutons-le, en 1984 par exemple, lors d’un voyage aux Pays-Bas… :
« Voici près de trente-six-ans, ici même, et très précisément dans cette salle des Chevaliers où j’ai l’honneur de m’adresser à vous, j’ai vu naître un grand dessein sous la présidence de Winston Churchill… A peine sortis d’une guerre qui laissait l’Europe pantelante, comme frappée à mort, vingt ans après une guerre qui avait tué la jeunesse et l’espoir du siècle, pour la première fois, des hommes et des femmes encore meurtris et déchirés, enveloppés de deuil et du sang des combats de la veille, juraient de reconstruire ensemble, mieux encore, d’inventer l’Europe réconciliée. Oui, j’étais l’un de ceux-là. Avec ce beau printemps, la vie recommençait. »
Et cette même année 1984, ce même homme devant le Parlement de Strasbourg :
« Jeune parlementaire, j’assistais à cet événement. Je me souviens de mon propre enthousiasme. Là se trouvaient tous les fondateurs de l’Europe, de cette génération-là, de Robert Schuman à De Gasperi. Là se trouvaient beaucoup de parlementaires et d’organisations que personne n’avait mandatés, qui venaient simplement offrir au monde, en tout cas à l’Europe, une réponse à ses maux… »
S’il est bien un anniversaire historique dont la pertinence pourrait accoucher de pistes fructueuses, ce serait bien celui-là ! Avis à ceux qui aiment relever des défis : rendez-vous le 7 mai 2018 dans la salle des Chevaliers du Binnenhof à La Haye …
Car il est intimidant de relire aujourd’hui les conclusions du Congrès de La Haye. En vrac : élimination des restrictions à l’échange des marchandises, convertibilité des monnaies, mobilité de la main-d’œuvre, assemblée européenne élue au suffrage universel, plus deux douzaines d’autres projets, jusqu’à la création d’un centre européen de l’enfance, de la jeunesse et de la culture. C’était, rappelons-le, en mai 1948 … Des utopies qui devinrent réalités…
En 1953, Mitterrand fut ministre-délégué à l’Europe dans le gouvernement Lamiel. Il n’avait pas attendu la signature du Traité de Rome pour s’impliquer dans la construction européenne mais il avait très vite saisi, après les rêves échafaudés lors des glorieuses journées de La Haye, que la tâche la plus lourde serait d’élaborer un esprit européen, la volonté d’un destin commun.
Le retour au pouvoir du général de Gaulle survint quelques mois après la signature de l’acte de naissance symbolique de l’Union européenne. De longues années d’opposition totale ne permirent pas à François Mitterrand d’influencer la construction européenne. Avant de mettre de Gaulle en ballottage en décembre 1965, se relançant ainsi au premier plan de la vie politique française, il avait publié Le Coup d’État permanent, un chef-d’œuvre de polémiste, un réquisitoire sans concession contre la monarchie gaullienne. On n’y trouve que quelques pages consacrées à l’Europe mais elles sont virulentes. En voici un échantillon :
« Le général de Gaulle est passé sans les voir à côté des grandes idées de son siècle … En la privant de l’Europe, en l’éloignant de l’Assemblée des Nations-Unies, de Gaulle a retiré à la France les véritables instruments qui étaient à sa portée pour justifier ses prétentions au rayonnement universel. Il n’a pas compris ce qu’il a fait perdre à son pays en faisant perdre à l’Europe ses plus belles années. »
Le développement qui suit cette réfutation est cinglant : si l’Europe des Six ne décolle pas aussi bien qu’elle le pourrait, c’est parce que le nationalisme gaullien freine sa construction. Le nationalisme, une tache qui ronge la démocratie. Il le combattra jusqu’à son dernier souffle, ainsi qu’on le verra.
La décennie qui suivit fut celle du renouveau socialiste. Après le Congrès d’Epinay de juin 1971 donnant naissance au PS de son cru, toujours dans l’opposition, il consacra son idéal européen à visiter ses camarades : Willy Brandt à Berlin et à Bonn, en premier lieu, bien sûr, mais aussi Olof Palme à Stockholm ou Bruno Kreisky à Vienne, avant que ne survienne la fin de la nuit fasciste sur la péninsule ibérique et que d’autres amis et disciples, Mario Soarès à Lisbonne et Felipe Gonzales à Madrid, ne préparent leur pays à l’adhésion qui semblait aller de soi grâce au retour de la démocratie.
L’évidence n’avait pas besoin d’emphase. Dès le 28 septembre 1978, le Premier secrétaire du Parti socialiste déclarait au micro de France Inter : « On ne peut pas nier que l’Espagne, le Portugal et la Grèce soient de cette Europe, essentiellement de cette Europe, de sa culture, de son histoire et de sa géographie. Ce sont des pays aujourd’hui démocratiques. On ne va pas leur fermer la porte. » La Grèce deviendra le 10e membre de la CEE en 1981, l’Espagne et le Portugal feront l’objet du 3e élargissement, sous le premier septennat, en 1986.
Durant cette fructueuse décennie où de jeunes enthousiastes – les sabras comme il les appelait … – rejoignirent les rangs du Parti socialiste et l’aidèrent à conquérir le pouvoir, il n’avait pas les moyens de peser sur une Europe qui le décevait, emberlificotée dans ses dédales bureaucratiques et ses méandres administratifs. C’était l’époque où Mitterrand aimait constater que « Quand l’Europe ouvre la bouche, c’est pour bâiller ».
Enfin le 10 mai vint. L’Europe n’est pas citée dans sa déclaration à chaud, depuis Château-Chinon, le soir de la victoire. Mais elle est incluse dans cette phrase intimidante : « Des centaines de millions d’hommes sur la terre savent ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu’ils ont appris à aimer d’elle. » Le langage qu’ils ont appris à aimer d’elle… Jamais les balises des siècles ne sont oubliées dans le corpus d’un discours de Mitterrand. Et comme cette expression résonne avec justesse chez les enfants des Lumières !
L’Europe n’est pas davantage évoquée dans les deux discours officiels que le nouveau président prononce le 21 mai, jour de son intronisation, au palais de l’Élysée d’abord, à l’Hôtel de ville de Paris ensuite. Elle est cependant inscrite dans ses préoccupations constantes.
Après avoir donné à son pays des réformes sociales que l’Histoire retiendra au même titre que celles du Front populaire, il décide, en mars1983, de rester dans le Système monétaire européen. Ce tournant-là est encore souvent battu en brèche aujourd’hui. Avec le recul du temps, il faut admettre que l’objectif est avant toute chose de ne pas amoindrir voire handicaper l’Europe, peut-être même éviter de stopper son édification.
Défendre l’Europe, la promouvoir, c’est d’abord l’empêcher de stagner, la mettre toujours en mouvement.
« Je suis moi aussi contre les euromissiles. Seulement, je constate que les pacifistes sont à l’ouest et les euromissiles à l’est ; et je pense qu’il s’agit là d’un rapport inégal. » Cette petite constatation, faisant appel au bon sens, l’air de ne pas y toucher, prononcée ici, lors d’un toast au côté du Roi Baudouin en octobre 1983 confirme ce qu’il avait déjà évoqué le 20 janvier devant le Bundestag et lui assure la confiance d’Helmut Kohl en mettant un terme à une crise avec l’Union soviétique qui durait depuis 1977 et en augmentant du même coup l’indépendance de l’Europe à l’égard du grand protecteur américain.
Á partir de ces journées-là, la construction européenne prend un autre essor. Elle sera tout entière marquée par l’empreinte mitterrandienne. Car dès le 1er janvier 1984, il appartient à la France de présider pour un semestre le Conseil européen. Dans son livre Les Mondes de Mitterrand, Hubert Védrine raconte que quelques jours plus tôt, il avait fait venir son ami Roland Dumas à l’Élysée pour lui annoncer, devant quelques proches collaborateurs : « Je vais vous nommer ministre des Affaires européennes et nous allons désembourber l’Europe. » Désembourber l’Europe, encore une belle expression qui trouve hélas ! sa pertinence de nos jours…
Qu’est-ce que cela signifiait à l’époque ? D’abord fortifier le moteur franco-allemand que tout le monde reconnaissait indispensable à l’élan. Ensuite en finir avec le chantage que Margaret Thatcher entretenait depuis le sommet de Dublin du 30 novembre 1979, son fameux diktat « I want my money back » ; et reprendre l’initiative pour faire progresser la Communauté. Le sommet de Fontainebleau de la fin juin entérina les objectifs de Mitterrand : le duo avec Kohl devint trio grâce à la nomination de Jacques Delors à la tête de la Commission, le chemin vers l’Acte unique et le Traité de Maastricht était ouvert et celui des accords de Schengen déjà esquissé.
Les actes découlant des paroles ne doivent pas occulter les symboles. Lorsque trois mois plus tard, le 22 septembre, François Mitterrand prend la main d’Helmut Kohl à Verdun, devant un catafalque symbolisant les morts de la Première Guerre mondiale, tous les peuples d’Europe et des autres continents comprennent que la réconciliation franco-allemande dépasse la simple entente autour d’un ordre du jour de réunion, fût-ce-t-elle importante, mais qu’elle inaugure une ère nouvelle. La décennie Delors, la plus riche et la plus féconde, en sera l’illustration volontariste.
La fin du premier septennat se profilait. En sollicitant un second mandat, François Mitterrand innova encore. Il rédigea un long texte d’intentions qu’il fit démultiplier à des millions d’exemplaires. Contrairement à sa profession de foi de 1981, cette Lettre aux Français contenait un chapitre européen très affirmé. En voici un extrait :
« Faire vivre ensemble douze pays que l’histoire a souvent divisés, parfois cruellement, exige une attention de chaque instant : mais elle avance. Elle est déjà la première puissance commerciale du monde et elle pourrait, si elle le voulait, devenir la première puissance scientifique et technologique, la première puissance agricole et disputer au Japon et aux Etats-Unis le titre de première puissance industrielle. »
Il évoque plus loin la monnaie commune qui, « pour peu, dit-il que les Européens s’y décident, constituera, avec le dollar et le yen, l’un des trois pôles du nouvel ordre monétaire. »
Nous sommes au printemps de 1988. Réélu président de la République, Mitterrand accordera d’autant plus « une attention de chaque instant » à l’Europe qu’il laisse à son Premier ministre Michel Rocard le soin de s’occuper des affaires intérieures.

Nous parlions tantôt de la conjonction des dates. Il y a 4 mois, souvenons-nous, la muse birmane Aung San Suu Kyi faisait une entrée triomphale au parlement. On rappela que le 10 décembre 1991, assignée à résidence, elle fut privée de se rendre à Oslo afin de recevoir son Prix Nobel de la Paix. Les historiens auront de quoi faire avec cette date. Car c’est aussi ce 10 décembre 1991 que fut conclu le Traité de Maastricht, dont le contenu mériterait à lui seul une conférence, et qui revêt une importance équivalente à celle du Traité de Rome. Le peuple français le ratifia par référendum le 20 septembre 1992.
Ce fut la dernière œuvre magistrale en faveur de l’avancée européenne que put réaliser Mitterrand. Son second mandat n’était point terminé, loin de là ; il aurait pu continuer sur sa lancée, resserrer les liens de l’approfondissement. Kohl y était prêt, à présent que l’abandon du mark et la réunification de l’Allemagne étaient quasiment assumés. Mais trop de paramètres freinaient l’action : la chute du Mur de Berlin obligeait la Communauté à privilégier l’élargissement plutôt que l’approfondissement ; au plan intérieur, une nouvelle cohabitation se préparait, plus délicate, plus dure que la précédente ; le référendum sur le Traité de Maastricht avait été gagné mais de justesse, la France n’était pas prête à se dissoudre davantage dans une perspective fédéraliste ; et puis, la santé du président était défaillante.
Après le grand œuvre, le temps des paroles n’est pas encore achevé.
Jusqu’à l’ultime minute de son mandat présidentiel, François Mitterrand n’aura de cesse de plaider en faveur du rapprochement des peuples européens. Deux discours sont à graver dans le marbre. Celui qu’il prononce le 17 janvier 1995 devant le parlement de Strasbourg, en forme de message d’adieu, contient des leçons de vie, des conseils et une recommandation principale. On y retrouve aussi les accents d’un militant de la cause européenne qui connut la guerre (« Il faut transmettre… »), la captivité, ses contacts avec les Allemands (« Il faut vaincre ses préjugés… ») Ses phrases résonnent aujourd’hui comme des mises en garde plus que jamais pertinentes.
Á présent que l’homme est entré dans l’Histoire, il est cité sans scrupule par des responsables de tous bords, certains anciens adversaires le prennent même parfois en exemple. « Les morts sont tous des braves types » chantait Brassens. Eh bien que tous les boutefeux, les obsédés du pouvoir, ceux qui se croient plus malins que le diable et qui l’invitent à leur table méditent ces paroles, hélas! prémonitoires pour bien des États-membres de l’Union : « Il faut transmettre … Il faut vaincre ses préjugés… Ce que je vous demande là est presque impossible car il faut vaincre notre histoire et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu’une règle s’imposera, Mesdames et Messieurs les députés : le nationalisme, c’est la guerre ! »

Ces moments berlinois, ces mots-là devaient, on le comprend, habiter l’esprit d’Helmut Kohl lorsqu’il écrasa une larme le jour des funérailles à Notre-Dame.
Il ne faut pas s’arrimer aux anniversaires historiques. Si le prétexte offert par le système décimal doit être saisi et, l’estime et l’affection aidant, approfondi, il importe de ne pas abandonner le sujet lorsque le millésime s’est éteint.
Le personnage que nous honorons aujourd’hui laissera une trace dans l’Histoire bien au-delà de cette présente année.
Du reste, dès le début de la suivante, la République française se retrouvera encore face à son destin pour se bâtir un nouveau quinquennat.
Au cours des cinq premiers mois (au moins) de 2017, le nom de François Mitterrand reviendra dans les discours, les commentaires, les allusions favorables ou vicieuses, les joutes, les débats et, bien sûr, les références.
Parfois, les émotions des souvenirs alimenteront la mémoire. Les forces de l’esprit sont tenaces.
Déjà, elles nous rappellent que dans les meetings de la campagne présidentielle de 1974, on projetait un film avant que le candidat n’occupe la tribune. Ce documentaire nous le montrait à l’ouvrage, proposait des témoignages et soulignait ses contacts avec le peuple.
Le film s’intitulait : Certains l’appellent François.
François… Un prénom qui convient tellement bien à la France… !