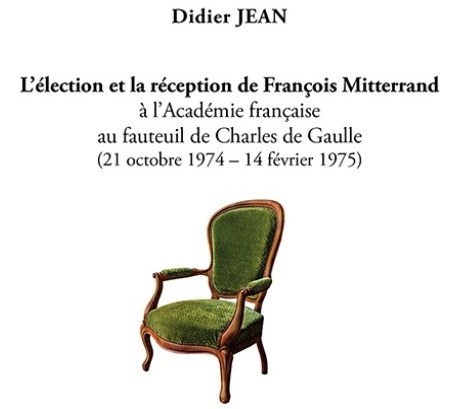Mon 10 mai1981
Ce texte est un condensé de celui que j’avais rédigé quelques jours après l’élection de François Mitterrand et que j’avais intitulé Pour ne pas oublier. Il est bien sûr très subjectif et partisan ; je dois de préciser qu’entouré de copains de lycée communistes ou gauchistes j’avais adhéré en novembre 1970 à la Convention des institutions républicaines, j’avais 18 ans, ce n’était pas banal ! Puis ce fut Epinay et le passage au PS qui ne m’enchantait guère, mais le tourbillon des années 1970 me fit oublier mes premières réticences.
En cette fin d’après-midi du 10 mai, je suis avec JM, dans le TER qui nous ramenait vers Paris ; j’étais aller passer le week-end chez ses parents en Charente, pas celle de François Mitterrand tournée vers l’Atlantique, mais celle de l’Est du département au même ciel bleu et à la même douceur de vivre, mais aucune vigne à l’horizon, une terre d’élevage et de polyculture tournée vers le rude Massif central. En regardant le paysage défiler, j’ai la certitude que la victoire sera proclamée ce soir ; pourtant la campagne électorale m’a paru moins enthousiaste que celle de 1974, la plus belle des campagnes. Mais tous les indices concordent et le rejet de Valéry Giscard d’Estaing, que je juge injuste avec le recul, est tel et son incapacité à renouer avec l’opinion si flagrante que les jeux semblent faits.
19 heures, à la descente du train gare d’Austerlitz je scrute les visages, j’interroge les regards, rien . Une rentrée de fin de semaine comme les autres , tout juste légèrement écourtée afin de pouvoir voter avant la clôture du scrutin. 19h30 à deux cents mètres de mon bureau de vote je croise un ami survolté, il vient d’avoir des nouvelles de Solférino et me hurle « on a gagné ». Je vais donc accomplir mon devoir électoral alors que mon candidat est déjà élu par les instituts de sondage qui attendent 20 heures pour annoncer les résultats. Dans le bureau de vote les mines réjouies de visages connus montrent que la nouvelle commence à se répandre. Je me précipite chez moi pour avoir confirmation devant la télévision. Je suis euphorique. En chemin je rencontre une militante communiste que je connais bien, visiblement elle ne partage pas ma joie, je comprendrai ensuite qu’elle avait pratiqué le « vote révolutionnaire » en faveur du Président sortant.
20h30, nous sommes, JM et moi, au milieu d’un cortège joyeux qui rejoint la place de la Bastille où commence la fête préparée et organisée par Paul Quilès . Les slogans fusent, puis les chants ; derrière les rideaux des fenêtres éclairées des silhouettes regardent, certainement inquiètes, tous ces cortèges joyeux, mais certainement menaçants pour les électeurs du camp d’en face. A la Bastille et sur les boulevards y menant, la foule commence à envahir l’espace. Sur la scène, les premiers politiques arrivés se font applaudir, surprise et amusement, ils ne sont pas de ceux qui ont été les meilleurs soutiens de la candidature de François Mitterrand depuis les trois dernières années. C’est le moins que l’on puisse dire ! La foule est immense, bon enfant, tous les âges confondus, je garde en mémoire les jeunes parents avec leurs enfants sur les épaules. C’est la fête ! Je pense à mon grand-père parti trop tôt pour vivre ces moments d’euphorie. Nouvelle surprise, alors que l’orage menace et que les premières gouttes commencent à tomber, je m’aperçois que beaucoup de regards scrutent le ciel, une rumeur circule : on attend l’hélicoptère qui va déposer le nouveau Président sur l’estrade ! Quelle symbolique, le nouvel élu descendu du ciel, je suis plus que perplexe. Il est évident que du fait de la configuration de la Place de La Bastille, noire de monde, un atterrissage est totalement irréalisable et que les conditions météorologiques qui s’aggravent de minutes en minutes rendent totalement impossible une telle manœuvre. Je comprends à cet instant que beaucoup va être demandé à François Mitterrand et que sa tâche va être rude quand il faudra expliquer que tout n’est pas possible tout de suite. Depuis le début de la soirée JM est à mes côtés, il pense à son examen du lendemain matin à Science po, mais il sait bien qu’il lui sera difficile de trouver le sommeil. Nous décidons alors de rejoindre la rue de Solférino. A l’entrée du métro c’est un flot continu de familles qui arrivent de Paris et de ses banlieues et dont nous devons remonter le courant. Les employés de la RATP applaudissent et tentent de canaliser le flux. Ce soir Paris voyage gratuitement.
23 heures, rue de Solférino On se faufile dans la foule retenue derrière des barrières de sécurité. Un idée fixe, rentrer au siège du PS à quelques mètres de nous. Je réussi à me procurer deux badges grâce à un couple de journalistes qui se chamaille, s’apprêtent à quitter les lieux privilégiant leurs affaires de coeur à l’événement. A nos côtés un septuagénaire, il fulmine et veut aussi entrer, il veut faire la fête, il arrive du siège du candidat vaincu mais l’ambiance n’y était pas ! Dans la cour, sous un chapiteau, les invités s’embrassent, des postes de télévisions, que personne ne regarde, diffusent les traditionnels débats des soirées électorales L’information tombe, François Mitterrand a quitté Château-Chinon. Il se fait tard, la pluie redouble, nous partons. A l’extérieur la foule est encore plus compacte, nouveauté des policiers sont arrivés pour canaliser les ardeurs. Il semblerait que François Mitterrand soit arrivé entre-temps ; la Renault 30 est garée devant le porche de la rue de l ‘Université, les photographes se bousculent, des coups de poings partent, la police est débordée et fait ce qu’elle peut. Sous les sifflets plusieurs coupures d’électricité plongent le quartier dans le noir. Devant le porche Guy Ligier fait les cent pas. 2h30, la porte s’ouvre, François Mitterrand apparaît sous les vivats, il fait le signe du sportif victorieux les deux mains jointes à hauteur du visage. Il s’engouffre dans la voiture qui démarre, escortée de motards, en direction du boulevard Saint-Germain et poursuivie par les supporters déchaînés.
Nous rentrons, une immense tristesse m’envahit. Je sais qu’il ne sera plus possible de croiser le Président, piéton de Paris, qui quittait, souvent seul, à pied, l’Assemblée nationale par le boulevard Saint-Germain où il était presque habituel de le croiser en fin d’après-midi. Il répondait au signe de tête et, si l’envie lui venait, il échangeait quelques mots en portant la plus grande attention à son interlocuteur.
Patrice Liquière