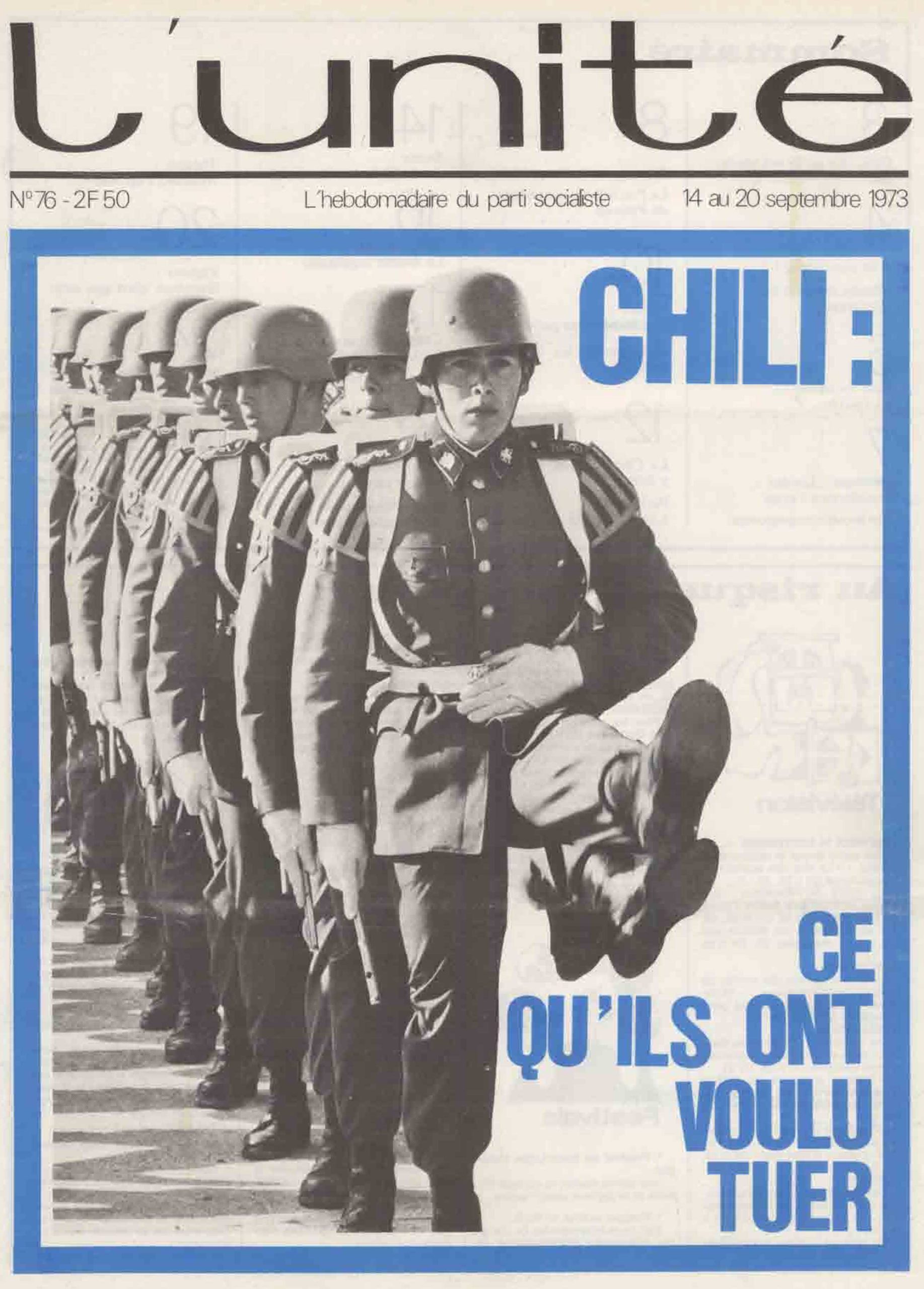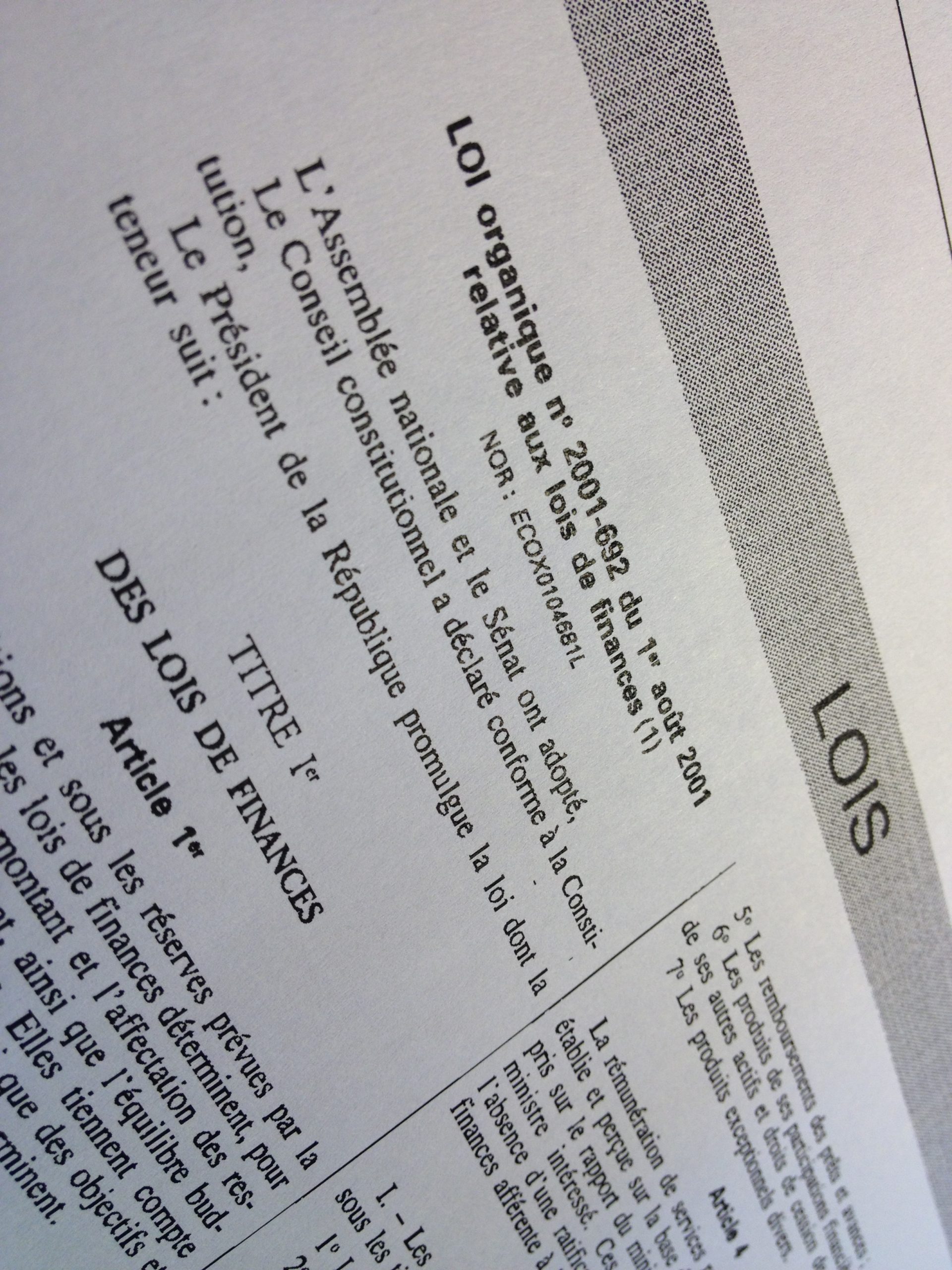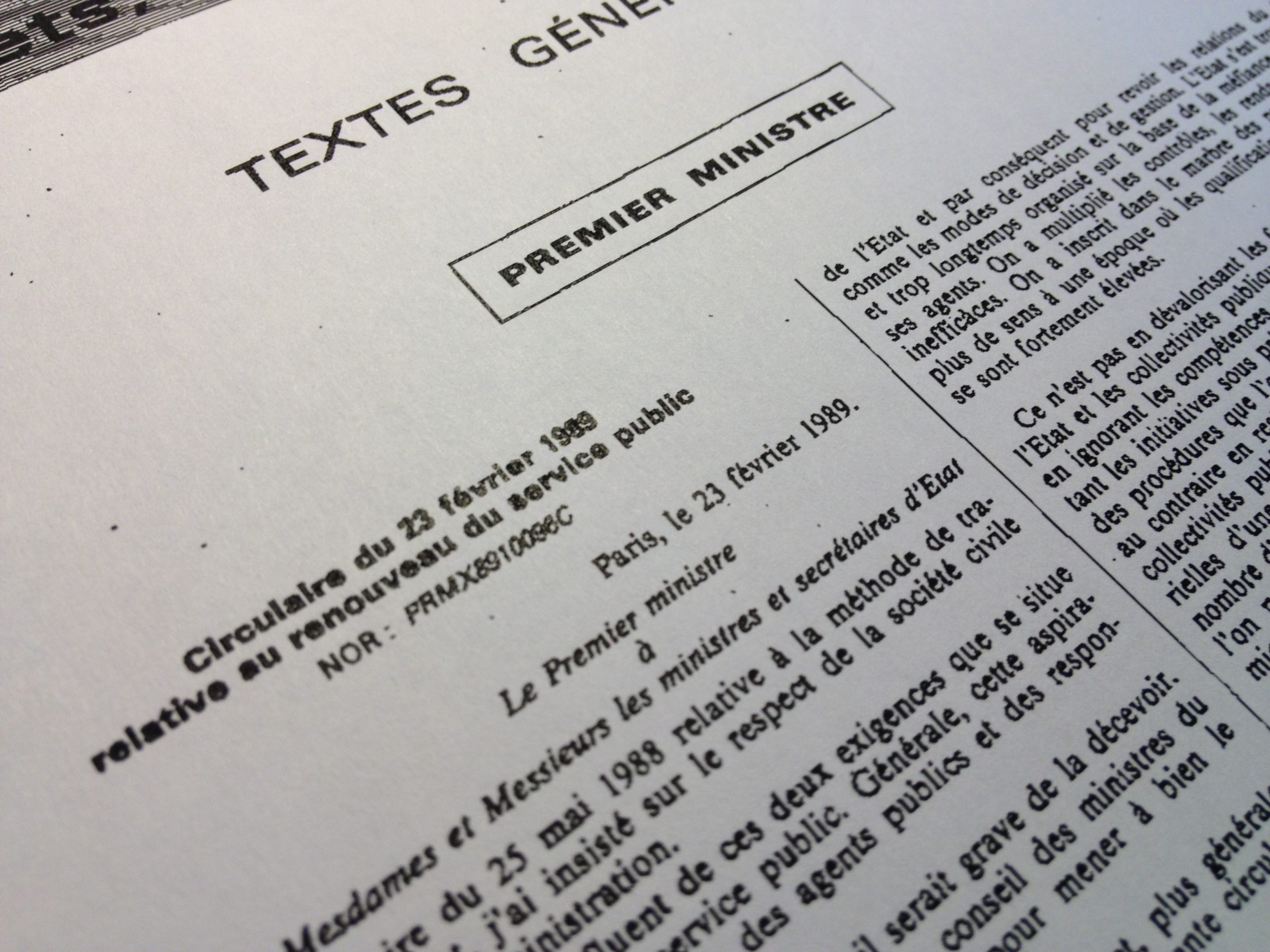Mitterrand et son gouvernement prennent le modèle français d’administration publique tel qu’il est. Ils vont, sans en altérer l’esprit, l’infléchir sur un point important (la décentralisation[Lire [La Lettre de l’IFM n°6 sur les lois de décentralisation]]). Mais ils renforceront dans le même temps l’un de ses éléments fondamentaux (le statut de la Fonction publique). Enfin, loin de remettre en cause le rôle de l’Etat, ils chercheront à lui donner une extension notable par la voie des nationalisations. Ces actions ne resteront pas sans incidence sur l’évolution ultérieure.
La gauche et son gouvernement ne font donc pas la réforme de l’Etat telle qu’on la concevra par la suite. Mais ils posent des actes majeurs qui pèsent encore aujourd’hui. Ce sont eux que je voudrais d’abord évoquer.
Dans le même temps le train de ce que l’on appelle alors les réformes administratives continue son parcours, à petite vitesse il est vrai. Anicet Le Pors s’en explique dans son témoignage. Je dirai comment je l’ai vécu.
Reste à rappeler un point que François Mitterrand a toujours considéré comme fondamental : la primauté du politique. Il veillera à la maintenir à son niveau et à celui de ses ministres. C’est un trait fondamental de sa pensée et de son action.
Un infléchissement durable : la décentralisation
Le sujet de la décentralisation mériterait à lui seul, un numéro entier de cette lettre. Je ne l’évoque ici que pour souligner trois points.
La rapidité de l’action. On en parlait depuis longtemps : la gauche l’a fait en un clin d’œil. Bien secondé par un cabinet efficace Gaston Defferre a pris de court tous ses collègues du gouvernement. L’une des toutes premières grandes réformes du septennat aura été la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Certes tout n’a pas été réglé dès cette date. Il faudra d’autres lois pour préciser les compétences, organiser les procédures. Mais le mouvement était lancé. Il sera irréversible.
La radicalité du changement. La création des régions en 1972, l’élection du maire de Paris depuis 1977, avaient préparé le terrain. Mais c’est bien par les textes du début des années 80 que l’on a mis fin au modèle jacobin de l’administration française. Les collectivités territoriales ont désormais un exécutif autonome, elles se voient reconnaître une compétence générale sur les affaires les concernant.
L’ampleur des conséquences. Une nouvelle composante de l’action publique en France s’est constituée. Elle intervient dans la plupart des domaines qui concernent la vie des Français. Elle occupe une place de plus en plus importante dans l’économie. La fonction publique territoriale compte aujourd’hui près de 1.900.000 agents, les dépenses de l’administration territoriale représentent plus de 10 % du produit national. Il ne faut pas s’étonner si elles sont devenues l’une des cibles privilégiées de l’effort de réduction des dépenses publiques dans notre pays : véritable casse tête pour le pouvoir politique toutes tendances confondues.
La consolidation d’un rempart : le statut de la fonction publique
A la différence de la décentralisation la refonte du statut de la fonction publique ne figure pas dans les 110 propositions du candidat Mitterrand. Mais le programme commun de gouvernement dans sa version reprise par les deux partis, annonçait bien « une réforme démocratique du statut de la fonction publique » qui devait permettre d’assurer « la partipation réelle des fonctionnaires à la bonne marche du service public ». Il ne faut pas s’étonner de voir Anicet Le Pors, ministre communiste de la fonction publique, faire de cette réforme l’axe central de son action. S’appuyant sur l’attelage d’un syndicaliste, René Bidouze, son directeur de cabinet, et d’un Conseiller d’Etat, Marcel Pinet, directeur général de la fonction publique, il lui donnera une ampleur que l’on n’avait pas prévue à l’origine. Là encore, comme pour la décentralisation, l’action volontariste d’un ministre se sera avérée déterminante.
Sur le fond le nouveau statut s’inscrit dans le prolongement du texte fondateur de 1946, repris pour l’essentiel en 1958. Il précise et clarifie les règles applicables, mais, en définitive, il codifie plus qu’il n’innove. C’est sur le champ d’application que la nouveauté est la plus importante . Désormais, en effet, le statut s’applique non seulement aux agents de l’Etat mais aussi à ceux des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers.
L’édifice ainsi réalisé, avec un statut général chapeautant les règles applicables aux trois grandes fonctions publiques, est unique au monde par son volume (de l’ordre de 5 millions de personnes sont concernées) et par son applicabilité tant verticale (du haut en bas de l’échelle hiérarchique) qu’horizontale (le corps enseignant, le personnel hospitalier, souvent traités à part dans d’autres pays, sont inclus dans le même régime). Il ancre solidement notre pays dans le camp de ceux qui se sont refusés à passer à une fonction publique d’emploi.
Ce choix a perduré. La fonction publique française reste sous un régime statutaire. Elle a résisté à la tentative esquissée pour en sortir au début de la présidence de Nicolas Sarkozy. Sur ce point essentiel, le modèle français résiste toujours à l’offensive du NPM (new public management), alias NGP (nouvelle gestion publique).
Un essai qui ne sera pas transformé : l’administration économique
Sur ce dernier sujet qui, en ma qualité d’ancien responsable du Plan, me tenait à cœur, la gauche n’a pas pu aller jusqu’au bout de sa démarche. Le programme politique qu’elle mettait en œuvre, avec l’élément central que constituait la nationalisation du crédit, des assurances et des grands groupes économiques, s’inscrivait dans le prolongement des grandes réformes de la libération et il aurait dû avoir pour corollaire la réorganisation et le renforcement de l’administration économique. A supposer qu’elle l’ait vraiment voulu, la gauche au pouvoir n’a pas eu le temps de la promouvoir.
Le commissariat au Plan aurait dû être appelé à se voir reconnaître, dans cette perspective, un rôle essentiel. N’y a pas contribué l’attribution du portefeuille du Plan à Michel Rocard, un homme politique prestigieux mais qui, faute de la confiance du Président et du Premier ministre, n’a pas pu exercer pleinement la fonction d’entraînement et de coordination qui aurait dû être la sienne.
Les nationalisations se sont faites. Une loi dite de démocratisation du secteur public a précisé utilement le mode de fonctionnement des entreprises publiques et les conditions de la participation des salariés à leur gestion. On a certes senti quelques flottements ou crispations dans la relation entre ministères de tutelle et entreprises publiques mais, dans certains secteurs au moins, j’en ferai l’expérience à la SNCF, la pratique des contrats de plan est venue encadrer utilement la réalisation des investissements et le développement des activités.
Le changement de majorité en 1986 a mis fin à cette dynamique. Contrairement à ce qui s’est passé sur les deux points précédents, la gauche n’a pas dans ce domaine transformé son essai. Loin de se renforcer, l’appareil économique de l’Etat, au fil des alternances successives, ne fera que se déliter.
En témoignera vingt ans plus tard la suppression du commissariat au Plan par le gouvernement Villepin. J’en aurai personnellement un peu plus tard une preuve supplémentaire. J’avais l’honneur d’appartenir au Haut Conseil du Secteur public, mis en place en 1982 par la loi de nationalisation. Composé de hauts fonctionnaires, de parlementaires, de syndicalistes et de personnalités qualifiées, il n’avait qu’un rôle consultatif et faisait régulièrement des rapports sur des sujets transversaux d’ordre économique et financier. Il a longtemps survécu comme une sorte de rocher témoin des ambitions de la gauche. Il sera en 2008 la toute première victime de la RGPP dont la mesure n°1 fut précisément d’en décider la suppression. Tout un symbole.
Le train courant des réformes administratives
Indépendamment de ces orientations nouvelles les actions du gouvernement de la gauche, en ce début des années 80, se sont inscrites dans la continuité des efforts entrepris depuis un certain nombre d’années pour améliorer, sans en changer les principes ni les articulations fondamentales, l’efficacité de notre système administratif. Elle n’ont pas marqué sur ce point une étape significative entre les réformes importantes réalises sous le septennat giscardien pour améliorer les relations entre l’administration et les citoyens (textes sur la motivation des actes administratifs, sur l’accès aux documents administratifs, création de la CNIL) et la démarche novatrice de renouveau du service public lancée en 1989 sous le gouvernement Rocard et dont il sera question ci-dessous.
Le projet de charte des relations entre l’administration et les usagers préparé par les services d’Anicet Le Pors s’inscrivait dans le prolongement des avancées de la décennie précédente. Il n’a eu, comme l’ancien ministre l’explique dans son témoignage, qu’un débouché limité. Je ne suis pas sûr que cet échec relatif n’ait pas été dû, entre autres causes, au réflexe stupide consistant à ne pas vouloir mettre en avant, sur un sujet séduisant pour l’opinion, une initiative émanant d’un ministre communiste.
J’avais de mon côté, en ma qualité de secrétaire général du gouvernement, provoqué la mise en place de la MODAC, mission d’organisation des administrations centrales. Présidée par le conseiller d’Etat Francis de Baecque, elle devait proposer les transformations que le processus de décentralisation aurait dû logiquement entraîner dans l’organisation des ministères. Elle déboucha sur des propositions que les ministres, à l’exception de Paul Quilès pour le ministère de l’urbanisme, du logement et des transports, allaient laisser dans leur tiroirs : j’ai pu à ce propos mesurer combien, en l’absence d’une forte volonté politique, les changements structurels sont difficiles à imposer.
Premier ministre à partir de juillet 1984, Laurent Fabius a senti pourtant que le sujet de la réforme administrative pouvait devenir porteur. Il avait même un moment songé à créer un grand ministère « des simplifications administratives et de la vie quotidienne ». Je lui donnai sur ce point, en novembre 1984, peut-être à tort, un avis négatif, compte tenu de l’hétérogénéité des attributions qu’aurait dû avoir un tel organe et de son probable manque d’autorité. Diverse mesures de simplification devaient cependant être prises par le gouvernement à sa demande, notamment, sur un sujet qui redevient aujourd’hui à la mode, la fixation d’un délai maximum – ce fut un mois à l’époque – pour procéder à l’ensemble des formalités de création d’une entreprise. Une autre mesure symbolique fut l’obligation faite au fonctionnaire en contact avec le public de porter un badge avec son nom.
En définitive c’est dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information que le progrès le plus notable a été réalisé pendant cette période, avec la création du CIIBA, comité interministériel de l’informatique et de la bureautique dans l’administration, qui tint sa première réunion le 3 septembre 1984. Il s’agissait d’encourager les différents ministères à s’engager dans la voie nouvelle de ce que l’on appelle aujourd’hui l’e-gouvernement, c’est à dire l’informatique, alors encore à ses débuts, appliquée à l’administration. En liaison étroite avec Jean Le Garrec, et avec l’accord de la direction du Budget, nous avons mis en place une structure interministérielle que je présidais en l’absence du Premier Ministre et dont le secrétariat était assuré par un spécialiste du domaine, Jean-Paul Bacquiast.
Nous avons pu dégager une enveloppe financière qui a notablement augmenté d’une année sur l’autre, et mettre en place une procédure de programmation pluriannuelle des crédits, qui a permis d’encourager les expériences innovantes sélectionnées parmi celles que présentaient les différents ministères. Plusieurs domaines d’intervention ont été privilégiés : renseignements administratifs et documentation juridique ; utilisation des cartes à mémoire ; expérimentation des systèmes experts ; messagerie télématique interministérielle. Un programme important de formation a été mené. Des schémas directeurs du développement informatique ont été établis dans les différents ministères. Il est satisfaisant de pouvoir constater aujourd’hui que l’action initiée à l’époque s’est depuis lors poursuivie et amplifiée, plaçant notre pays dans une position relativement favorable en ce domaine.
La primauté du Politique
En définitive François Mitterrand s’est fort bien accommodé du modèle français de gestion de l’Etat. Il avait du respect pour l’administration comme pour la justice. La métaphore des « petits pois » ne serait jamais venue sous sa plume ou dans ses discours. Mais il savait garder les distances et préserver la liberté de ses choix. L’administration lui apportait ses compétences. Mais elle devait rester à sa place.
En témoigne le choix qu’il a fait de ses collaborateurs. Ce n’est pas une promotion de l’ENA qui est entrée en même temps que moi à l’Elysée en 1981. Ni l’un ni l’autre des deux chefs de file de la maison, le secrétaire général et le directeur de cabinet, n’appartenaient à la fonction publique. Bérégovoy avait un profil politique. Rousselet était un homme d’affaire.[ Lire dans ce numéro,[ l’article de Jean Glavany : François Mitterrand et les fonctionnaires : une relation complexe]]
Je vois encore la stupéfaction de Barbet, vice-président du Conseil d’Etat lorsque je lui fait part de la proposition qui m’a été faite de venir seconder Pierre Bérégovoy dans sa fonction de secrétaire général de la Présidence. Dans l’esprit de mon chef de corps il ne pouvait être question pour un conseiller d’Etat d’accepter un statut d’adjoint. Il ne donnera qu’à contrecœur son accord à mon départ.
Dans les recommandations qu’il fait régulièrement aux membres du gouvernement, lors des conseils des ministres, Mitterrand revient souvent sur le devoir qu’ils ont de garder la maitrise de leur administration. « Je ne veux pas que les ministre parlent sur notes écrites. Nous sommes le conseil des ministres de la République française. Les ministres doivent connaître leurs affaires » leur dit-il le en leur donnant des consignes sur le fonctionnement du conseil des ministres. Ou encore, à propos du retard mis par les services à prendre les mesures d’application des lois « Un ministre qui ne met pas la loi en application ne doit pas rester ministre. Il ne faut pas que les ministres tombent sous la coupe de leur administration. » (26 septembre 1984). Et l’on se souvient de son algarade, le 2 février 1983, à l’occasion d’une communication du ministre de l’industrie, contre le comportement à ses yeux fâcheusement dirigiste des bureaux des ministères de tutelle vis à vis des nouveaux dirigeants des entreprises que l’on venait de nationaliser. « Il faut préserver la capacité d’initiative, la liberté d’action, ne pas confondre socialisme et bureaucratie ».
Vis à vis du principal intéressé, Jean-Pierre Chevènement, la remontrance était injuste. Mais elle reflète bien l’état d’esprit du chef de l’Etat. Au demeurant ce n’est pas sur le plan de sa relation avec l’administration qu’il rencontrera les plus grandes difficultés dans l’exercice de son mandat. Contrairement à ce que certains auraient pu craindre, et à de rares exceptions près, les hauts fonctionnaires n’ont pas eu de réticences à mettre en œuvre les orientations du nouveau gouvernement. La conciliation entre le service de l’Etat et la loyauté au gouvernement du moment fait partie de notre tradition républicaine et, en l’occurrence, elle a fort bien fonctionné.