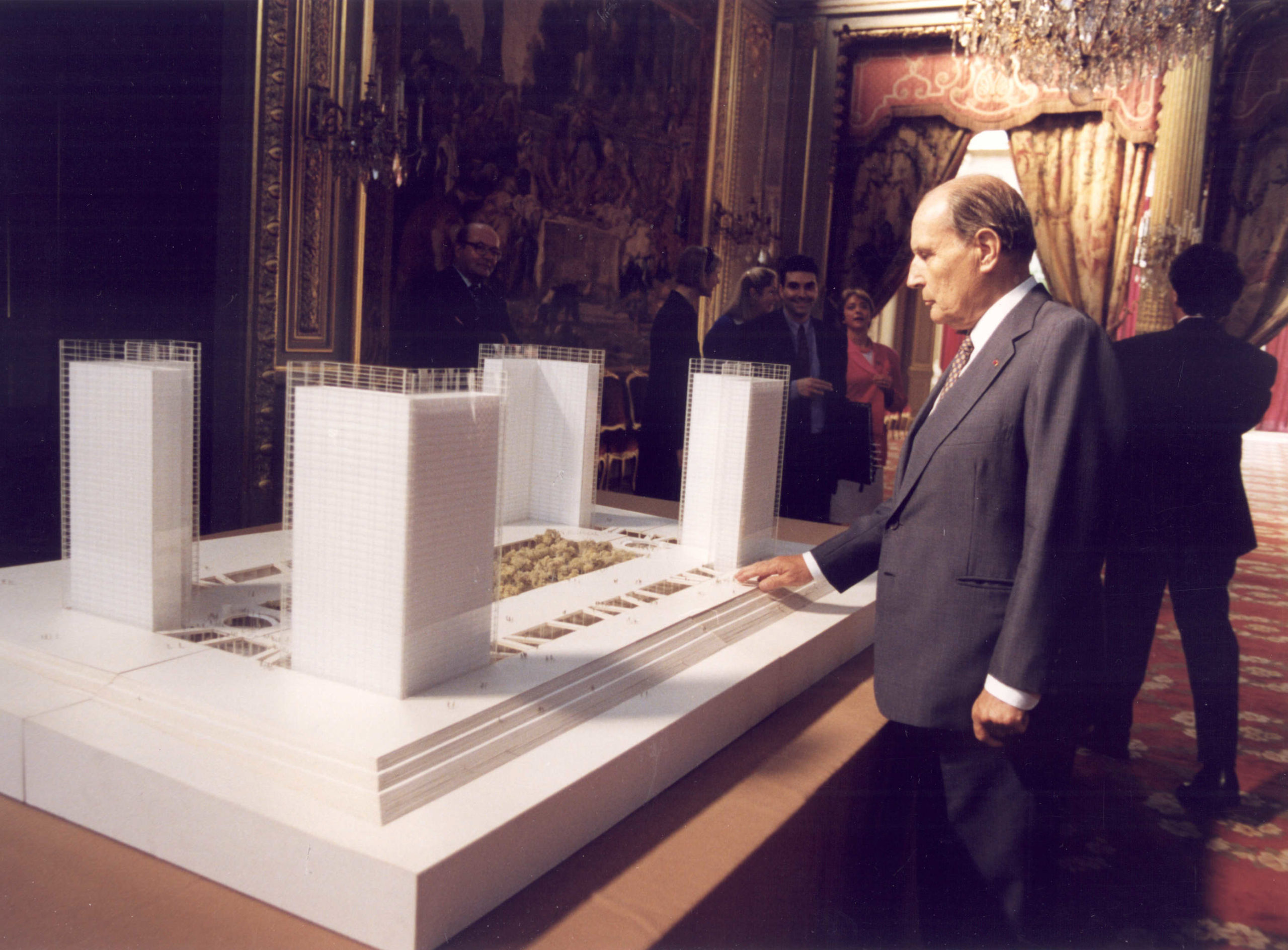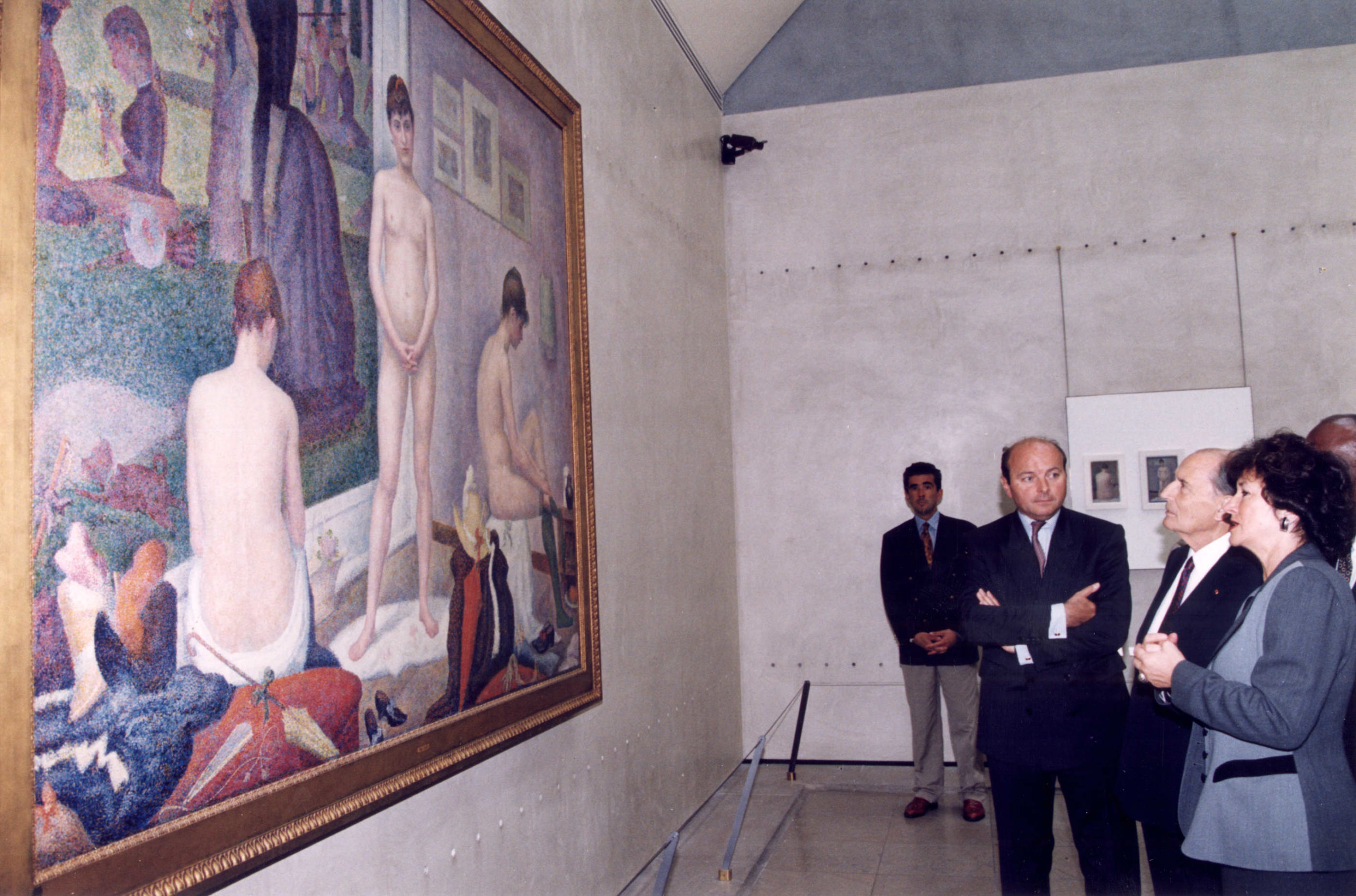Jean-Pierre Filiu, docteur en histoire, arabisant, de formation, diplomate, ancien conseiller de Pierre Joxe à l’Intérieur et à la Défense, puis de Lionel Jospin à Matignon, vient de publier un ouvrage qui fera date par la qualité de sa réflexion et la rigueur de son information. Le regard de Jean-Pierre Filiu, qui est celui d’un observateur scrupuleux doublé d’un témoin engagé, restitue, dans toute sa complexité, un fascinant portrait de « Mitterrand l’Oriental ».
Votre livre, paru un peu avant le dixième anniversaire de la mort de François Mitterrand, se distingue radicalement de bien des ouvrages de circonstance sortis à cette occasion. Je sais que vous portez ce projet en vous depuis plus de vingt ans. Parlez-nous un peu de sa genèse.
Jean-Pierre Filiu – Ce travail de longue haleine est un essai d’histoire diplomatique du temps présent. J’ai eu la chance de rencontrer dès l’été 1980, dans le cadre d’un mémoire pour Sciences-Po, Yasser Arafat et d’autres personnalités palestiniennes que l’on retrouve aux différentes étapes de ce récit. J’ai ensuite, au cours de missions humanitaires au Liban, été frappé par l’incompréhension de la politique et de la personnalité de François Mitterrand, alors même que le président de la République avait engagé notre pays comme jamais sur le terrain libanais. J’ai dès lors commencé à rassembler témoignages et documentation sur ce sujet, aussi controversé que méconnu. Mais il m’aura fallu le recul du temps pour prendre toute la mesure de la contribution exceptionnelle de François Mitterrand au règlement du conflit israélo-palestinien.
Rien, ni dans son histoire personnelle ni dans le contexte politique, ne semblait prédisposer François Mitterrand à rencontrer le mouvement palestinien et à sauver son chef. Par quel cheminement en est-il arrivé là ?
Jean-Pierre Filiu – Mon livre s’efforce justement de décrire, avec de nombreux détails inédits, ce cheminement intellectuel et moral. L’amitié que François Mitterrand a conçue et forgée pour Israël au cours des ans le pousse à se mobiliser avec détermination sur le dossier palestinien. L’histoire de ce parcours politique est l’histoire d’une initiation et d’une cohérence.
L’initiation est celle d’un homme politique né au début du siècle dernier, formé dans la Résistance, qui, comme toute la classe politique de la IVe République, établit une équivalence naturelle entre Israël et la Terre sainte de Palestine. Cette équivalence est d’autant plus forte pour François Mitterrand que, durant l’été 1949, le conflit encore chaud le contraint, après un trajet par la route depuis Amman, de demeurer dans le secteur oriental de Jérusalem sous contrôle jordanien, et lui interdit d’accéder à Israël, perçu plus que jamais comme assiégé. Cet engagement spontané aux côtés du jeune État juif se nourrit aussi des ruses de l’Histoire, le ministre Mitterrand officialisant la position de son gouvernement lors du drame de l’Exodus ou de la reconnaissance de jure d’Israël par la France. Les errements coloniaux de la guerre d’Algérie et de l’expédition de Suez vont accentuer cette empathie pro-israélienne, nourrie des relations personnelles nouées dès 1955 avec Shimon Peres… et Menahem Begin. À partir de 1965, François Mitterrand à la tête de la FGDS, puis du PS, voit aussi dans le soutien aux travaillistes israéliens le moyen d’afficher sa différence avec le PCF pro-arabe et favorable à la « politique arabe » gaullienne.
Et pourtant, ce dirigeant foncièrement pro-israélien va, dès 1972, découvrir la misère des camps de réfugiés de Gaza, aux côtés de son maire Rachad Chawa, et, dès 1974, rencontrer au Caire Yasser Arafat, bien avant la première rencontre entre un ministre français et le chef de l’OLP. Mitterrand s’engage en vain durant l’été 1976 pour éviter le massacre des civils palestiniens du camp de Tall Zaatar, au nord de Beyrouth, il visite peu après Hébron et est impressionné par le nationalisme palestinien qui se développe en Cisjordanie, au point d’envisager publiquement un État palestinien. Cette initiation de la décennie soixante-dix voit Mitterrand acquérir un solide bagage palestinien et se forger une doctrine claire, avec son appel dès 1980 à la reconnaissance mutuelle et simultanée entre Israël et l’OLP. Mitterrand n’a donc pas attendu son accession à l’Élysée pour prendre en compte l’acuité de la question palestinienne, et Valéry Giscard d’Estaing lui reproche d’ailleurs vertement, au cours du débat télévisé du 5 mai 1981, de s’être engagé plus avant que lui en faveur de l’État palestinien…
Comment, une fois arrivé au pouvoir, François Mitterrand parvient-il à tenir son engagement ?
Jean-Pierre Filiu – La cohérence de la démarche de François Mitterrand avant comme après le 10 mai est impressionnante. Elle va de l’appel à la reconnaissance mutuelle Israël-OLP en 1980 à cette extraordinaire déclaration de 1992 à Jérusalem : « le droit est le même » entre Israël et le futur État palestinien. Cette cohérence, fondée avant l’élection présidentielle, se développe sur la promesse, réalisée en mars 1982, d’une visite d’État en Israël, et sur les trois sauvetages de Yasser Arafat par François Mitterrand.
Cette promesse, Mitterrand veut la tenir coûte que coûte, malgré les coups de force successifs de Begin (bombardement d’Osirak en juin 1981, raids sur le Liban en juillet, annexion du Golan en décembre), le Premier ministre israélien devenant ainsi le « meilleur allié » de Claude Cheysson auprès du chef de l’État. Le discours prononcé devant la Knesset est littéralement historique, avec la mention de l’OLP et l’ouverture de la perspective de l’État palestinien. Ce discours engage Mitterrand, ce que Begin et son ministre de la Défense Sharon ne comprennent pas. D’où les trois sauvetages.
On a un peu oublié les circonstances tragiques dans lesquelles ont eu lieu les deux premiers sauvetages, dont vous faites un récit haletant, et ce qu’avaient de littéralement inouï les initiatives prises alors par François Mitterrand.
Jean-Pierre Filiu – Le premier et le plus spectaculaire de ces sauvetages se déroule en août 1982 à Beyrouth, Mitterrand refusant de laisser détruire la capitale libanaise et s’appuyant sur le souhait américain de ménager les régimes arabes pro-occidentaux (surtout après la mort du souverain saoudien Khalid et sa succession par Fahd). La détermination du chef de l’État est totale, malgré l’attentat de la rue des Rosiers, et en dépit de la volonté de Sharon d’éliminer Arafat. Mais cette opération techniquement parfaite est vite ternie par les massacres de Sabra et Chatila. Le deuxième et le plus dangereux de ces sauvetages intervient en décembre 1983 à Tripoli (Nord-Liban), la France se heurtant aussi bien à la « Sainte Alliance » radicale (Syrie, Libye, Iran) qu’à l’hostilité israélienne. Pourtant la France, seule sur le terrain, quoique sous drapeau de l’ONU, est moins frappée sur ce théâtre très exposé qu’à Beyrouth au sein de la force multinationale. Elle réussit même un complexe échange de prisonniers entre Israël et le Fath « arafatiste ».
En quoi l’invitation d’Arafat à l’Élysée en 1989 peut-elle être qualifiée de sauvetage ?
Jean-Pierre Filiu – Cette invitation constitue bel et bien un sauvetage politique pour Yasser Arafat, qui vient d’accomplir le geste tant attendu de la reconnaissance de l’État d’Israël, mais qui doit rapidement prouver à ses partisans et à son peuple la validité de cette option pacifique. Or la centrale palestinienne est toujours contestée par la « Sainte Alliance » radicale, alors même que le gouvernement Shamir exclut toute discussion avec l’OLP. François Mitterrand est alors scandalisé par la violence de la répression israélienne de « l’Intifada » des territoires occupés. En invitant le chef de l’OLP en visite officielle à Paris, il récompense le courage politique de Yasser Arafat, sans rien amender des exigences françaises à son égard. C’est ainsi qu’Arafat prononce à Paris la « caducité » de la charte de l’OLP. Quant à Mitterrand, il reprend à cette occasion les termes mêmes de son discours de la Knesset.
Deux images symbolisent le rayonnement de cet engagement lors de la disparition de François Mitterrand. Le recueillement de Yasser Arafat sur sa dépouille, au matin du 8 janvier 1996, avec récitation de la première sourate du Coran. Et la présence de Shimon Peres, Premier ministre d’Israël, non loin du chef de l’OLP, lors de l’hommage national rendu à Notre-Dame trois jours plus tard.