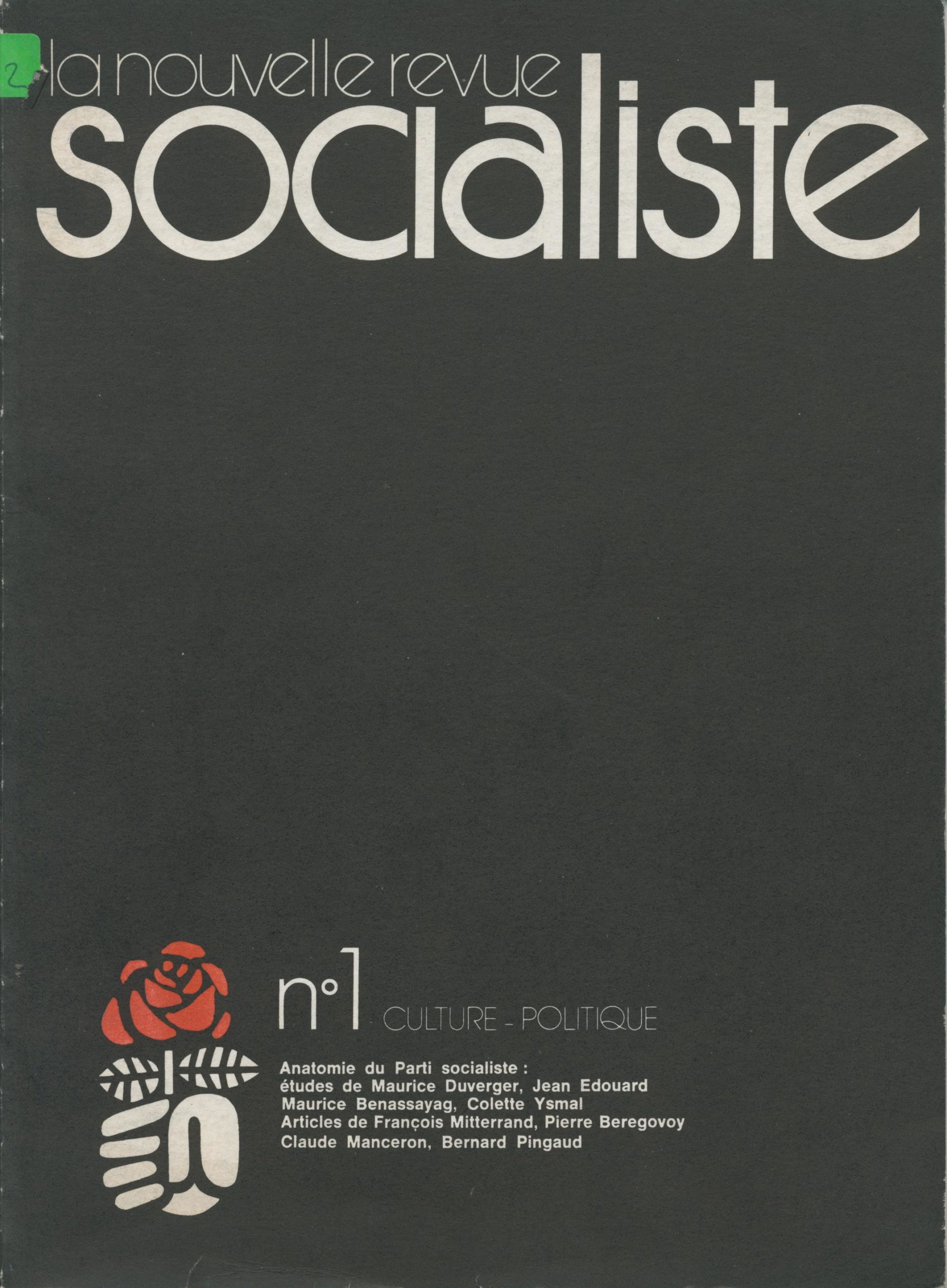
Dans le salon que décore un mobilier banal, nous l’attendons quelques instants. Rien d’autre n’y attire l’attention que la photographie d’un jeune couple rieur, la fille du président et son mari, unis en grande pompe l’autre semaine. Je cherche en vain un portrait de Nasser. Aucun cérémonial n’accompagne l’arrivée de Sadate, sinon l’inévitable flash de magnésium auquel nous devrons les clichés que nous classerons parmi nos souvenirs. Présentations faites nous nous asseyons, Sadate à droite, moi à gauche, sur un canapé semblable, aux rayures près, à celui qui m’a permis de côtoyer successivement, ces temps derniers, Palme, Ceaucescu, Tito… et Golda Meir. Robert Pontillon, Didier Motchane et Mohamed Heykal s’enfoncent dans des fauteuils disposés en équerre, selon le même décor universel. Plus surprenant est le personnage du président d’Egypte. L’image qu’on en donne en Europe tend à la caricature : taille svelte et petites moustaches de danseur mondain. Au lieu de cela, nous sommes frappés par son visage harmonieux aux traits sensibles, au regard bienveillant. Sur l’uniforme kaki pas de décorations. Bien qu’originaire du Delta, il ressemble à ces paysans de Haute Egypte que l’on rencontre aux confins de Nubie. Il s’exprime à voix lente et souligne les inflexions de sa pensée. On devine en lui le désir de convaincre. Durant tout l’entretien, qui durera plus de deux heures, il ne se départira pas du ton doux et courtois adopté dès le premier moment. Pourtant nous revenons de loin, les uns et les autres. Depuis 1956 et la guerre de Suez, les ponts étaient coupés entre les socialistes français et les pays arabes. On se souvient et on oublie. On oublie et on se souvient. Est-il une autre façon de vivre ? Je n’avais pas à m’expliquer sur la responsabilité directe que me conférait ma présence au sein du gouvernement Guy Mollet. Sadate n’y fit qu’une brève allusion, pour commencer. « C’est la deuxième fois, je crois, que nous nous rencontrons », et passa outre. Je n’avais pas besoin, non plus, de rappeler que notre Parti socialiste appartenait à la même Internationale que le MAPAI de Golda Meir et de Moshé Dayan, que j’étais l’ami personnel de Golda. On le savait. Je l’ai fait cependant, pour que nul ne se méprît sur le sens de notre visite. Etait-ce s’avouer ennemi des Arabes que d’affirmer le droit à l’existence d’Israël et d’en rechercher les moyens? « Nous ne voulons pas détruire Israël et nous désirons la paix », répondit Sadate. La veille, le vice-président de la République, Fawzi, et le ministre des Affaires étrangères, Fahmi, nous avaient tenu les mêmes propos avec une égale fermeté. » Mais il faut qu’Israël renonce aux territoires occupés en 1967 et reconnaisse la réalité nationale palestinienne », ajouta-t-il, comme l’avaient fait avant lui, ses deux collaborateurs. J’objectai que si l’on en restait à des pétitions de principe auxquelles s’opposaient exactement celles des Israéliens, ce serait de nouveau la guerre et je rappelai que M. Jobert lui-même, garant de la traduction la plus stricte de la résolution 242, la traduction française, l’avait interprétée du haut de la tribune du Palais-Bourbon comme pouvant autoriser « des rectifications mineures des frontières », ce qui, en clair, signifiait l’éventualité d’accommodements sur Jérusalem et le Golan. « Il n’y a pas de chef d’Etat arabe qui puisse accepter cela », répliqua Sadate. La solidarité est notre loi. D’ailleurs, c’est un faux problème. Le temps travaille pour les Arabes. La conquête latine a duré plus d’un siècle. Qu’en reste-t-il ? Et du colonialisme ? Israël gagnera plus à la paix qu’à la guerre, et d’abord sa sécurité. Ce ne sont pas quelques millimètres carrés sur une carte d’état-major qui comptent mais la garantie qu’offriront les Arabes au nouvel équilibre de cette partie du monde. Je n’ai jamais eu peur des mots paix et négociation. En 1971, je les ai prononcés de façon solennelle et j’étais sincère. N’était-ce pas reconnaître déjà la présence d’Israël ? Ce mot-là non plus je ne le crains pas. Mais les dirigeants de ce pays, aveuglés par l’idée de leur toute-puissance, ne m’ont pas cru ou, plutôt, n’ont pas voulu me croire. Ils ont eu tort, semble-t-il. Si l’unité des Arabes est en marche, Israël y est pour quelque chose. »
Nous parlerons de la crise du pétrole, des relations franco-égyptiennes, chaudes en apparence, tièdes en réalité, de l’absence (qu’il regrette) de l’Europe, de la nécessité d’une politique méditerranéenne entre Etats riverains. Mais à chaque tournant de la conversation il nous ramènera au sujet qui l’obsède : la paix au Proche-Orient. Des Américains, il sera peu question, bien que le bruit courût au Caire de leur retour en force. Je l’interrogeai là-dessus. « La révolution a transformé l’Egypte. Mais trente-sept millions d’Egyptiens, un million de plus chaque année, et la guerre en permanence, cela coûte cher. L’heure est venue de s’attaquer au désordre, aux lenteurs de la production, d’investir, d’équiper. » Ce n’était pas un démenti !
Les entretiens de ce genre font la part trop belle aux convenances et aux usages pour aller au-delà de la surface des choses. Aussi ne faut-il pas en attendre ce pourquoi ils ne sont pas faits. Comptent davantage les signes sensibles qui donnent aux mots, aux attitudes une résonance nouvelle, qui changent l’éclairage d’un problème, fût-il déjà cent fois débattu. Rien ne remplace, Henry Kissinger illustre cette règle, la diplomatie directe. Entrent alors en jeu des intuitions et des correspondances qu’aucun autre moyen, discours, échanges de notes, conférences, conversations d’ambassadeurs, ne mettra en lumière ou en mouvement. Sur la politique de Sadate, notre conversation ne nous apprenait guère plus que ce que nous tenions des sources habituelles d’information et il ne pouvait en être autrement. Et cependant, en le quittant, nous avions le sentiment d’en savoir plus. Etait-ce l’effet du charisme de ce personnage soudain touché par la grâce de l’histoire après qu’elle l’eût si longtemps ignoré en dépit d’une existence mêlée depuis vingt ans à de grandes actions ? Ou étions-nous seulement surpris et donc séduits – de découvrir un homme plus riche de réflexion et de vie intérieure que ne le laissait supposer l’image qui nous était fournie jusque-là? ou l’attrait des problèmes posés au Moyen-Orient et leur intensité transformaient-ils ce qui en approchait, modifiaient-ils les rapports de valeur? Nous tirions en tout cas de ce qui avait été dit une somme d’hypothèses, de prévisions qui dépassaient de loin ce qu’une analyse stricte des propos aurait normalement permis. Nous distinguions dans le comportement de Sadate et dans l’orientation voulue de ses propos l’affirmation d’une volonté et l’annonce d’une décision.
Un choix était fait, à l’évidence, et cette évidence, immédiatement perceptible pour la politique étrangère, commençait d’apparaître en politique intérieure. Mais s’il était indiscutable que le cours des choses qui avait ordonné la vie d’une génération d’Egyptiens touchait à sa fin, l’interprétation des événements depuis la guerre du Kippour variait selon nos interlocuteurs. Les uns estimaient que Sadate, pressé d’obtenir l’aide américaine pour le redressement économique du pays, était prêt à la payer au prix fort, fût-ce en alignant sa diplomatie sur celle de Kissinger, qu’il souhaitait faire d’une pierre deux coups en profitant de ce retournement pour se concilier la bourgeoisie nationale et élargir par là les bases de son autorité que commençaient précisément à contester les milieux traditionnels de la révolution. A l’appui de leur thèse ils citaient une multitude d’événements isolément anodins mais que leur accumulation rendait démonstratifs : éloignement des anciens compagnons, baisse sensible de ton et de ferveur dans le culte de Nasser, abandon de certaines appropriations sociales, réconciliation avec Fayçal d’Arabie, entrée dans le cercle des familiers de conseillers classés récemment parmi les adversaires du régime. Les autres, tout en basant leur raisonnement sur les mêmes observations, estimaient qu’il était injuste d’accuser Sadate de renier son passé, qu’il convenait de comprendre autrement une attitude dont la véritable signification résidait dans son désir d’une pause, non pour bifurquer mais pour reprendre le souffle et pour réunir autour de la personne du chef de l’Etat et de sa politique, en un temps difficile, le plus grand nombre possible de ses compatriotes, bref que l’on allait vers une sorte d’union nationale dont la révolution demeurerait l’âme et l’inspiratrice et qu’après tout, c’était le destin d’une révolution réussie que de rassembler un jour la nation tout entière.
Les tenants de la première thèse soulignaient l’élimination des membres du Conseil de la Révolution à l’exception de Shafei, l’autre vice-président de la République, Ali Sabri en prison, Khaled Mohieddine écarté de toute fonction et en dépit de l’entrée au gouvernement, après cinq ans d’internement assorti de tortures encore visibles sur son visage, d’un homme comme Ismaïl Sabri Abdallah, l’ancien (et remarquable) leader du Parti communiste, les menaces qui pesaient sur les intellectuels et militants de gauche tantôt libres d’agir dans le cercle étroit de revues d’idées à petit tirage, tantôt récupérés par une police habituée à les expédier dans des culs de basse fosse. Mais ces arguments servaient aussi aux seconds pour démontrer que Sadate conduisait une stratégie subtile et ferme visant à normaliser la vie politique égyptienne, puisque, hors Ali Sabri, ses amis ainsi que quelques Frères Musulmans incarcérés (peut-être ne le sont-ils plus à l’heure actuelle) la répression avait pratiquement cessé, que des signes comme le retour annoncé des cendres du roi Farouk et de sa sœur près de leurs ancêtres mamelucks prouvaient l’enracinement d’une révolution qui n’avait plus à craindre l’ombre de la monarchie, que Sadate devenu maitre du jeu et ayant prouvé sur le terrain son aptitude à gouverner, il était enfin possible pour l’Egypte d’aborder les problèmes de l’époque au lieu de s’enfermer dans le rêve nassérien.
Le comportement de Sadate dans la guerre du Kippour et le brusque dégagement qui a suivi alimentaient la dispute. Qu’il eût pris parti pour la paix, tous l’accordaient. Mais qu’il pût espérer régler autour du tapis vert un conflit posé en termes inconciliables paraissait si déraisonnable que certains y distinguaient une nouvelle habileté devant permettre au chef de l’Etat égyptien de régler sur le plan militaire le contentieux avec Israël et d’attendre, sans se compromettre – même s’il fallait attendre longtemps – que le fruit murît du côté syrien et jordanien.
Mohamed Hassanein Heykal, l’organisateur du voyage et du rendez-vous, ne s’était pas mêlé à la conversation chez Sadate et était resté avare de commentaires. Carré dans son fauteuil, il avait écouté, impassible, se contentant de hochements de tête. Tout juste allait-il couper Sadate quand celui-ci avait laissé entendre qu’il se retirerait de la vie publique au terme de son mandat présidentiel, dans trois ans : « L’Egypte aura besoin de vous. » Le répéterait-il aujourd’hui ? Vingt-quatre heures plus tard, il était destitué.
On comprend mal à Paris les dimensions de l’empire Al Ahram et donc de l’empire d’Heykal, puisque pendant dix-sept ans Heykal s’est identifié à son journal. Un million de lecteurs quotidiens, des éditions dans sept pays arabes, la plus moderne imprimerie du monde, au soussol d’un gratte-ciel digne de la 5e Avenue, des revues, des hebdos, des librairies, un centre d’études politiques et stratégiques, des séminaires idéologiques, un réseau d’import-export et, chaque vendredi, l’éditorial du maître de maison, valant cinq cent mille lecteurs de plus, attendu, disséqué, commenté sous toutes les latitudes en constituaient les fondements. Précisément, ce vendredi-là, l’article de Mohamed Heykal était proprement explosif. Le directeur d’Al Ahram avait pressenti de longue date le glissement du régime vers d’autres assises sociales, la revanche de la bourgeoisie, le déclin de la révolution. Ami de Nasser, peut-être le plus proche, il avait plusieurs fois, sans rompre, pris ses distances avec son successeur. Il avait souhaité la fusion de l’Egypte et de la Libye, déploré son échec, donné implicitement raison à Kadhafi. Il avait condamné le recours à Kissinger, alors que les soldats égyptiens continuaient de se battre. Il dénonçait maintenant avec vigueur la politique américaine et ceux qui se fiaient à elle. Non qu’il fût boutefeu. Considéré naguère comme modéré et pro-Américain parce qu’il avait freiné les emportements de Nasser, il s’affirmait fidèle à la lutte contre l’impérialisme et mettait en garde son pays contre la réinsertion au MoyenOrient du State Department. Heykal nous avait reçus, la veille, à Al Ahram, entouré d’une vingtaine d’intellectuels et de dirigeants politiques, pour une de ces discussions non-stop, claires, amicales, passionnées, qui sont en pays arabe l’une des lois de l’hospitalité. Là aussi il n’avait pris part qu’avec discrétion au débat. Mais on le devinait présent, intensément, et chacun se reportait, •sans le dire, à cet homme dont tout, l’allure, l’autorité, le flegme et jusqu’au vêtement évoquait un banquier de la City, tandis que le regard vif, droit et qui s’éclairait d’un demisourire indiquait que la sûreté de soi s’alliait au goût du risque.
Dès notre arrivée à Orly, les dépêches nous apprenaient qu’Heykal, une fois écarté, l’un des frères Amine, tous deux condamnés par Nasser à la détention perpétuelle, était nommé directeur d’Al Ahram. Cette disgrâce allait précéder de quarante-huit heures celle du gendre de Nasser, directeur du Centre d’Etudes Stratégiques d’Al Ahram.
Sadate, Heykal, l’avenir proche de l’Egypte est contenu dans ces deux noms. Je me les représente encore penchés l’un vers l’autre, dans le salon bourgeois du petit Nil et devisant, amis paisibles, tels que je les ai vus.








